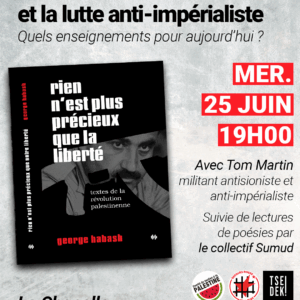A l’occasion du 13 décembre (le ACAB Day), nous publions une interview de Gwenola Ricordeau, au sujet de la sortie du livre dont elle signe la direction 1312 raisons d’abolir la police (ed. Lux).
Nous avons eu la chance de pouvoir lire le livre avant sa sortie le 6 janvier prochain. Celui-ci contient une quinzaine de contributions sous la coordination de Gwenola qui en fait une introduction et présente les textes.
Gwenola Ricordeau est enseignante de criminologie (professeure associée en criminologie à la California State University, Chico), militante abolitionniste (pour l’abolition du système pénal), elle a précédemment publié Pour elles toutes. Femmes contre la prison en 2019 [sur le féminisme et l’abolitionnisme pénal] et en 2021 Crimes et Peines. Penser l’abolitionnisme pénal qui regroupe des textes classiques de l’abolitionnisme.
Nous l’avions interviewée y a deux ans sur l’abolition de la police a l’occasion des mobilisations contre la loi sécurité globale. Gwenola Ricordeau sera à Toulouse le 5 janvier prochain pour une soirée de présentation de son livre : à partir de 19h, salle San Subra (4 rue San Subra – 31300 Toulouse – Métro Saint cyprien). L’événement sera accessible aux personnes à mobilité réduite et nous demanderons le port du masque afin de rendre celui-ci accessible à tou·te·s.
Tu publies un ouvrage collectif sur l’abolition de la police, qui est une partie de l’abolitionnisme pénal. Pourquoi as-tu voulu publier ce livre et quel est son objectif ?
J’avais, avec mon éditrice Marie-Eve Lamy, plusieurs objectifs en travaillant à ce livre. D’abord donner accès au lectorat francophone à des textes nord-américains contemporains, mais aussi à des auteurs et autrices souvent peu ou jamais traduits en français comme Alex Vitale, Kristian Williams ou Dylan Rodriguez. J’espère donc que le livre participera à la circulation des réflexions abolitionnistes, aux côtés de livres comme Abolir la police ou Défaire la police.
Mais il y a, avec 1312 raisons d’abolir la police, aussi la volonté de contribuer à un bilan critique des mouvements abolitionnistes de la police qui se sont développés avec les mobilisations qui ont suivi le meurtre de George Floyd au printemps 2020. En ce sens, le livre doit permettre aux abolitionnistes de mieux s’outiller, sur le terrain théorique comme militant, et de mieux comprendre les obstacles rencontrés pour abolir la police.
C’est pourquoi ce livre s’adresse à la fois à un public militant, déjà critique voire abolitionniste de la police, mais aussi plus largement à ceux et celles qui s’intéressent aux réflexions et mouvements abolitionnistes de la police.
Dans l’introduction, tu retraces les origines des théories de l’abolition de la police et sa construction jusqu’à récemment. Peux-tu revenir sur ce sujet ?
Les textes réunis dans le livre sont contemporains, mais dans l’introduction, je reviens sur la généalogie des mouvements pour l’abolition de la police et les réflexions qui les ont nourris. Le Black Panthers Party tient une place importante dans la généalogie des mouvements abolitionnistes car ses apports sont énormes, tant sur le plan de l’analyse que de la stratégie. Par exemple en définissant la police comme une force d’occupation des quartiers noirs et en appelant à l’autodéfense et à l’organisation communautaire pour se protéger et se passer de la police.
Les mouvements récents pour l’abolition de la police puisent aussi leurs racines dans l’abolitionnisme pénal et les luttes pour l’abolition des prisons, avec la reprise de leurs analyses et de leurs stratégies. Ceci dit, il y a une diversité dans les analyses et les stratégies abolitionnistes : il serait faux de les réduire aux appels au « définancement » (réduction des budgets, « defund » en anglais) de la police.
Le livre collectif s’appuie sur des expériences particulières. En quoi sont-elles un point d’appui pour construire une réflexion générale et une théorie de l’abolition de la police ?
Le livre est fortement ancré en Amérique du Nord, mais aussi dans des expériences politiques et personnelles diverses, comme le racisme, le travail du sexe ou le validisme. Évidemment, le but n’était pas d’épuiser toutes les analyses situées qu’on peut faire de la police dans une perspective abolitionniste. Mais il était important à mes yeux de restituer comment les réflexions et les mouvements pour l’abolition de la police trouvent leurs racines dans le traitement subi par certains groupes, et dans les analyses et les formes de résistance qu’ils développent. Cela permet d’indiquer clairement qui est la cible de la police et qui souffre de son existence – et donc, en creux, qui en tire profit. Cela permet aussi de souligner que la lutte pour l’abolition de la police est aussi une lutte contre le suprématisme blanc, contre le patriarcat, le capitalisme et le validisme notamment.
La première partie du livre regroupe cinq textes sous le titre « Rompre avec le réformisme ». Peux-tu expliquer pourquoi c’est important pour penser l’abolitionnisme ?
Il n’y a pas, entre le réformisme et l’abolitionnisme, une différence de degrés (entre des approches plus ou moins radicales), mais une différence de nature. Dans le sens où l’abolitionnisme est en désaccord avec les analyses et les stratégies réformistes – même si certains courants de l’abolitionnisme revendiquent en faveur d’un certain type de reformes, les reformes dites « non réformistes ». Ceci étant dit, il y a avec l’abolitionnisme une rupture d’avec ce que j’appelle le « régime ordinaire de la critique de la police », c’est-à-dire l’idée que la police fonctionnerait mal. Cette idée alimente un cycle politico-médiatique qui se répète à l’infini : scandale et indignation publique, mobilisations politiques, contre-offensive de la police et de ses apologistes (discrédit de la victime, défense des policiers, etc.) et, selon l’ampleur de l’indignation publique et des mobilisations politiques, mise en place de réformes.
L’abolitionnisme a pour projet de sortir de ce cycle politico-médiatique et il critique donc les forces qui contribuent à l’alimenter. De ce fait, Dylan Rodriguez dénonce les organisations réformistes en matière de police comme participant de fait d’une « contre-insurrection libérale et progressiste ». Ainsi, la rhétorique selon laquelle « La police doit rendre des comptes ! », comme Yannick Marshall l’explique, est une de ces « platitudes utiles du jargon libéral » qui laisse intacte la légitimité de la police.
En France, notamment autour des présidentielles, on a beaucoup entendu des mots d’ordre comme « dissolution de la BAC », « désarmons la police »… Peux-tu nous donner ton avis sur ces revendications ?
Le désarmement et la dissolution de la police sont des revendications qu’on retrouve dans les mouvements abolitionnistes qui s’appuient sur la stratégie en trois temps : « Disempower, disarm, disband », c’est-à-dire « affaiblir, désarmer, dissoudre [les forces de l’ordre] ». Mais il faut souligner plusieurs choses. D’abord, cette stratégie n’est pas l’unique stratégie abolitionniste, même si c’est celle qui a été la plus commentée ces dernières années car le mouvement pour le définancement de la police s’inscrit justement dans la tactique d’affaiblissement de la police. Par ailleurs, appeler à la dissolution de la police n’est pas pareil qu’appeler à la dissolution d’une force de police en particulier. Ce type de revendication risque d’alimenter la rhétorique good cop/bad cop (bon flic/mauvais flic) qui, en suggérant qu’il existe des forces de police meilleures que d’autres, renforce la légitimité de la police. L’abolitionnisme ne vise pas la dissolution d’une force de police en particulier. Les exemples de la suppression de la police des mœurs en Iran ou de celle des « voltigeurs » qui ont tué Malik Oussekine en France montrent que l’enjeu n’est pas telle ou telle force de police, mais la police elle-même. Plus généralement, ce que visent les abolitionnistes n’est pas seulement la police, mais ce qu’on appelle en anglais le « policing », c’est-à-dire le maintien de l’ordre, la surveillance. Or le policing n’a pas forcément besoin d’un corps policier en tant que tel, notamment si on pense au développement des nouvelles technologies.
Ceci étant dit, ce type de revendications qui visent une force de police en particulier ou le désarmement de la police peuvent évidemment avoir un intérêt tactique si cela permet de faire avancer une ligne abolitionniste et je laisse aux personnes qui luttent en France contre la police juger de leur intérêt dans le contexte actuel.
Dans la conclusion, intitulée « Vivre libre, c’est vivre sans police », tu écris « Pas d’abolitionnisme sans projet révolutionnaire ». Qu’est-ce que cela implique ?
Cette formule est une réponse a plusieurs mythes. Le mythe d’une police qui pourrait protéger des violences racistes, patriarcales ou LGBTQphobes, alors qu’elle-même cause couramment ce type de violences, qu’elle participe aux systèmes qui les produisent et qu’elle réprime ceux et celles qui s’attaquent précisément à ces systèmes. Ou encore le mythe d’une police antiraciste ou féministe, ou d’une police qui ne soit pas au service du capitalisme.
Dire « Pas d’abolitionnisme sans projet révolutionnaire », ça implique de situer le projet politique pour ce qu’il est et d’assumer la conflictualité qui en découle.
Tu appelles aussi à « dé-fliquer les luttes progressistes ». Peux-tu nous expliquer ce que tu entends par là ?
Cet appel a pour point de départ une « critique de la critique » de la police à gauche. Celle-ci se limite souvent à la dénonciation des « violences policières », mais elle se risque rarement à des analyses de son rôle, notamment sous l’angle de la race et de la classe. Comment peut-on vouloir changer la société tout en adhérant au mythe selon lequel la police serait une force progressiste ?
La faiblesse de ces analyses se reflète dans les revendications de mouvements qui se veulent progressistes et qui demandent souvent davantage d’intervention du système pénal, avec plus de police ou une meilleure police. Les luttes féministes sont un bon exemple. Même si on peut observer une montée en puissance de la critique du système pénal et de la police dans les mouvements féministes, ceux-ci ont encore trop souvent pour horizon politique la police. Par exemple, ils ont rarement une réflexion critique sur l’usage des plaintes à la police, or celles-ci sont souvent décrites comme un outil tactique, censé contribuer à faire avancer la cause des femmes. À ce titre, le texte d’Adore Goldman et Melina May, deux militantes du Comité autonome du travail du sexe (CATS) au Canada, pose bien les termes du débat en dénonçant la police comme une institution patriarcale – entre autres.
Appeler à dé-fliquer les luttes progressistes, c’est appeler à rompre avec les positions réformistes et à prendre clairement position contre la police. En effet, comme je l’écris, « détester la police est une opinion politique ». Il faut assumer cet antagonisme et cette conflictualité quand on se situe dans le camp du progrès social.
Enfin, est-ce qu’il y a une question qu’on ne t’a pas posée et à laquelle tu penses qu’il serait intéressant de répondre ?
J’aurais aimé une question sur l’abolition de la police et l’autodéfense sanitaire ! En effet, je vais bientôt entamer une série de présentations de 1312 raisons d’abolir la police en France. Elles se feront dans des lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite et qui promeuvent l’autodéfense sanitaire, c’est-à-dire le port du masque et une aération suffisante des lieux. Cela me semble logique de s’organiser pour se protéger et prendre soin les un-e-s des autres plutôt que de s’en remettre à l’État qui a bien montré depuis le début de la pandémie que nos vies ne valent rien. En tant qu’abolitionniste, l’autodéfense sanitaire me semble même une exigence, au même titre que la critique des manières dont la pandémie a servi de prétexte au développement de dispositifs de surveillance et la dénonciation de la répression qui s’est abattue sur les habitant-e-s des quartiers populaires au nom de la santé publique. Nous ne sommes pas égaux devant la pandémie : c’est pour cela que la solidarité est cruciale. Comme disent les abolitionnistes aux États-Unis, « Care, not cops ».