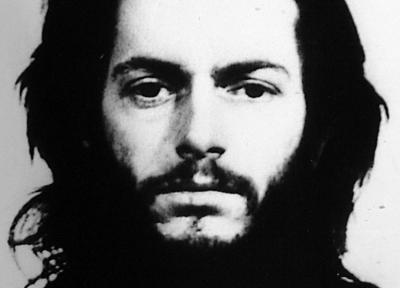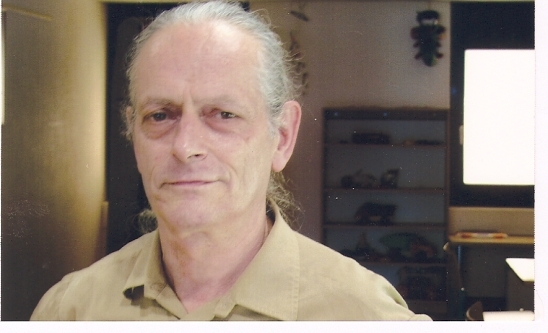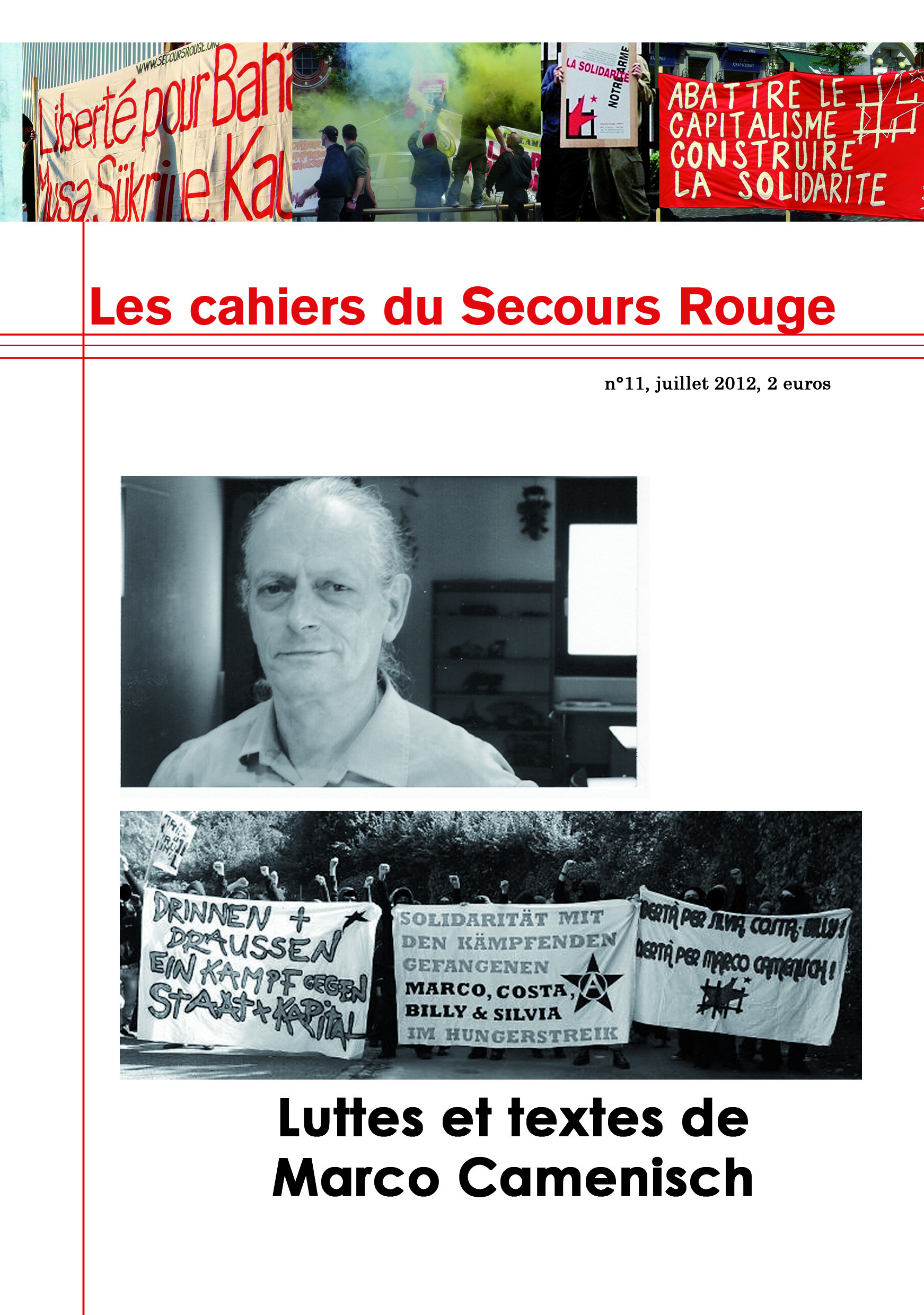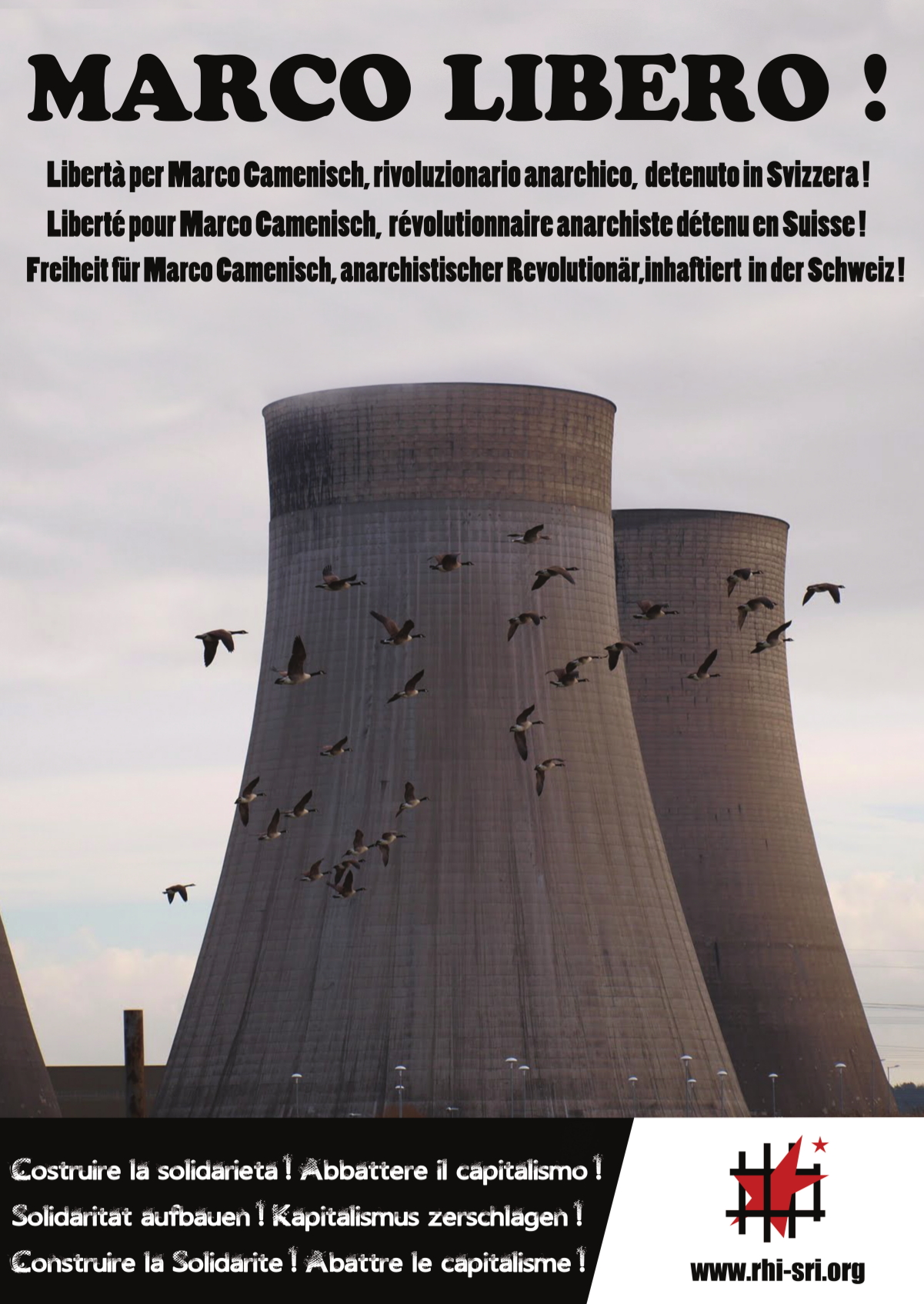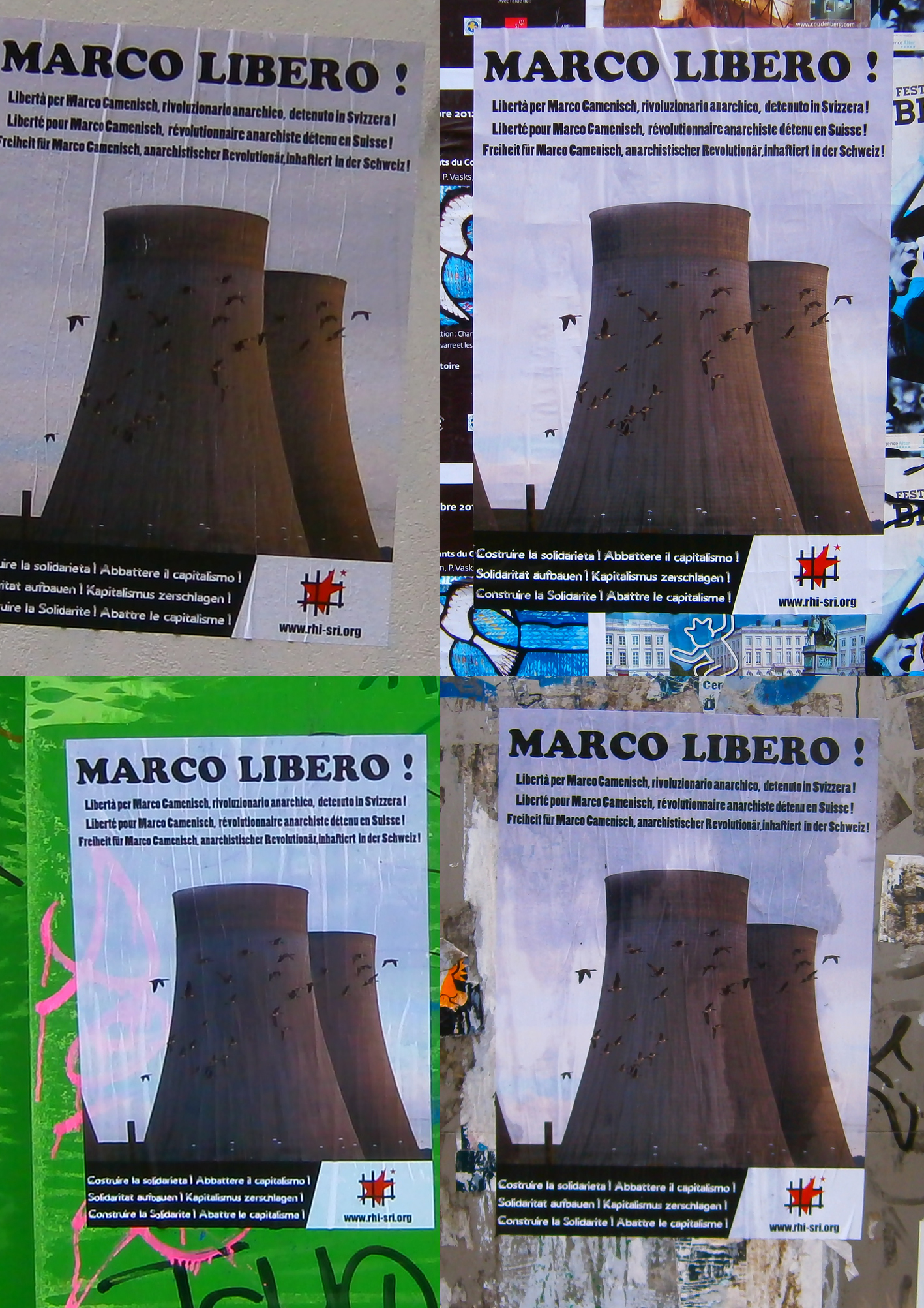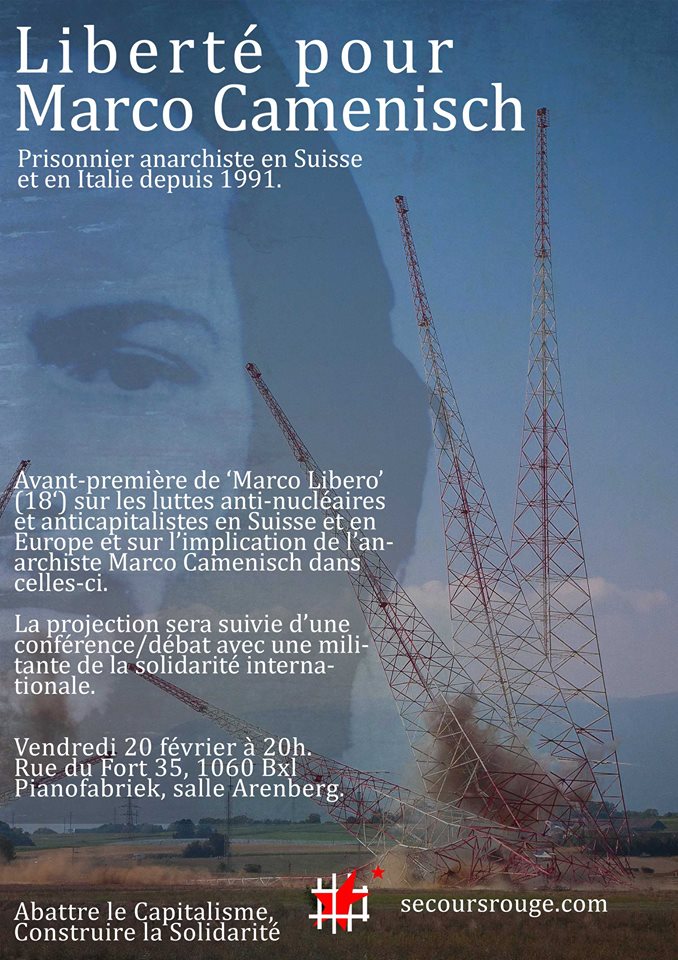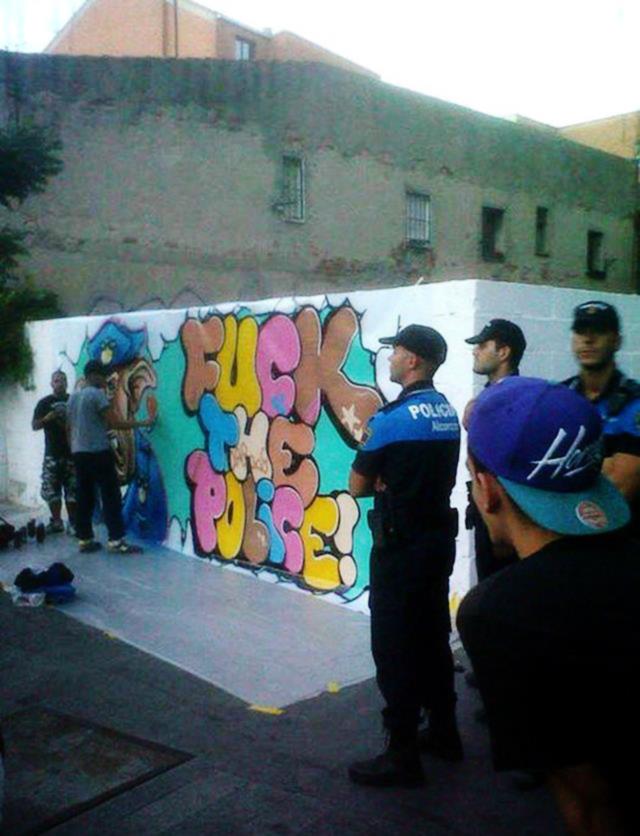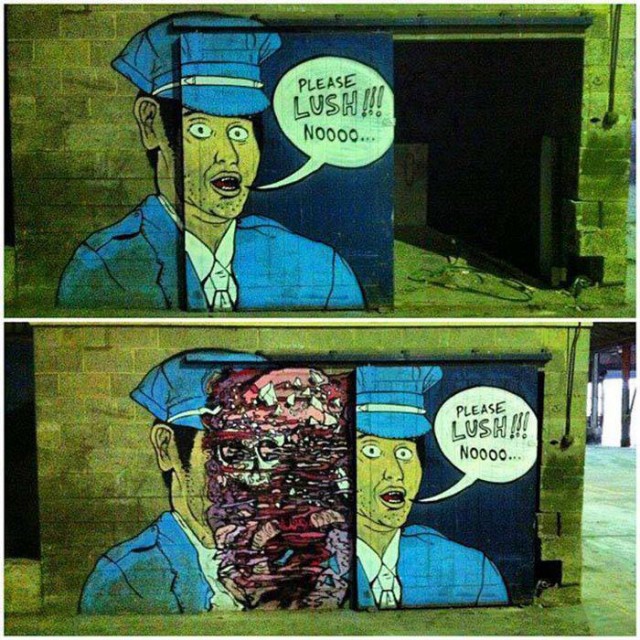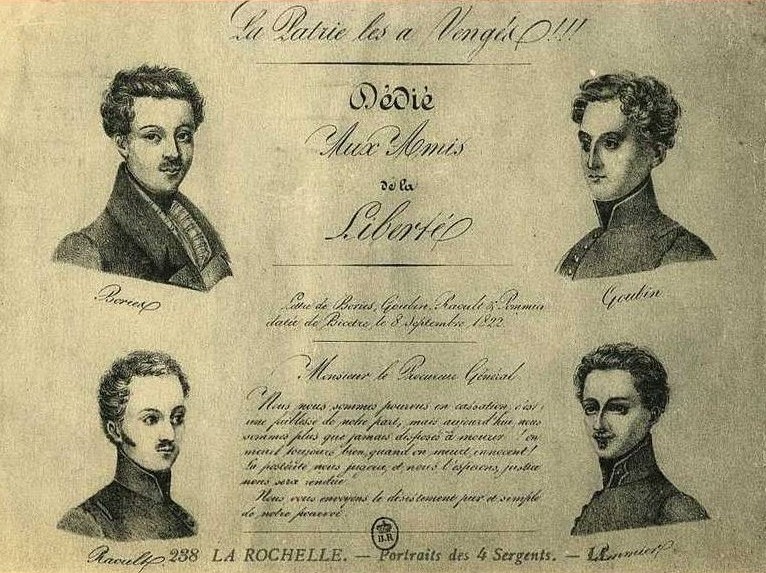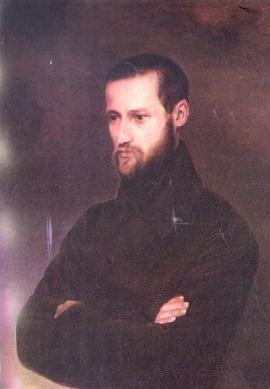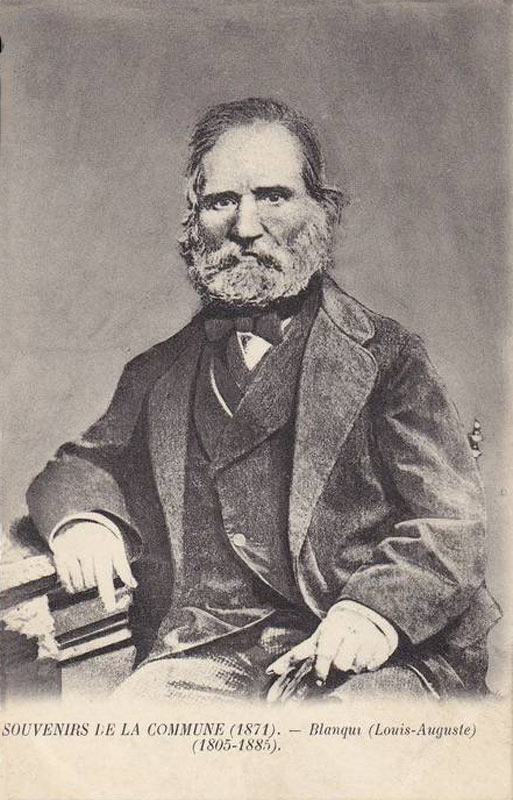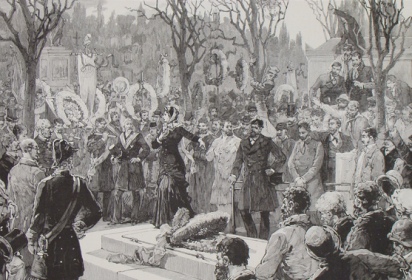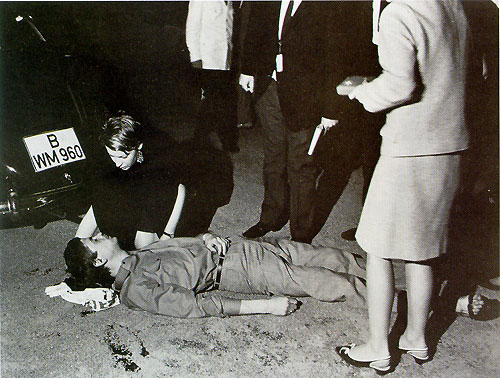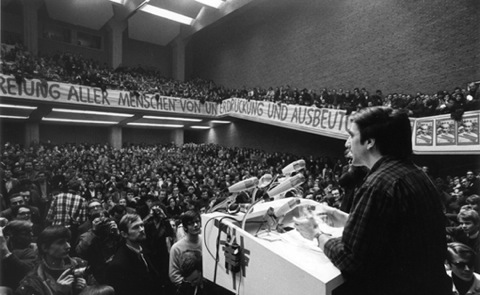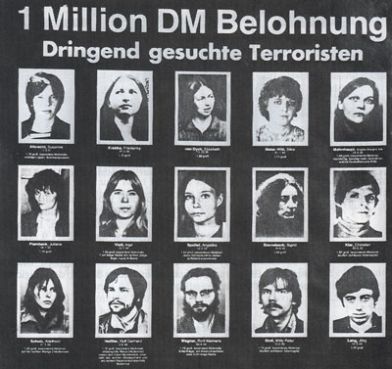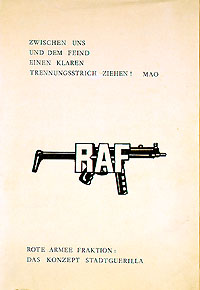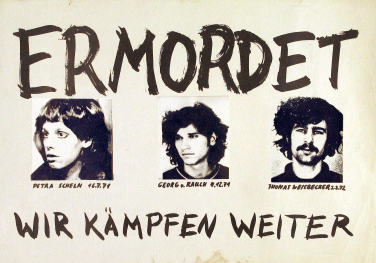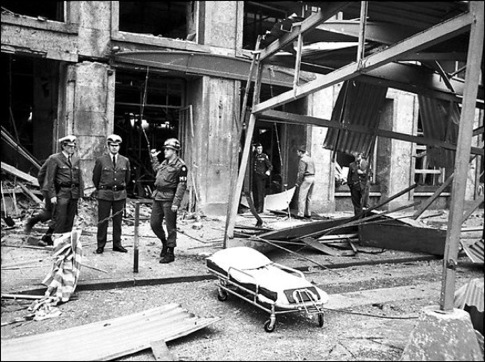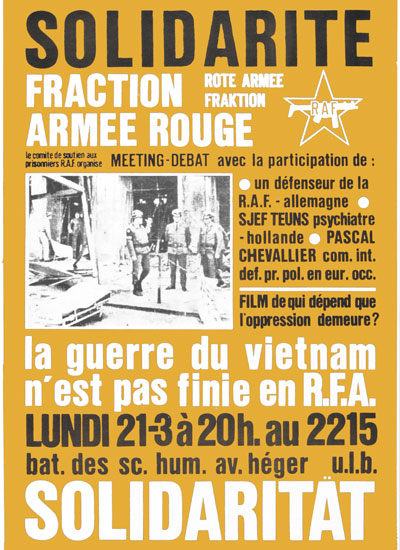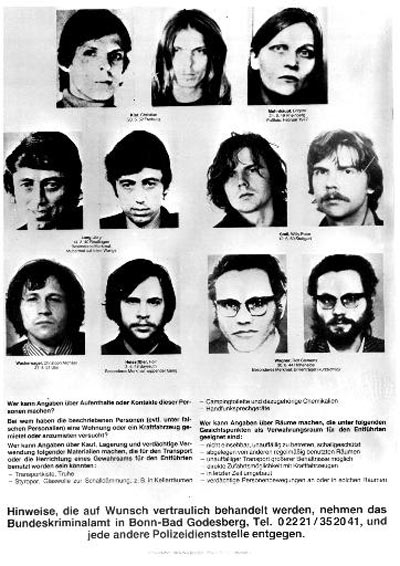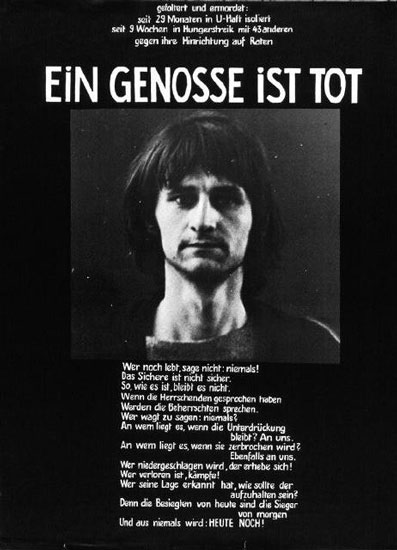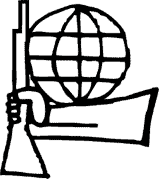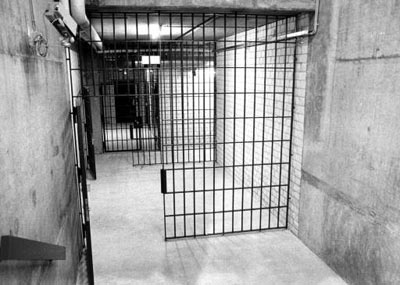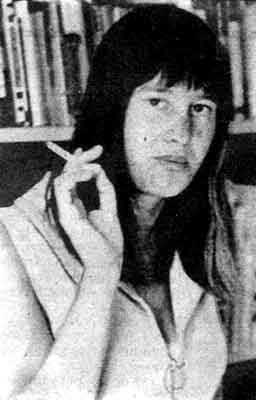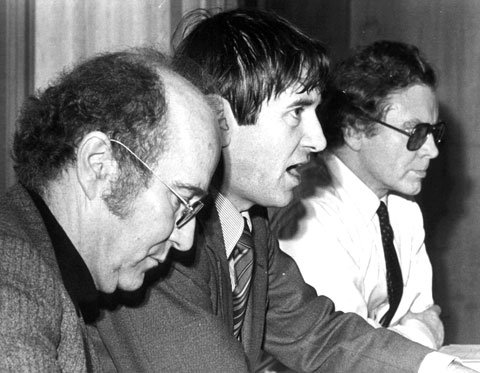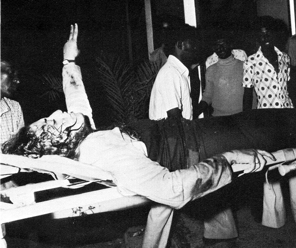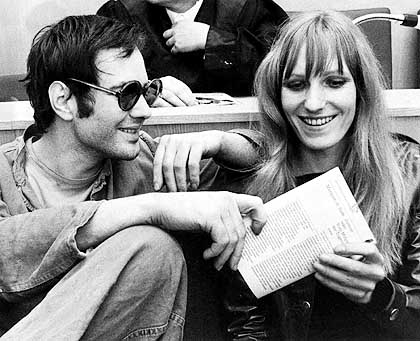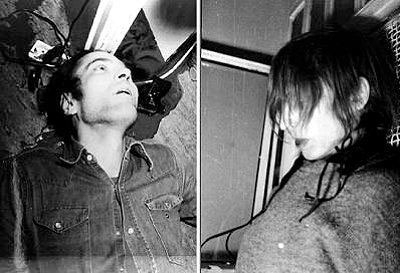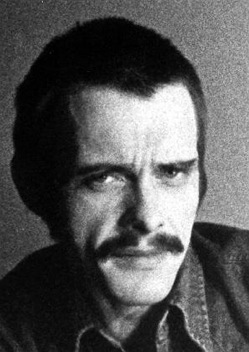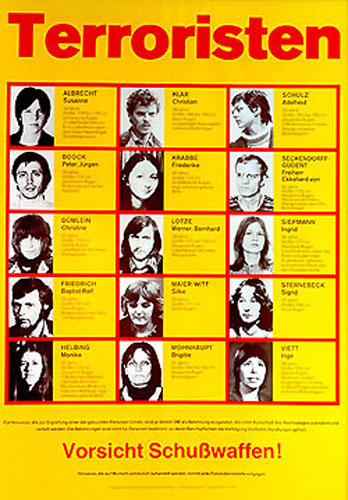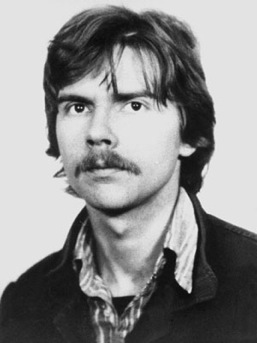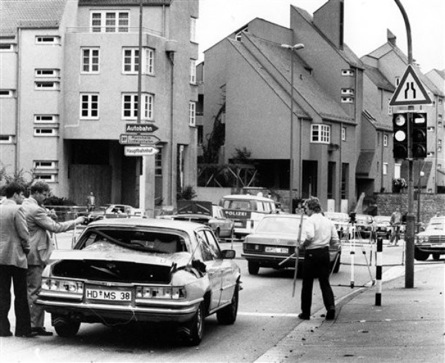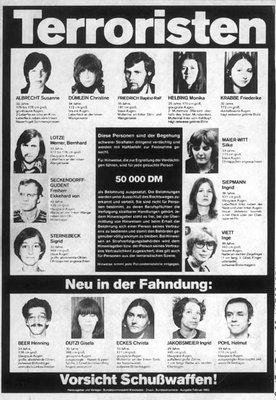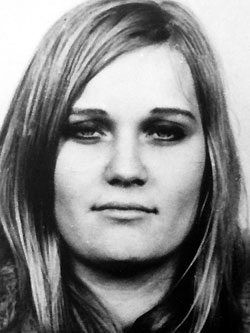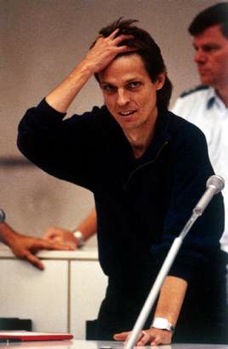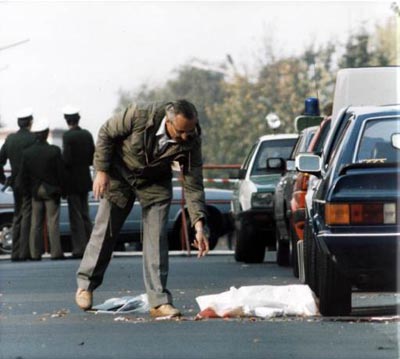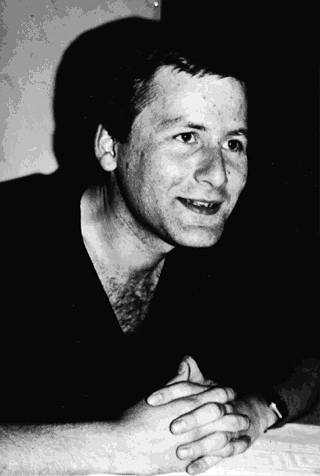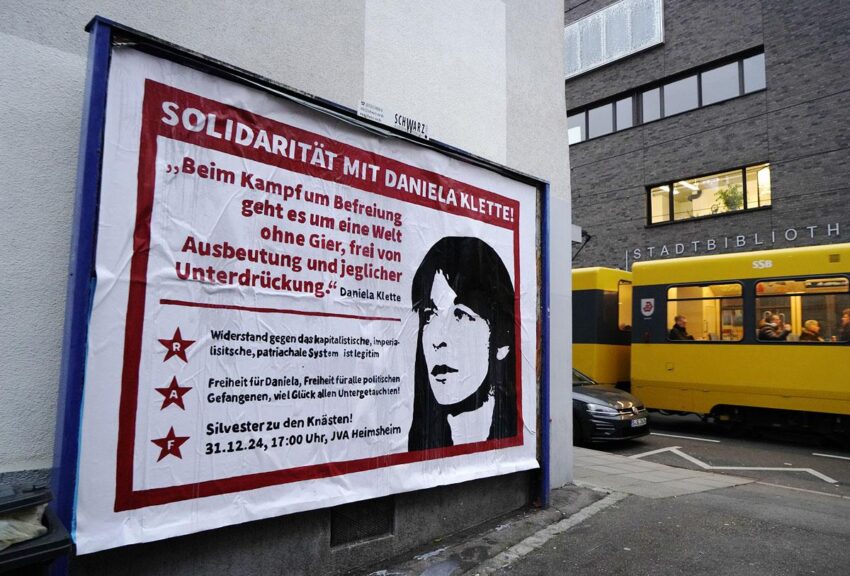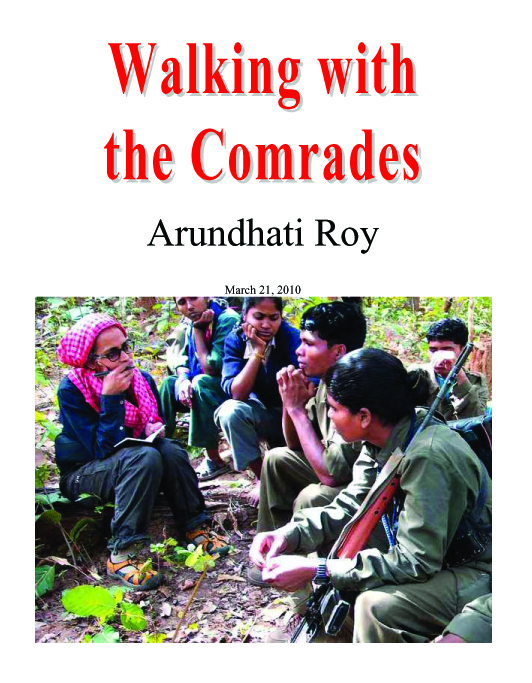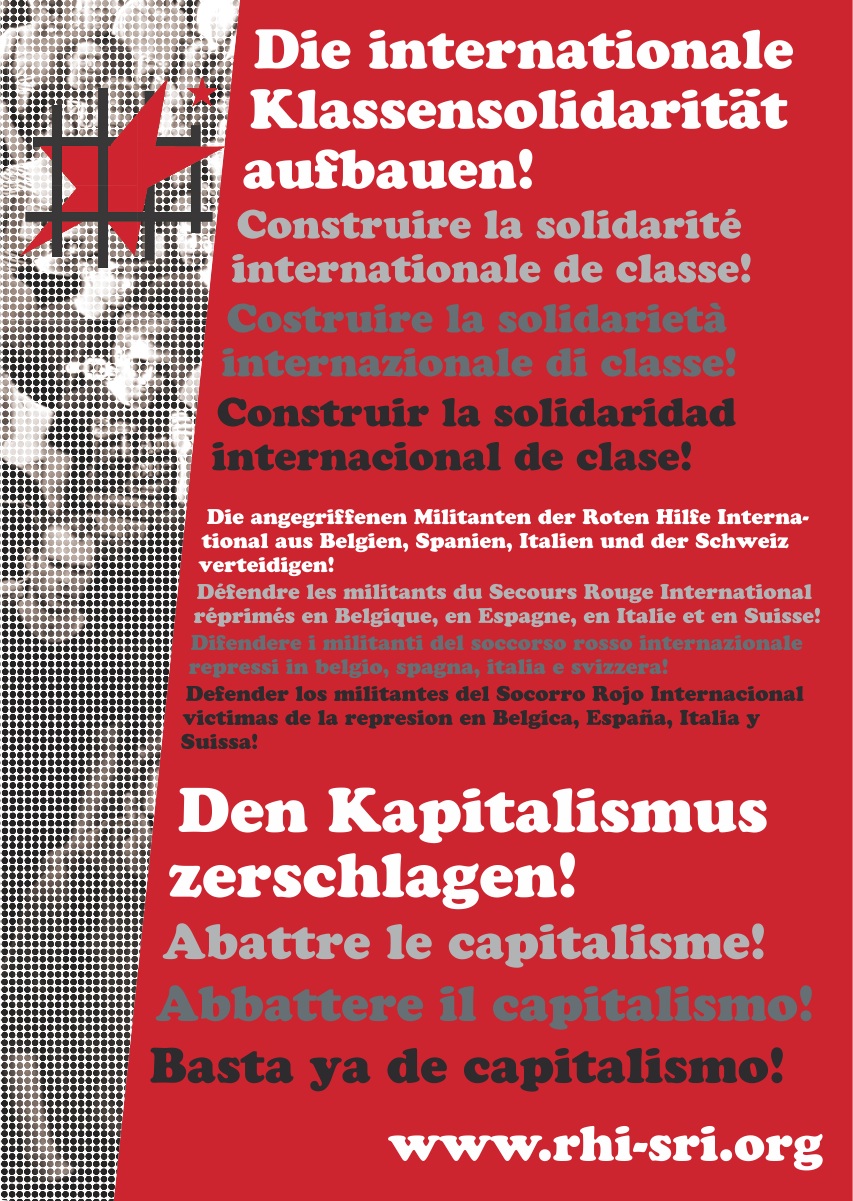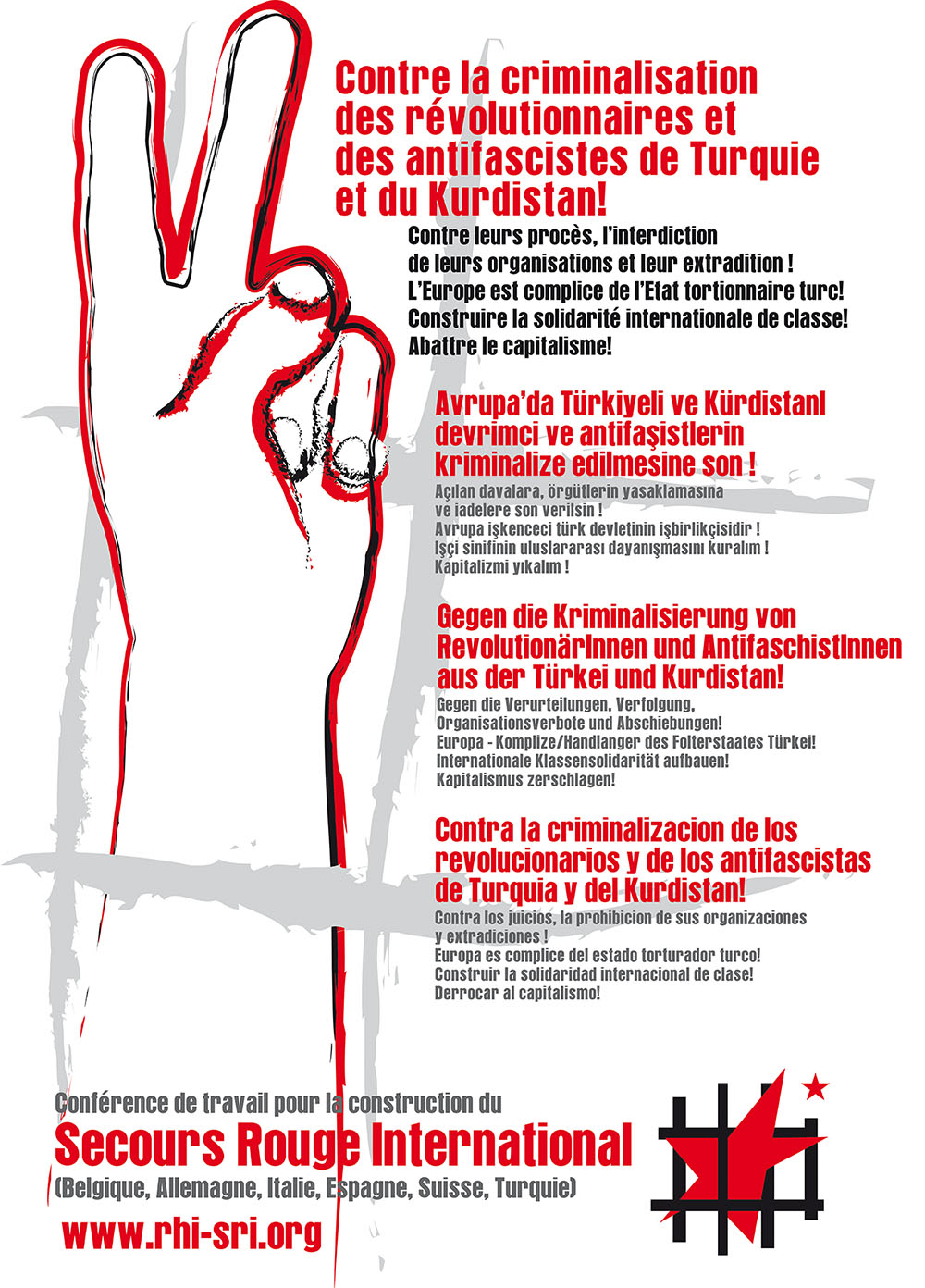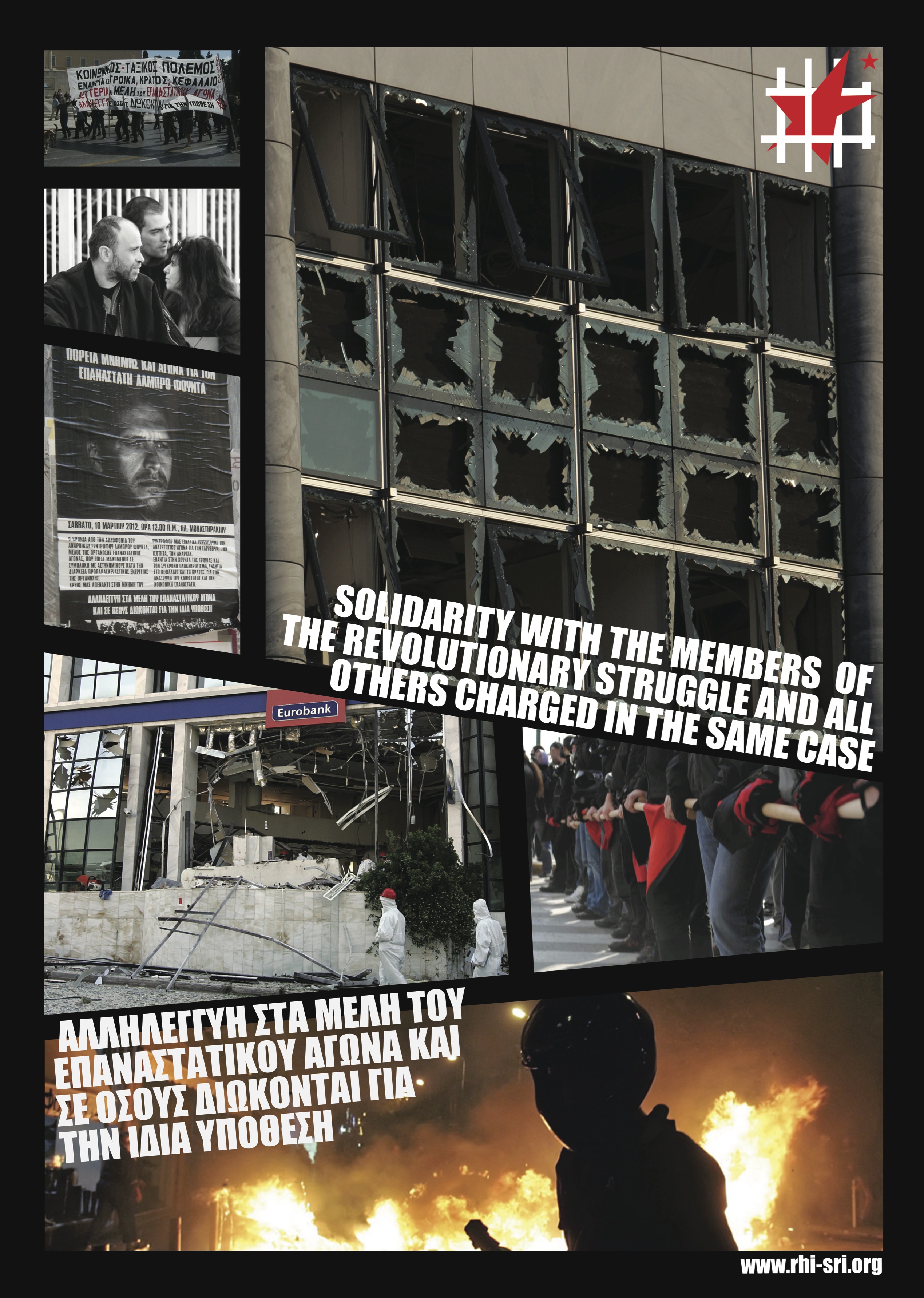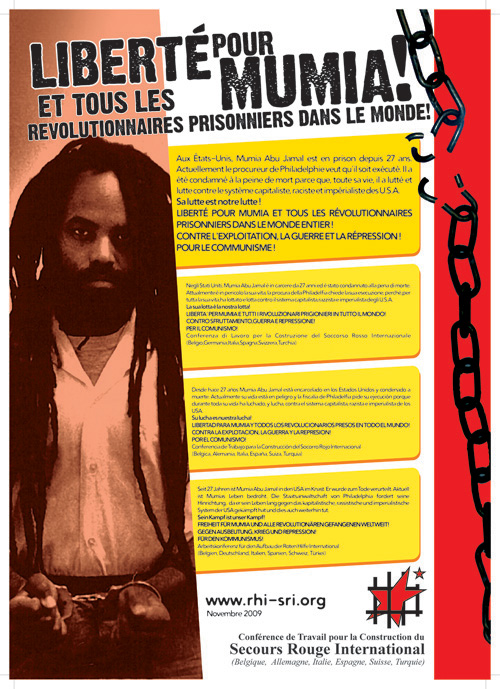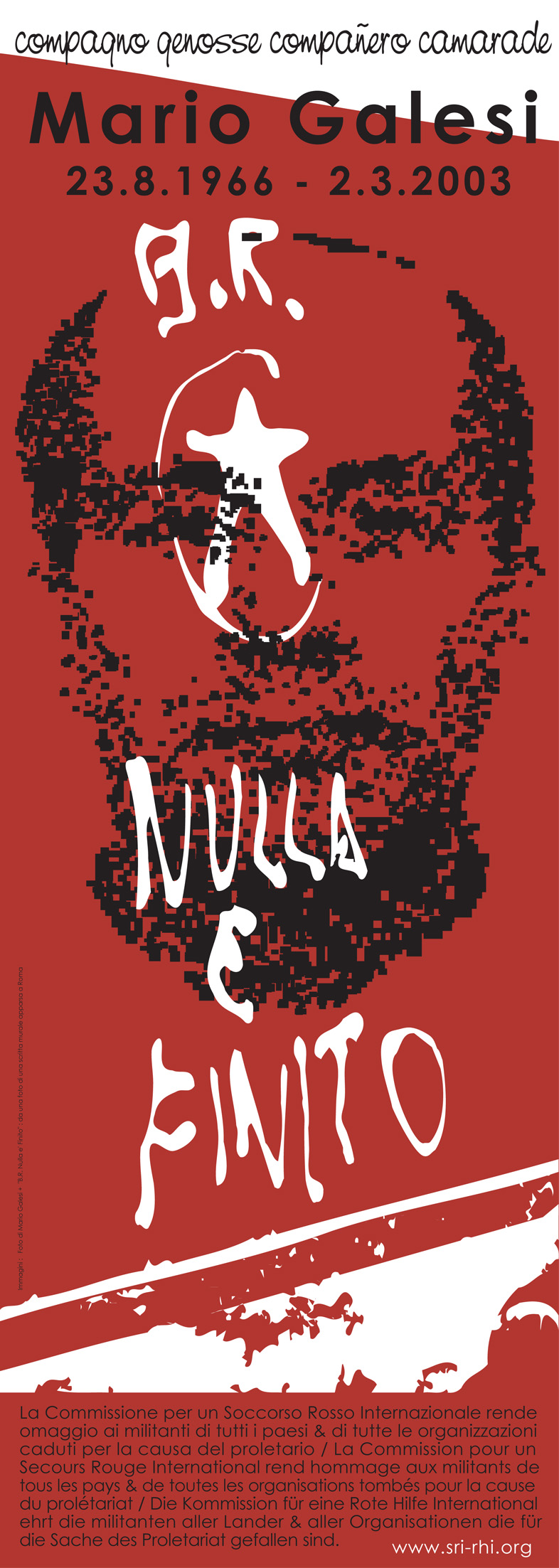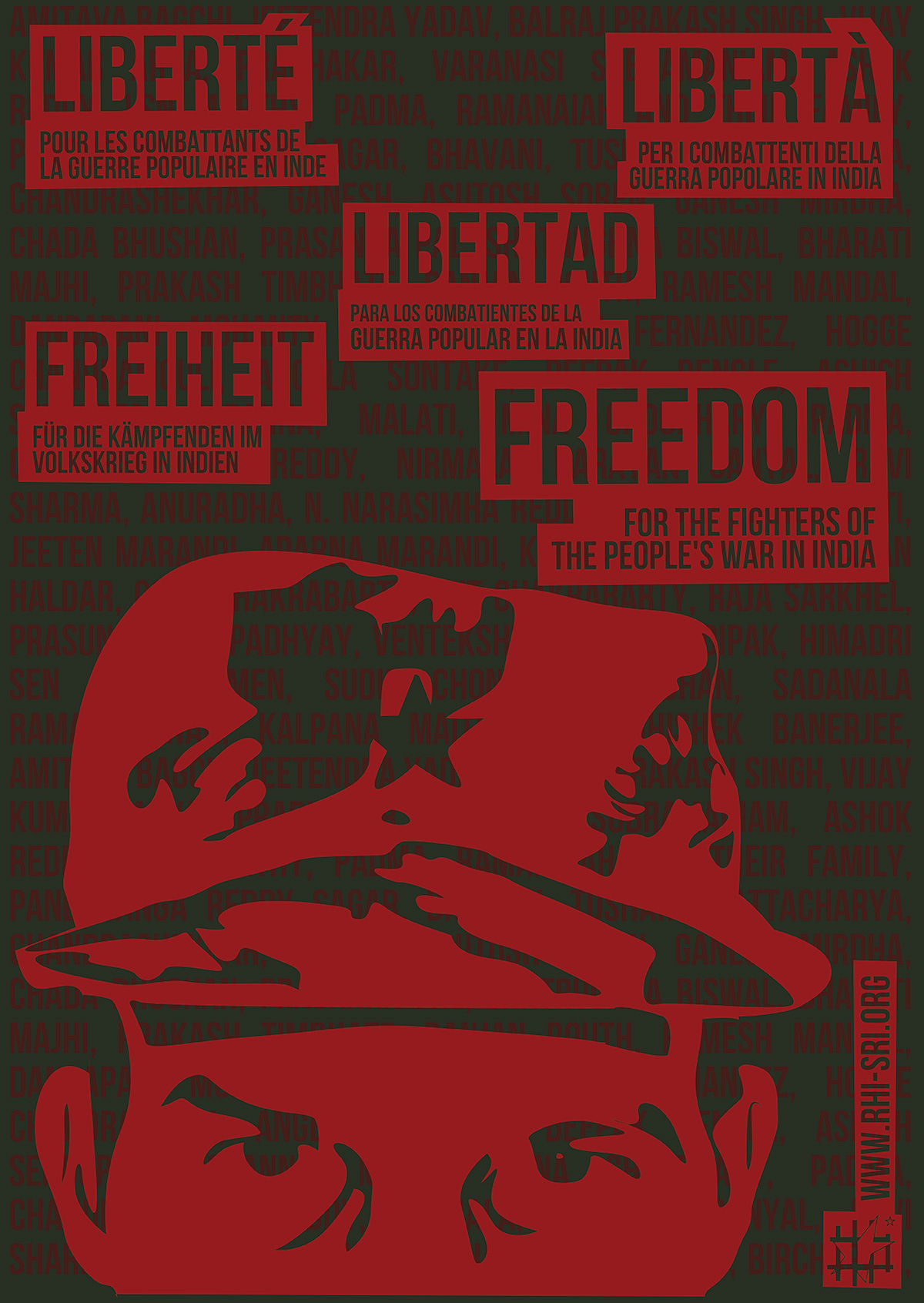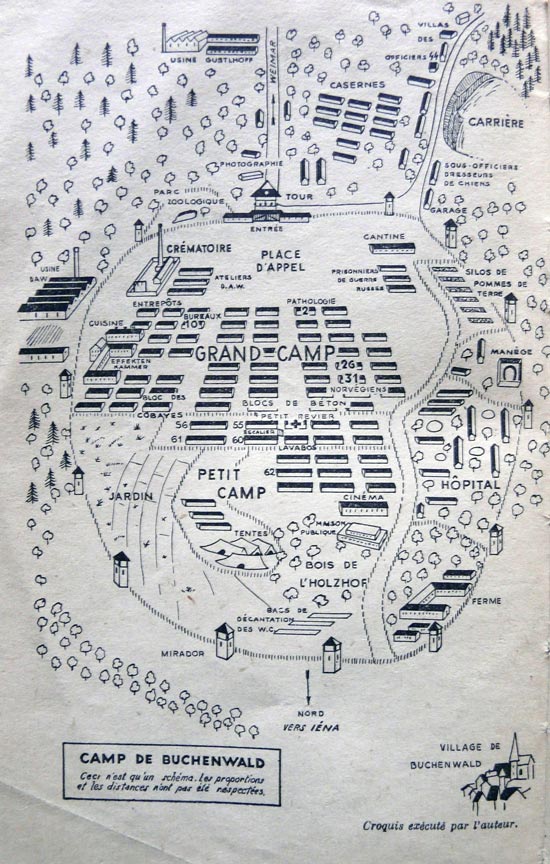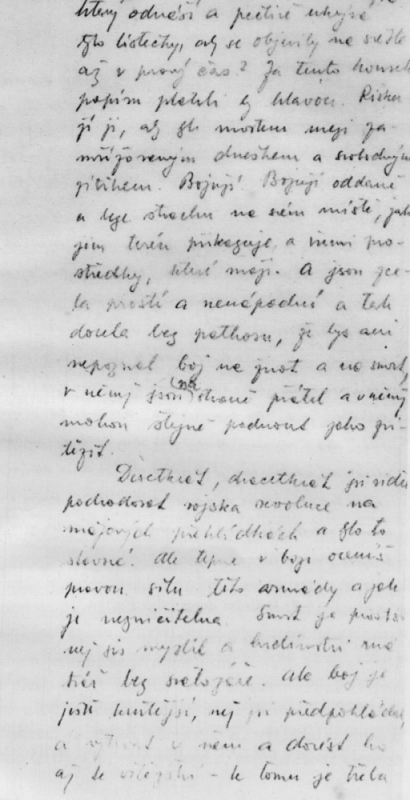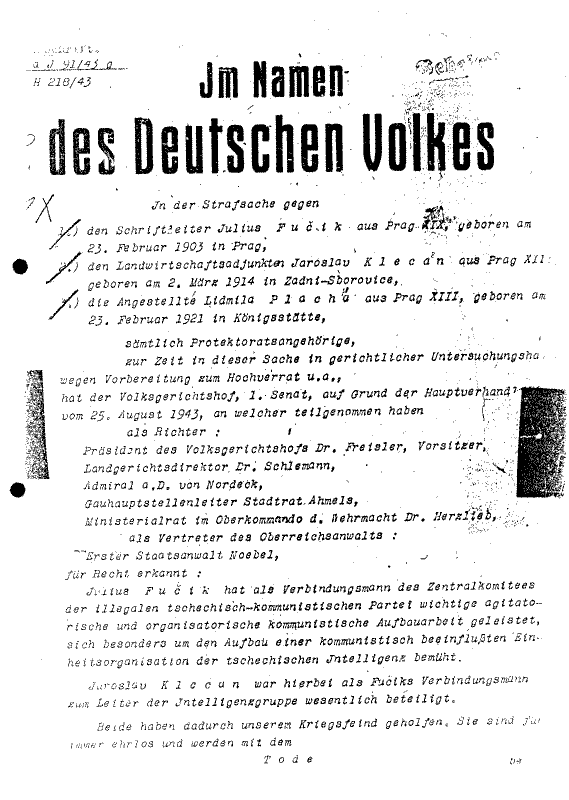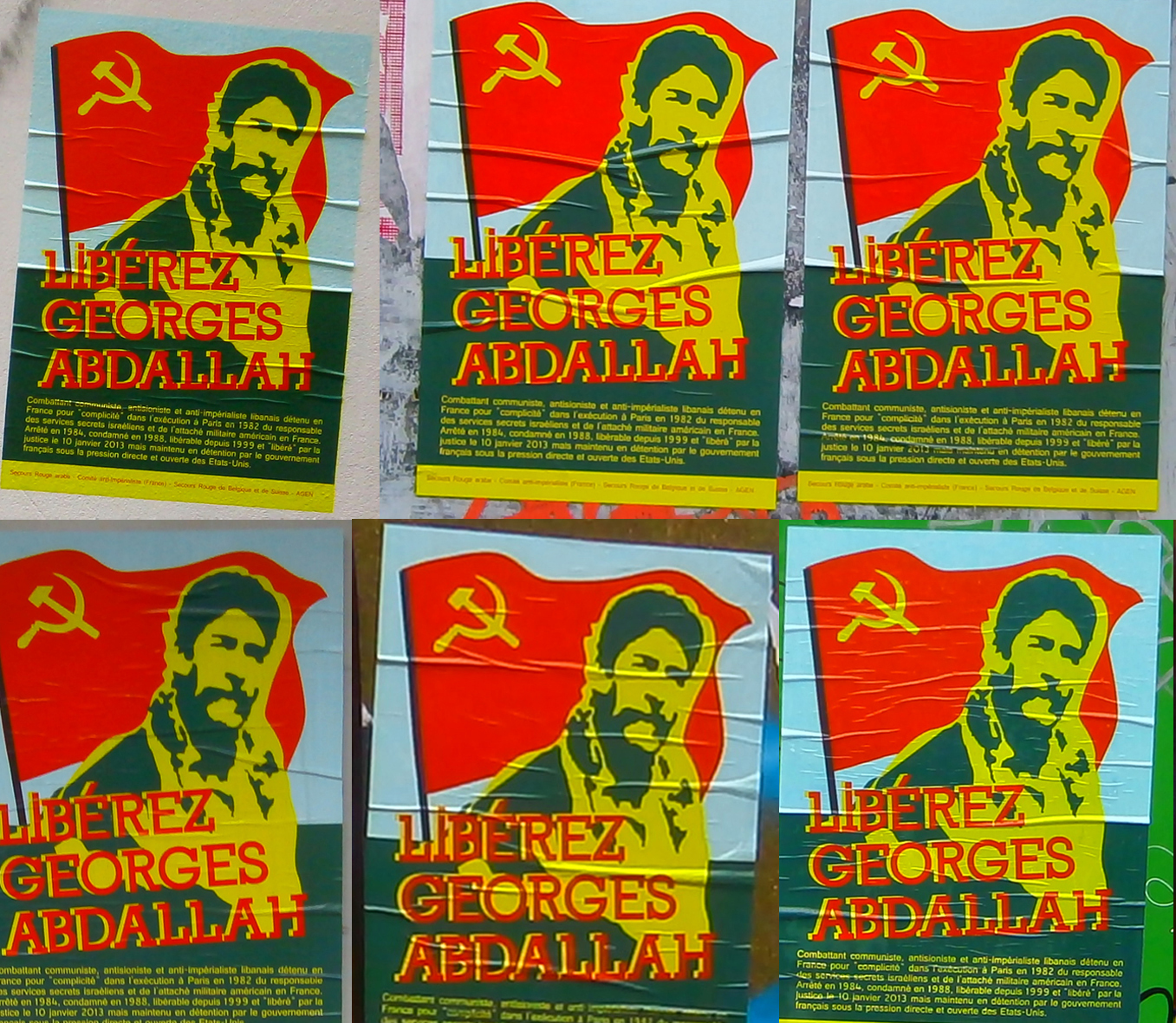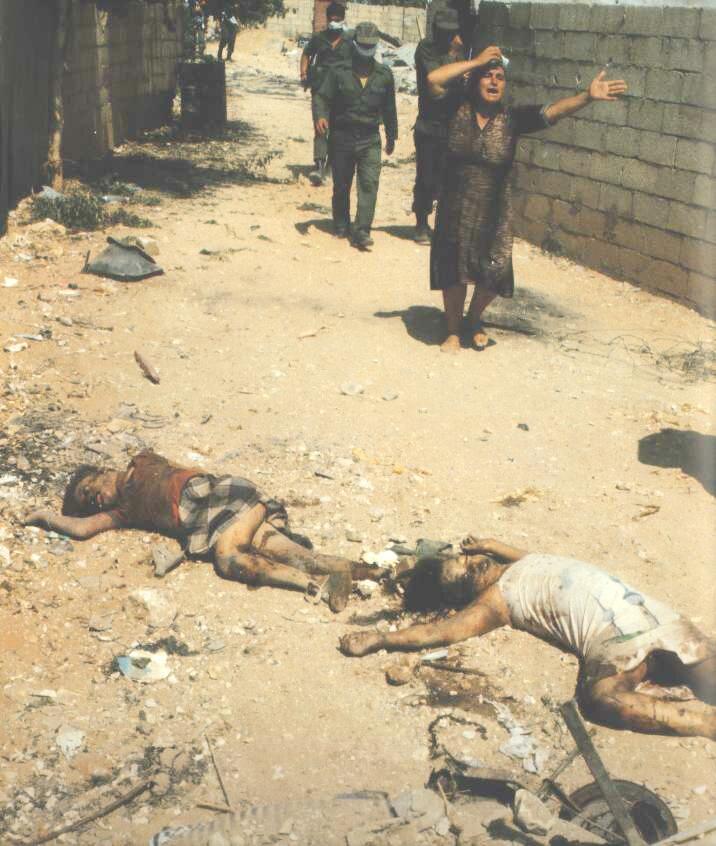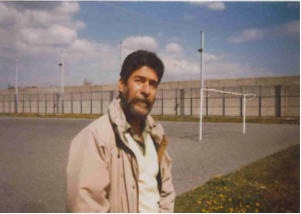Biographie d’Arundhati Roy
Arundhati Roy est née en 1961 d’une mère militante pour les droits de la femme et d’un père planteur de thé. Avant de pouvoir gagner sa vie de sa plume, elle a multiplié les petits boulots, notamment dans le monde du cinéma (grâce à son second mari) et de la télévision. Mais elle a également travaillé dans des hôtels de New Delhi, où elle vit toujours aujourd’hui. C’est en 1996 que Roy est projetée sur le devant de la scène internationale à la publication de son premier roman The God of Small Things, vainqueur de plusieurs prix littéraires et gros succès commercial, ce qui lui a permis de se consacrer totalement à l’écriture. Dès lors, elle décide de s’engager dans la rédaction d’essais politiques et de non-fictions, publiant deux collections de textes, tout en militant pour des causes sociales.

Arundhati Roy
Elle est une des porte-parole du mouvement anti-globalisation et une critique véhémente de l’impérialisme. Elle critique également ouvertement l’actuelle approche de l’industrialisation et du développement rapide menée par le gouvernement indien, en ce y compris les grands projets des compagnies étrangères soutenues par le gouvernement de l’Etat. Son militantisme lui a notamment valu d’être condamnée en 2002 par la Cour Suprême alors qu’elle s’opposait publiquement à un projet de barrage qui allait exproprier un demi million de personnes sans aucune compensation. Engagée pour son peuple et la sauvegarde des minorités nationales, Roy se mobilise également au niveau international, notamment contre la politique étrangère des Etats-Unis et les prises de positions d’Israël.
‘Ma marche avec les camarades’
En février 2010, de manière inopinée, Arundhati Roy a décidé de se rendre dans les circonscriptions interdites des forêts de Dandakaranya du centre de l’Inde, berceau d’un mélange de tribus, dont beaucoup de membres ont pris les armes les grandes sociétés minières, l’Etat et leurs diverses polices et milices. Elle a enregistré en détail la première ‘rencontre’ journalistique directe avec les guérilleros armés, leurs familles et camarades, avec lesquels elle a ratissé les forêts durant des semaines à ses propres risques et périls.
Cet essai a été publié le vendredi 19 mars 2010 dans le ‘Outlook Magazine’ de Delhi et traduit par les soins du Secours Rouge de Belgique. Toutes les notes de bas de page sont de la traductrice.
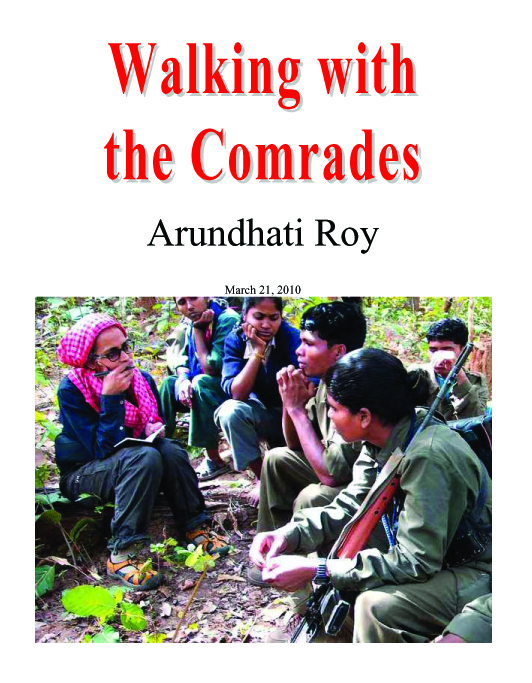
Jaquette de Walking with the Comrades
La note sommaire tapée à la machine glissée sous ma porte dans une enveloppe scellée a confirmé mon rendez-vous avec la Plus Grande Menace pour la Sécurité Intérieure de l’Inde [[Allusion à la déclaration du Premier Ministre Manmohan Singh, désignant l’insurrection maoïste comme ‘la plus grande menace’ que connaissait l’Inde]]. Cela faisait des mois que j’attendais d’avoir de leurs nouvelles.
Je devais me trouver au temple Ma Danteshwari de Dantewara, dans l’Etat du Chhattisgarh, à n’importe lequel des quatre moments donnés sur deux jours. C’était ainsi pour tenir compte du mauvais temps, des crevaisons, des blocus, des grèves du transport et de la pure malchance. La note disait: «L’écrivain devra avoir un appareil photo, un tilak (marque sur le front des hindous) et une noix de coco. La personne à rencontrer aura une casquette, le magazine ‘Hindi Outlook’ et des bananes. Mot de passe: Namashkar Guruji».
Namashkar Guruji. Je me demandais si elle attendrait un homme. Et si je devais me procurer une moustache.
Il y a beaucoup de façons de décrire Dantewara. C’est un oxymore. C’est une ville frontalière posée violemment au cœur de l’Inde. C’est l’épicentre d’une guerre. C’est une ville renversée, à l’envers.
A Dantewara, la police porte des vêtements quelconques et les rebelles portent des uniformes. Le directeur de la prison est en prison. Les prisonniers sont libres (300 d’entre eux se sont échappés de la prison de la vieille ville il y a deux ans). Les femmes qui ont été violées se trouvent en garde à vue. Les violeurs font des discours au bazar.
En face de la rivière Indravati, dans la région contrôlée par les maoïstes se trouve l’endroit que la police appelle ‘Pakistan’ [[Le Pakistan est un pays traditionnellement ennemi de l’Inde]]. Là, les villages sont vides, mais la forêt est pleine de gens. Les enfants qui devraient être à l’école courent dans la nature. La guerre mortelle qui se déroule dans la jungle, est une guerre dont le gouvernement est à la fois fier et effrayé.
L’Opération Green Hunt a été à la fois proclamée et niée. P. Chidambaram, Ministre de l’Intérieur de l’Inde (et qui dirige cette guerre) dit qu’elle n’existe pas, que c’est une invention médiatique. Et cependant, des fonds considérables lui ont été attribués et des dizaines de milliers de policiers et paramilitaires sont mobilisées pour elle. Bien que le théâtre de la guerre soient les jungles du centre de l’Inde, elle aura des conséquences pour nous tous.
Si les fantômes sont les esprits persistants de quelqu’un, ou de quelque chose qui a cessé d’exister, alors peut-être que la nouvelle autoroute à quatre voies qui s’écrase dans la forêt est le contraire d’un fantôme. Peut-être que c’est le présage de ce qui doit encore arriver.
Les antagonistes dans la forêt sont différents et inégaux à presque tous les niveaux. D’un côté, il y a une force paramilitaire massive, armée avec l’argent, la puissance de feu, les médias et la démesure d’une superpuissance émergente.
De l’autre côté, il y a des villageois ordinaires armés avec des armes traditionnelles, soutenus par la force de combat d’une guérilla maoïste superbement organisée et grandement motivée, avec une histoire extraordinaire et violente de rébellion armée. Les maoïstes et les paramilitaires sont de vieux adversaires qui ont combattu leurs vieux avatars respectifs plusieurs fois dans le passé: à Telegana dans les années 50, dans le Bengale occidental, le Bihar, à Srikakulam dans l’Andhra Pradesh à la fin des années 60 et dans les années 70, et puis encore dans l’Andhra Pradesh, le Bihar et le Maharashtra depuis les années 80 et tout le temps jusqu’à aujourd’hui.
Ils connaissaient bien les tactiques des uns et des autres, et ont étudié de près les manuels de combat des uns et des autres. A chaque fois, il a semblé que les maoïstes (ou leurs avatars précédents) n’avaient pas seulement été battus, mais littéralement, physiquement exterminés. Chaque fois, ils sont réapparus, plus organisés, plus déterminés et plus influents que jamais. Aujourd’hui une fois encore, l’insurrection s’est répandue à travers les forêts riches en minéraux du Chhattisgarh, du Jharkhand, de l’Orissa et du Bengale occidental – patrie de millions de tribaux indiens, pays de rêve du monde de l’entreprise.
Il est plus facile pour la conscience libérale de croire que la guerre dans les forêts est une guerre entre le gouvernement et les maoïstes, qui qualifient les élections de comédie, le parlement de porcherie et qui ont ouvertement déclaré leur intention de renverser l’Etat indien. Il est commode d’oublier que les populations tribales du centre de l’Inde ont une histoire de résistance qui date de plusieurs siècles avant Mao (C’est bien sûr une banalité : si elles n’avaient pas cette histoire, elles n’existeraient plus !). Les Ho, les Oraon, les Kols, les Santhals, les Mundals et les Gonds se sont tous rebellés plusieurs fois, contre les Britanniques, les zamindars (percepteurs de l’impôt à l’époque des empereurs [[Les empereurs moghols, dont le dernier est détrôné par les colonialistes Britanniques en 1858. Ceux-ci transformèrent la classe des zamindars en propriétaires terriens (aux dépens des communautés indigènes qui possédaient collectivement la terre) qui ont servi d’intermédiaires pour l’exploitation coloniale)]] et les usuriers.
Les rébellions ont été cruellement écrasées, plusieurs milliers de personnes tuées, mais la population n’a jamais été conquise. Même après l’indépendance, les populations tribales ont été au cœur du premier soulèvement qui pourrait être qualifié de maoïste, dans le village de Naxalbari au Bengale occidental (où le mot naxalite – aujourd’hui utilisé de manière interchangeable avec ‘maoïste’ – trouve son origine). Depuis lors, les politiques naxalites ont été inextricablement mêlées aux soulèvements tribaux, ce qui en dit long sur les tribaux autant que sur les naxalites.
L’héritage de cette révolte a laissé derrière lui une population furieuse qui a été délibérément isolée et marginalisée par le gouvernement indien. La Constitution indienne, fondement moral de la démocratie indienne, a été adoptée par le parlement en 1950. Cela a été un jour tragique pour les peuples tribaux. La Constitution a approuvé la politique coloniale et a fait du gouvernement le gardien des patries tribales. Du jour au lendemain, elle a transformé l’ensemble de la population tribale en squatteurs de leur propre terre. Elle les a privés de leurs droits traditionnels sur les produits forestiers, elle a criminalisé toute une manière de vivre. En échange du droit de vote, elle les a spoliés de leur droit à la subsistance et à la dignité.
Les ayant dépossédés et poussés dans une spirale descendante de l’indigence, par un tour de passe-passe cruel, le gouvernement a commencé à utiliser leur propre misère contre eux. A chaque fois qu’il a eu besoin de déplacer une large population – pour des barrages, des projets d’irrigation, des mines – il a parlé ‘d’adapter les tribaux àl a tendance dominante ou de leur donner ‘les fruits du développement moderne’. La grande majorité des dizaines de millions de personnes déplacées (plus de 30 millions rien que pour les grands barrages), réfugiés du ‘progrès’ indien, sont des tribaux. Lorsque le gouvernement commence à parler de bien-être pour les tribaux, il est temps de s’inquiéter.
L’expression de la préoccupation la plus récente est venue du Ministre de l’Intérieur qui dit qu’il ne souhaite pas une population tribale vivant dans un ‘musée des cultures’. Le bien-être des tribaux ne semblait pas être une telle priorité durant sa carrière d’avocat des sociétés, représentant les intérêts de plusieurs entreprises minières majeures. Cela pourrait être une idée pour mieux comprendre les fondements de sa nouvelle angoisse.
Au cours de ces cinq dernières années environ, les gouvernements du Chhattisgarh, du Jharkhand, de l’Orissa et du Bengale occidental ont signé des centaines de MOU (Memorandum of Understanding – Protocole d’entente) avec des sociétés pour plusieurs milliards de dollars, tous secrets, pour des aciéries, des usines d’éponges de fer [[Matériau créé à partir de minerai de fer par un processus de réduction grâce à l’usage d’un gaz émis par le charbon]], des usines d’énergie, des raffineries d’aluminium, des barrages et des mines. Afin que ces MOU se transforme en argent, les tribaux doivent être déplacés.
Par conséquent, cette guerre.
Lorsqu’un pays qui s’appelle lui-même une démocratie déclare ouvertement la guerre au sein de ses propres frontières, à quoi ressemble cette guerre? La résistance a-t-elle une chance quelconque? Devrait-elle en avoir une? Qui sont les maoïstes? Sont-ils simplement des nihilistes violents fourguant une idéologie démodée aux populations tribales, les poussant à une insurrection sans espoir? Quelles leçons ont-ils appris de leur expérience passée? La lutte armée est-elle intrinsèquement non démocratique? La Théorie du Sandwich – des tribaux ‘ordinaires’ coincés entre le feu de l’Etat et celui des maoïstes – est-elle une théorie exacte? Les ‘maoïstes’ et les ‘tribaux’ sont-ils deux catégories totalement distinctes comme cela est affirmé? Leurs intérêts convergent-ils? Ont-ils appris quoi que ce soit l’un de l’autre? Se sont-ils changés l’un l’autre?
La veille de mon départ, ma mère a appelé, elle semblait fatiguée. «J’ai pensé» a-t-elle dit, avec un instinct maternel étrange, «que ce dont ce pays a besoin, c’est d’une révolution».
Un article sur internet dit que le Mossad israélien est en train de former 30 officiers de police haut gradés indiens aux techniques des assassinats ciblés, pour décapiter l’organisation maoïste. Il y a une discussion dans la presse à propos du nouveau matériel qui a été acheté à Israël: détecteurs télémétriques à laser, équipement d’imagerie thermique et les drones si populaires grâce à l’armée américaine. Armes parfaites à utiliser contre les pauvres.
Le trajet de Raipur à Dantewara prend environ dix heures à travers des régions connues pour être ‘infestées de maoïstes’. Il n’y a pas de mots innocents. ‘Infester/infection’ suppose ‘maladie/parasites’. Les maladies doivent être soignées. Les parasites doivent être exterminés. Les maoïstes doivent être anéantis. De cette manière rampante et inoffensive, le langage du génocide est entré dans notre vocabulaire.
Pour protéger les autoroutes, les forces de sécurité ont ‘sécurisé’ une largeur de bande étroite de forêt de chaque côté. Plus loin à l’intérieur, il y a l’empire de ‘Dada log’. Les Frères. Les Camarades.
Dans la banlieue de Raipur, un énorme panneau d’affichage fait la publicité de l’hôpital du cancer de Vedanta (la compagnie pour laquelle notre Ministre de l’Intérieur a un jour travaillé). Dans l’Orissa, où elle extrait la bauxite, Vedanta finance une université. Par ces manières rampantes et inoffensives, les sociétés minières pénètrent nos imaginations: les Doux Géants qui se soucient vraiment de nous. Cela s’appelle la CSR, Corporate Social Responsibility (Responsabilité Sociale des Entreprises). Cela permet aux exploitations minières d’apparaître comme l’acteur légendaire et ancien Ministre en Chef, qui aimait jouer tous les rôles dans les films mythologiques Telugu – les bons gars et les mauvais gars, tout en une fois, dans le même film. Cette CSR masque les réalités économiques scandaleuses qui sous-tendent le secteur minier en Inde. Par exemple, selon le récent Rapport Lokayukta pour Karnakata, pour chaque tonne de minerai de fer extraite par une compagnie privée, le gouvernement reçoit une royalty de 27 roupies et la compagnie minière s’en fait 5.000. Dans les secteurs de la bauxite et de l’aluminium, les chiffres sont encore pires. Nous parlons de vol à la lumière du jour à hauteur de milliards de dollars. Assez pour acheter des élections, des gouvernements, des juges, des journaux, des chaînes de télévision, des ONG et des agences d’aide. Qu’est-ce alors qu’un hôpital du cancer, ici et là?
Je ne me souviens pas avoir vu le nom de Vedanta sur la longue liste des MOU signées par le gouvernement du Chhattisgarh. Mais je suis assez tordue pour soupçonner que s’il y a un hôpital du cancer, il doit y avoir une montagne au sommet plat pleine de bauxite quelque part.
Nous dépassons Kanker, réputé pour sa Counter Terrorism & Jungle Warfare Training School (Ecole de formation au contre-terrorisme et à la guerre de jungle) dirigée par le général de brigade B K Ponwar, le Rumpelstiltskin (un personnage de conte) de cette guerre, chargé de la mission de transformer des policiers corrompus et peu soignés (la paille) en commandos de la jungle (l’or). «Combattre la guérilla comme la guérilla», la devise de l’école de formation à la guerre, est peinte sur les pierres.
On apprend aux hommes à courir, à glisser, à monter et à descendre d’hélicoptères en vol, à monter à cheval (ça peut toujours servir), à manger des serpents et à vivre de la jungle. Le général de brigade est très fier de former des chiens de rue à combattre les ‘terroristes’. 800 policiers sont diplômés de l’école de formation à la guerre toutes les six semaines. Vingt écoles semblables sont planifiées à travers toute l’Inde. La force de police est graduellement transformée en armée. (Dans le Cachemire [[Le Cachemire est le théâtre d’une lutte armée séparatiste, et sous la loi martiale]], c’est l’inverse : l’armée est transformée en force de police bouffie, bureaucratique). A l’envers. A l’endroit. Quoi qu’il en soit, l’Ennemi, c’est le Peuple.
Il est tard. Jagdalpur dort, excepté les nombreux panneaux d’affichages de Rahul Gandhi [[Fils de Rajiv et Sonia Gandhi, petit-fils d’Indira Gandhi (ex-premier ministre) et arrière-petit-fils de Jawaharlal Nehru (ex-premier ministre) est secrétaire général du Parti du Congrès depuis mars 2008]] demandant aux gens de rejoindre au Congrès de la Jeunesse. Il s’est rendu dans le Bastar deux fois ces derniers mois, mais n’a pas dit grand chose à propos de la guerre. Elle est probablement trop désordonnée pour que le Prince du Peuple ne s’en mêle à ce stade. Ses gestionnaires médiatiques doivent décidé de la mettre en sourdine. Le fait que la Salwa Judum [[‘Chasse de Purification’, milice anti-guérilla, armée par les pouvoirs publics mais financées par les grands propriétaires et les enterprises minières, connue pour ses exactions]] – le groupe d’autodéfense épouvantable parrainé par le gouvernement, responsable de viols, d’assassinats, d’incendies de villages et d’expulsion de centaines de milliers de personnes de leurs maisons – est dirigé par Mahendra Karma, membre du Congrès, ne joue pas un grand rôle dans la publicité soigneusement orchestrée autour de Rahul Gandhi.
Je suis arrivée au temple Ma Danteshwari bien à l’heure pour mon rendez-vous (premier jour, première apparition). J’avais mon appareil photo, ma petite noix de coco et une tilak de poudre rouge sur mon front. Je me suis demandée si quelqu’un me regardait et rigolait. Quelques minutes plus tard, un jeune garçon m’a approchée. Il avait une casquette et un cartable d’écolier sur le dos. Du verni rouge ébréché sur les ongles de ses doigts. Pas de ‘Hindi Outlook’, pas de bananes. «Etes-vous celle qui doit entrer?» m’a-t-il demandé. Pas de Namashkar Guruji. Je ne savais pas quoi dire. Il a sorti une note trempée de sa poche et me l’a donnée. Elle disait «Outlook nahi mila» (N’ai pas pu trouver d’Outlook). «Et les bananes?» «Je les ai mangées» m’a-t-il dit, «j’ai eu faim».
Une vraie menace pour la sécurité.
Son sac à dos disait Charlie Brown – pas votre imbécile habituel [[Allusion à un politicien indien]]. Il a dit que son nom était Mangtu. J’ai rapidement appris que Dandakaranya, la forêt dans laquelle j’étais prête à entrer, était pleine de gens qui avaient de nombreux noms et des identités changeantes. Cette idée était comme un baume pour moi. Quel bonheur de ne pas être coincé avec soi-même, de devenir quelqu’un d’autre pour un moment.
Nous avons marché jusqu’à l’arrêt de bus, seulement à quelques minutes du temple. Il était déjà bondé. Les choses se sont passées très vite. Il y avait deux hommes sur des motos. Il n’y a pas eu de conversation – juste un regard de reconnaissance, un déplacement du poids du corps, la montée en régime des moteurs. Je n’avais aucune idée d’où nous allions. Nous avons dépassé la maison du commissaire de police, que j’ai reconnue de ma précédente visite. Le commissaire était un homme franc. «Vous voyez m’dame, pour parler franchement, ce problème ne peut pas être résolu par nous, policiers et militaires. Le problème avec ces tribaux, c’est qu’ils ne comprennent pas l’avidité. A moins qu’ils ne deviennent gourmands, il n’y a aucun espoir pour nous. J’ai dit à mon chef, enlevez la force, et à la place, mettez une TV dans chaque maison. Tout se règlera automatiquement».
En un rien de temps, nous roulons hors de la ville. Pas de bouchons. Ca a été un long trajet, trois heures selon ma montre. Nous nous sommes arrêtés brutalement au milieu de nulle part, sur une route vide longée par la forêt des deux côtés. Mangtu est descendu. Moi aussi. Les motos sont parties et j’ai ramassé mon sac à dos pour suivre la petite menace pour la sécurité intérieure dans la forêt. C’était une journée magnifique. Le sol de la forêt était un tapis d’or.
Après un moment, nous avons émergé sur les rives blanches et sableuses d’une large rivière calme. Elle était manifestement alimentée par la mousson, et donc maintenant, c’était plus ou moins du sable plat, avec au centre un courant ne dépassant pas la cheville, facile à traverser. De l’autre côté se trouve le ‘Pakistan’. «Là-bas m’dame» m’avait dit le policier franc, «mes hommes tirent pour tuer». Je me suis souvenue de ça comme nous commencions à traverser. Je nous ai vus dans le viseur d’un fusil d’un policier – minuscules silhouettes dans le paysage, faciles à abattre. Mais Mangtu semblait assez peu inquiet, et j’ai pris modèle sur lui.
Nous attendant sur l’autre rive, en T-shirt vert citron marqué Horlicks! se trouvait Chandu. Une menace pour la sécurité légèrement plus vieille. Peut-être 20 ans. Il avait un sourire mignon, un vélo, un bidon avec de l’eau bouillie et de nombreux paquets de biscuits au glucose pour moi, de la part du Parti. Nous avons repris notre souffle et recommencé à marcher de nouveau. Il s’est avéré que le vélo était un moyen pour brouiller les pistes. Le chemin était pratiquement entièrement non-cyclable. Nous avons escaladé des collines abruptes et descendu des chemins empierrés le long de corniches vraiment précaires. Lorsqu’il ne pouvait pas le pousser, Chandu soulevait le vélo et le transportait au-dessus de sa tête comme s’il ne pesait rien. J’ai commencé à m’interroger à propos de son air ahuri de garçon de village. J’ai découvert (beaucoup plus tard) qu’il pouvait manier n’importe quel type d’arme, «excepté le LMG [[Mitrailleuse légère (généralement munie d’un bipied)]]» m’a-t-il informé joyeusement.
Trois magnifiques hommes bien imbibés, avec des fleurs dans leur turban, ont marché avec nous durant environ une demi-heure, avant que nos chemins ne se séparent. Au coucher du soleil, leurs sacs en bandoulière ont commencé à chanter. Ils avaient des coqs dedans, qu’ils avaient apportés au marché mais n’avaient pas réussi à vendre.

Forêt de Dandkaranya
Chandu semble être capable de voir dans le noir. Je dois utiliser ma lampe électrique. Les grillons se mettent en marche, et bientôt il y a un orchestre, un dôme de son au-dessus de nous. Il me tarde de regarder le ciel nocturne, mais je n’ose pas. Je dois garder mes yeux au sol. Un pas à la fois. Concentrée.
J’entends des chiens. Mais je ne peux pas dire à quelle distance ils sont. Le terrain s’aplanit. Je vole un coup d’œil vers le ciel. Cela me met en extase. J’espère que nous allons nous arrêter bientôt. «Bientôt» dit Chandu. Cela s’avère être un peu plus d’une heure. Je vois les silhouettes d’énormes arbres. Nous arrivons.
Le village semble spacieux, les maisons sont très éloignées les unes des autres. La maison dans laquelle nous entrons est magnifique. Il y a un feu, autour duquel quelques personnes sont assises. Plus de gens dehors, dans l’obscurité. Je ne peux pas dire combien. Je peux juste plus ou moins les discerner. Un murmure circule. Lal Salaam Kaamraid (Salutations rouges, Camarade). Lal Salaam, je dis. Je suis au-delà de la fatigue. La femme de la maison m’appelle à l’intérieur et me donne du poulet au curry cuit dans des haricots verts et du riz rouge. Fabuleux. Son bébé est endormi à côté de moi, ses bracelets de cheville argentés brillent à la lumière du feu.
Après le dîner, j’ouvre la fermeture éclair de mon sac de couchage. C’est une intrusion étrange de son, cette grosse tirette. Quelqu’un allume la radio. Service de la BBC en Hindi. L’Eglise anglicane a retiré ses fonds du projet Niyamgiri de Vedanta, invoquant la dégradation de l’environnement et les violations des droits de la tribu Dongria Kondh. Je peux entendre les clochettes du bétail reniflant, traînant, pétant. Tout va bien dans le monde. Mes yeux se ferment.
Nous sommes debout à 5 heures. Sur la route à 6. Après deux heures, nous traversons une nouvelle rivière. Nous marchons à travers de magnifiques villages. Chaque village a sa famille de tamariniers qui le surveille, comme une étreinte d’énormes dieux bienveillants. Doux tamarinier du Bastar. A 11 heures, le soleil est haut, et la marche moins amusante. Nous nous arrêtons dans un village pour dîner.

Pause repas des guérilleros
Chandu semble connaître les gens dans la maison. Une sublime jeune fille flirte avec lui. Il a l’air un peu timide, peut-être parce que je suis là. Le dîner est composé de papaye crue avec du masoor dal et du riz rouge. Et de la poudre de piment rouge. Nous allons attendre que le soleil perde un peu de son intensité avant de recommencer à marcher. Nous faisons une sieste dans le belvédère. Ce lieu est d’une beauté spartiate. Tout est propre et nécessaire. Pas de désordre. Une poule noire parade de haut en bas du petit mur de boue. Une grille de bambou stabilise les chevrons du toit de chaume et se double comme un casier de rangement. Il y a un balai d’herbe, deux tambours, un panier tissé rouge, un parapluie cassé et toute une pile de boîtes en carton ondulé aplaties et vides. Quelque chose me saute aux yeux. J’ai besoin de mes lunettes. Voici ce qui est imprimé sur le carton: Emulsion à Haute Energie Explosive Puissance Idéale 90 (Classe-2) SD CAT 22.
Nous recommençons à marcher vers deux heures. Dans le village où nous nous rendons, nous allons rencontrer une Didi (Soeur, Camarade) qui sait ce que sera la prochaine étape du voyage. Chandu ne le sait pas. Il y a aussi une économie de l’information. Personne n’est supposé tout savoir. Mais quand nous atteignons le village, Didi n’est pas là. Il n’y a aucune nouvelle d’elle. Pour la première fois, je vois un petit nuage d’inquiétude s’installer chez Chandu. Un très gros s’installe chez moi. Je ne sais pas quels sont les systèmes de communications, mais que faire s’ils ont mal tourné?
Nous sommes stationnés à l’extérieur d’un immeuble scolaire déserté, un peu en dehors du village. Pourquoi toutes les écoles de village du gouvernement sont-elles construites comme des bastions en béton, avec des volets en fer aux fenêtres et des portes en accordéon coulissantes en fer? Pourquoi pas comme les maisons du village, avec de la boue et de la chaume? Parce qu’elles se dédoublent en casernes et en bunkers. «Dans les villages du Abhujmad» dit Chandu «les écoles sont comme ça…» Il gratte le plan d’un immeuble avec une brindille dans la terre. Trois octogones attachés les uns aux autres comme les alvéoles d’une ruche. «Ainsi ils peuvent tirer dans toutes les directions». Il dessine des flèches pour illustrer son propos, tel un graphique de cricket – la roue du chariot du batteur. Il n’y a aucun professeur dans aucune école, dit Chandu. Ils se sont tous enfuis. Ou les avez-vous chassé? Non, nous ne chassons que la police. Mais pourquoi les professeurs devraient-ils venir ici, dans la jungle, alors qu’ils reçoivent leurs salaires assis à la maison? Un bon point.
Il m’informe que ceci est une ‘nouvelle région’. Le Parti n’y est entré que récemment.
Environ vingt jeunes personnes arrivent, filles et garçons. Adolescents ou au début de la vingtaine. Chandu explique que c’est la milice au niveau du village, le rang le plus bas de la hiérarchie militaire maoïste. Je n’avais jamais vu personne comme eux avant. Ils sont vêtus de saris et de lungis [[Vêtement masculin : pièce de tissus que les hommes ceignent autour de la taille]], certains en uniforme vert olive effiloché. Les garçons portent des bijoux, des coiffures. Certains ont aussi des couteaux, des haches, un arc et des flèches.

Jeune combattant d’une milice villageoise
Un garçon transporte un mortier grossier fabriqué à partir d’un lourd tuyau en acier galvanisé de trois pieds. Il est rempli de poudre à canon et de mitraille et prêt à être mis à feu. Cela fait un grand bruit, mais ne peut être utilisé qu’une seule fois. Tout de même, cela effraye la police, disent-ils en gloussant.
La guerre ne semble pas être la plus grande préoccupation dans leurs esprits. Peut-être parce que cette région est en dehors de l’espace vital de la Salwa Judum. Ils viennent juste de terminer une journée de travail, pour aider à construire une clôture autour de certaines maisons du village pour garder les chèvres hors des champs. Ils sont pleins d’amusement et de curiosité. Les filles sont en confiance et naturelles avec les garçons. J’ai un détecteur pour ce genre de chose, et je suis impressionnée. Leur job, dit Chandu, est de patrouiller et de protéger un groupe de quatre ou cinq villages et d’aider dans les champs, de nettoyer les puits ou de réparer les maisons – faire tout ce qui est nécessaire.
Toujours pas de Didi. Que faire? Rien. Donner un coup de main pour découper et éplucher.
Après le souper, sans beaucoup de discussion, tout le monde se met en rang. Manifestement, nous bougeons. Tout se déplace avec nous, le riz, les légumes, les marmites et les casseroles. Nous quittons l’enceinte de l’école et marchons en file indienne dans la forêt. En moins d’une demi-heure, nous arrivons dans une clairière où nous allons dormir. Il n’y a absolument aucun bruit. En quelques minutes, tout le monde a déplié son drap en plastique bleu, l’omniprésent ‘jhilli’ sans lequel il n’y aurait pas de révolution. Chandu et Mangtu s’en partagent un et en étalent un pour moi. Ils me trouvent la meilleure place, près de la meilleure pierre grise. Chandu dit qu’il a envoyé un message à Didi. Si elle le reçoit, elle sera là dès le début de la matinée. Si elle le reçoit.
C’est la plus belle chambre dans laquelle j’ai dormi depuis longtemps. Ma suite privée dans un hôtel 1000 étoiles. Je suis encerclée par ces enfants étranges et magnifiques avec leur curieux arsenal. Ils sont à coup sûr tous maoïstes. Vont-ils tous mourir? Est-ce que l’Ecole de formation à la guerre dans la jungle est pour eux? Et les hélicoptères de combat, l’imagerie thermique et les télémètres laser?
Pourquoi doivent-ils mourir? Pour quoi? Pour transformer tout ceci en une mine? Je me souviens de ma visite aux mines de minerai de fer à ciel ouvert de Keonjhar, dans l’Orissa. Un jour, il y avait là une forêt. Et des enfants comme ceux-ci. Maintenant, la terre ressemble à une blessure rouge et froide. La poussière rouge empli les narines et les poumons. L’eau est rouge, l’air est rouge, les gens sont rouges, leurs poumons et leurs cheveux sont rouges. Toute la journée et toute la nuit, les camions grondent à travers leur village, pare-choc contre pare-choc, des milliers et des milliers de camions, amenant le minerai de fer au port de Paradip d’où il partira vers la Chine. Là, il sera transformé en voitures, en fumée et en villes champignons. En un ‘taux de croissance’ laissant les économistes hors d’haleine. En armes pour faire la guerre.
Tout le monde est endormi, sauf les sentinelles qui prennent la relève toutes les heures et demi. Enfin, je peux regarder les étoiles. Quand j’étais enfant, grandissant sur les rives de la rivière Meenachal, je pensais que le son des grillons – qui commençait toujours au crépuscule – était le son des étoiles pétaradant, se préparant à briller. Je suis surprise à quel point j’adore être ici. Il n’y a nulle part ailleurs dans le monde où j’aimerais mieux être. Qui devrais-je être ce soir? Kamraid Rahel, sous les étoiles? Peut-être Didi viendra-t-elle demain?
Ils arrivent en début d’après-midi. Je peux les voir de loin. Une quinzaine d’entre eux, tous en uniformes vert olive, courant vers nous. Même de loin, de la façon dont ils courent, je peux dire que ce sont de solides combattants. La Peoples Liberation Guerilla Army (PGLA – Guérilla Armée de Libération du Peuple). A laquelle est destinée l’imagerie thermique et les armes guidées par laser. Pour laquelle a été créée l’Ecole de formation à la guerre de jungle.
Ils transportent des armes sérieuses, INSAS [[Fusil d’assaut nouvelle génération en service dans l’armée indienne depuis les années ’80]], SLR [[Fusil d’assaut indien de la génération précédente (copie du FAL belge)]], deux d’entre eux ont des AK 47 [[C’est-à-dire des kalashnikovs]]. Le dirigeant de la brigade est le Camarade Madhav qui est dans le Parti depuis qu’il a 9 ans. Il est de Warangal, Andhra Pradesh. Il est désolé et se confond en excuses. Il y a eu un manque de communication majeur, dit-il encore et encore, ce qui d’habitude n’arrive jamais. J’étais supposée être arrivée au camp principal dès la première nuit. Quelqu’un a laissé tomber le témoin dans le relais de la jungle. La descente de moto aurait du avoir lieu dans un endroit tout à fait différent. «Nous vous avons fait attendre, nous vous avons fait marcher tellement. Nous avons couru tout le chemin quand le message est arrivé que vous étiez ici». J’ai dit que c’était OK, que j’étais venue en étant prête à attendre, à marcher et à écouter. Il veut partir immédiatement, parce que les gens du camp attendaient et se tracassaient.

Colonne de guérilleros
C’est une marche de quelques heures jusqu’au camp. Il commence à faire noir quand nous arrivons. Il y a plusieurs niveaux de sentinelles et des cercles concentriques de patrouille. Il doit y avoir une centaine de camarades alignés en deux rangs. Tout le monde a une arme. Et un sourire. Ils commencent à chanter: Lal lal salaam, lal lal salaam, aane vaaley saathiyon ko lal lal salaam (Salutations rouges aux camarades qui sont arrivés). C’était chanté mélodieusement, comme s’il s’agissait d’une chanson populaire à propos d’une rivière et de la floraison de la forêt. Avec la chanson, le salut, la poignée de main et le poing fermé. Tout le monde salue tout le monde, murmurant lalslaam, mlalslaa mlalslaam…
Hormis un grand jhilli bleu étalé par terre, sur environ 15 pieds carrés, il n’y a aucun signe de ‘camp’. Celui-ci a aussi un toit jhilli. C’est ma chambre pour la nuit. C’était soit pour me récompenser de mes jours de marche, soit pour me dorloter par avance de ce qui nous attendait. Ou les deux. De toute manière, c’était la dernière fois de tout le voyage que j’allais avoir un toit au-dessus de ma tête. Au cours du souper, j’ai rencontré la Camarade Narmada chargée du Krantikari Adivasi Mahila Sangathan (KAMS) dont la tête est mise à prix, la Camarade Saroja de la PLGA qui est aussi grande que son SLR, la Camarade Maase (ce qui signifie Fille Noire en Gondi) dont la tête est aussi mise à prix, le Camarade Roopi, assistant technique, le Camarade Raja qui est en charge de la Division [[La Division est un niveau de l’organisation politique des zones libérées (voir plus loin)]] à travers laquelle j’avais marché et le Camarade Venu (ou Murali ou Sonu ou Sushil ou tout ce que vous voulez l’appeler), clairement le plus âgé de tous. Peut-être du Comité Central, peut-être même du Bureau Politique. On ne me le dit pas, je ne le demande pas. Entre nous, nous parlons Gondi, Halbi, Telugu, Punjabi et Malayalam. Seule Maase parle anglais (donc, nous communiquons tous en hindi!). La Camarade Maase est grande et tranquille et semble devoir nager à travers une couche de douleur pour entrer dans la conversation. Mais à la manière dont elle me prend dans ses bras, je peux dire que c’est une lectrice. Et qu’elle regrette de ne pas avoir de livres dans la jungle. Elle ne me racontera son histoire que plus tard. Quand elle sentira qu’elle peut me confier sa douleur.
De mauvaises nouvelles arrivent, comme c’est le cas dans cette jungle. Un messager, avec des ‘biscuits’. Des notes manuscrites sur des feuilles de papier, pliées et agrafées en petits carrés. Il y en a un sac entier. Comme des jetons. Des nouvelles de partout. La police a tué cinq personnes dans le village d’Ongnaar, quatre de la milice et un villageois ordinaire: Santhu Pottai (25 ans), Phoolo Vadde (22), Kande Potai (22), Ramoli Vadde (20), Salsai Kuram (22). Ils auraient pu être les enfants dans mon dortoir étoilé de la nuit dernière.
Puis les bonnes nouvelles arrivent. Un petit contingent de personnes avec un jeune homme grassouillet. Il est aussi en treillis, mais il est flambant neuf. Tout le monde l’admire et en commente la coupe. Il semble timide et heureux. C’est un docteur qui est venu pour vivre et travailler avec les camarades dans la forêt. La dernière fois qu’un docteur a visité Dandakaranya, c’était il y a de nombreuses années.
A la radio, il y a des nouvelles de la réunion du Ministre de l’Intérieur avec les Ministres en Chef des Etats affectés par ‘l’extrémisme de gauche’, pour discuter de la guerre. Les Ministres en Chef du Jharkhand et du Bihar sont restés discrets et n’y ont pas assisté. Tout le monde, assis autour de la radio rigole. Au moment des élections, disent-ils, tout au long de la campagne et puis peut-être un mois ou deux après la formation du gouvernement, les politiciens disent tous des choses comme «les naxalites sont nos enfants». On peut régler sa montre sur le moment où ils changeront d’avis et montreront leurs crocs.
Je suis présentée à la Camarade Kamla. On me dit que je ne dois en aucun cas m’éloigner de cinq pieds de ma jhilli sans la réveiller. Tout le monde est désorienté dans le noir et pourrait sérieusement se perdre. (Je ne la réveille pas. Je dors comme une buche). Durant la matinée, Kamla me présente un paquet en polyéthylène jaune dont un coin est coupé. Un jour, il a été utilisé pour contenir de la Abis Gold Refined Soya Oil (huile de soja). Maintenant, c’était ma grande tasse pour aller au petit coin. Rien n’est gaspillé sur la route de la révolution. (Encore aujourd’hui, je pense à la Camarade Kamla tout le temps, chaque jour. Elle a 17 ans. Elle porte à la hanche un pistolet fait main. Et quel sourire. Mais si la police vient vers elle, elle la tuera. Elle pourrait la violer d’abord. Aucune question ne sera posée. Parce qu’elle est une Menace pour la Sécurité Intérieure).
Après le petit-déjeuner, le Camarade Venu (Sushil, Sonu, Murali) m’attend, assis les jambes croisées sur le jhilli, avec son apparence de frêle instituteur de village. Je vais recevoir une leçon d’histoire. Ou plus précisément, une conférence sur l’histoire des trente dernières années dans la forêt de Dandakaranya, qui a abouti dans la guerre qui tourbillonne en elle aujourd’hui. Il ne fait aucun doute que c’est une version partisane. Mais quelle histoire ne l’est pas? Dans tous les cas, l’histoire secrète doit être rendue publique pour être contestée, débattue au lieu que l’on mente simplement à son propos, comme cela se passe actuellement.
Le Camarade Venu a une attitude rassurante et calme, et une voix douce qui émergera, dans les jours à venir, dans un contexte qui me troublera complètement. Ce matin, il parle durant plusieurs heures, pratiquement de manière continue. Il est comme un petit gérant de magasin qui a un énorme trousseau de clés avec lesquelles il peut ouvrir un labyrinthe de casiers remplis d’histoires, de chansons et d’idées.
Le Camarade Venu était dans un des sept bataillons armés qui a traversé le Godavari depuis l’Andhra Pradesh et est entré dans la Forêt de Dandakaranya (DK) en juin 1980, il y a trente ans. Ils appartenaient au Peoples War Group (PWG – Groupe ‘Guerre Populaire’), une faction du Parti Communiste d’Inde – Marxiste-Léniniste (CPI-ML), les premiers naxalites. Le PWG a été officiellement annoncé en tant que parti distinct indépendant en avril cette année-là, sous Kondapalli Seetharamiah. Le PGW a décidé de construire une armée permanente, pour laquelle il aurait besoin d’une base. DK allait devenir cette base, et ces premiers bataillons y ont été envoyés pour reconnaître la région et pour commencer le processus de construction de zones de guérillas. Quant à savoir si les partis communistes devaient avoir une armée permanente et si oui ou non une ‘armée populaire’ est une contradiction dans les termes, c’est un vieux débat. La décision du PWG de construire une armée est venue de son expérience dans l’Andhra Pradesh, où sa campagne « La terre aux paysans » a conduit à un affrontement direct avec les propriétaires terriens et a abouti au type de répression policière à laquelle le Parti a trouvé impossible de résister sans sa propre force combattante entrainée.
En 2004, le PGW a fusionné avec d’autres factions CPI(ML), le Party Unity (PU – Unité du Parti) et le Maoist Communist Center (MCC – Centre Communiste Maoïste), qui fonctionne en grande partie en dehors du Bihar et du Jharkhand. Pour devenir ce qu’il est maintenant, le Parti Communiste d’Inde (Maoïste).
Dandakaranya est une part de ce que les Britanniques, à leur manière d’hommes blancs, ont appelé Gondwana, terre des Gonds. Aujourd’hui, les frontières des Etats de Madhya Pradesh, du Chhattisgarh, de l’Orissa, de l’Andhra Pradesh et du Maharashtra coupent à travers la forêt. Fractionner un peuple gênant en unités administratives distinctes est un vieux procédé. Mais ces maoïstes et Gonds maoïstes ne font pas beaucoup attention à des choses comme les frontières d’Etats. Ils ont des cartes différentes dans leurs têtes, et comme d’autres créatures de la forêt, ils ont leurs propres chemins. Pour eux, les routes ne sont pas conçues pour qu’on marche dessus. Elles sont faites pour être traversées, ou comme c’est de plus en plus le cas, pour tendre des embuscades. Bien que les Gonds (divisés entre les tribus des Koyas et des Dorlas) soient de loin majoritaires, il y a de petites colonies d’autres communautés tribales aussi. Les communautés non-adivasis [[Les adivasis sont les ‘peuples tribaux’]], de marchands et de colons vivent aux bords de la forêt, près des routes et des marchés. Le PGW n’a pas été le premier à venir évangéliser le Dandakaranya. Baba Amte, le célèbre partisan de Gandhi a ouvert son ashram et sa léproserie à Warona en 1975. La mission Ramakrishna avait commencé à ouvrir des écoles de village dans les forêts éloignées d’Abhujmad. Dans le Bastar Nord, le Baba Bihari Das a commencé une campagne agressive pour ‘ramener les tribaux dans le bercail hindou’, ce qui impliquait une campagne pour dénigrer la culture tribale, provoquer la haine de soi et introduire le beau cadeau de l’hindouisme – la caste [[Il existe quatre castes principales. Les castes sont héréditaires et la violence des castes dominantes contre les castes inférieures fait partie de la domination. Il n’est pas possible pour un ‘brahmane’, un membre de la couche supérieure, de boire dans le même verre qu’un membre de certaines castes inférieures; même le regard d’un inférieur peut ‘salir’ un repas et il faudra le purifier]]. Les premiers convertis, les chefs de village et les gros propriétaires terriens – des gens comme Mahendra Karma, fondateur de la Salwa Judum – se sont vus conférer le statut de dwij, né deux fois, brahmanes [[C’est-à-dire membre de la caste le plus haute]]. (Bien sûr, c’était un peu une arnaque, parce que personne ne peut devenir brahmane. Si c’était possible, ne serions aujourd’hui devenus une nation de brahmanes). Mais ce faux hindouisme est considéré comme assez bon pour la population tribale, juste comme les marques contrefaites de tout le reste – biscuits, savon, allumettes, huile – qui sont vendues sur les marchés villageois. Dans le cadre de la campagne d’hindouisation, les noms des villages ont été changés dans les registres fonciers, ce qui entraîne que la plupart d’entre eux ont deux noms aujourd’hui, les noms du peuple et les noms du gouvernement. Par exemple, le village d’Innar est devenu Chinnari. Sur les listes électorales, les noms tribaux ont été changés en noms hindous (Massa Karma est devenu Mahendra Karma). Ceux qui ne sont pas venus rejoindre le bercail hindou ont été déclarés ‘katwas’ autrement dit intouchables (Les ‘dalits’ ou ‘intouchables’ sont les membres de la caste la plus basse), ce qui est devenu plus tard la base de recrutement naturelle pour les maoïstes.
Le PGW a d’abord commencé à travailler dans le Bastar Sud et le Gadchiroli. Le Camarade Venu décrit ces premiers mois en détail: comment les villageois étaient suspicieux à leur égard, et ne les laissaient pas entrer dans leurs maisons. Personne ne leur aurait offert de la nourriture ou de l’eau. La police répandait des rumeurs qu’ils étaient des voleurs. Les femmes cachaient leurs bijoux dans les cendres de leur poêle à bois. Il y avait une répression terrible. En novembre 1980, à Gadchiroli, la police a ouvert le feu dans une réunion de village et a tué toute une escouade. Ca a été le premier ‘combat'[[ En anglais : ‘encounters’ (‘rencontres’). Il s’agit d’exécutions déguisées en combats que nous traduirons par ‘combat’ (entre guillemets)]] meurtrier du DK. Ca a été une retraite traumatisant et les camarades se sont retirés à travers le Godavari et sont retournés à Adilabad.
Mais en 1981, ils y sont revenus. Ils ont commencé à organiser les populations tribales pour exiger une augmentation du prix qu’on leur donnait pour les feuilles de tendu (qui sont utilisées pour fabriquer les beedis [[Les beedis sont de petit cigarillos indiens contenant un peu de tabac roulé dans une feuille de tendu (ou temburini)]]). A l’époque, les commerçants payaient trois paises pour un fagot d’environ 50 feuilles. C’était un travail formidable d’organiser les gens qui n’étaient pas du tout familiers avec ce type de politique, de les amener à se mettre en grève.
Finalement, la grève a été un succès et le prix doublé, à six paises [[Le paise est le centième de roupie]] le fagot. Mais le vrai succès pour le Parti était d’avoir été capable de prouver la valeur de l’unité et une nouvelle manière de conduire une négociation politique. Aujourd’hui, après plusieurs grèves et agitations, le prix d’un fagot de feuilles de Tendu est d’une roupie. (Cela semble un peu improbable à ces tarifs, mais le chiffre d’affaire du business du tendu se compte en centaines de milliards de roupies) Chaque saison, le gouvernement glisse des offres et donne à des entrepreneurs la permission d’extraire un volume fixé de feuilles de tendu – habituellement entre 1500 et 5000 sacs standards connus sous le nom de manak boras. Chaque manak boras contient environ 1000 fagots.
(Bien sûr, il n’y a aucune manière de s’assurer que les entrepreneurs n’extraient pas plus que ce qu’ils sont supposés). Au moment où le tendu entre sur le marché, il est vendu en kilos. L’arithmétique glissante et le système rusé de mesure qui converti les fagots en manak boras puis en kilos est contrôlé par les entrepreneurs, et laisse beaucoup de place aux pires manipulations. L’estimation la plus prudente place leur profit par sac standard à environ 1.100 roupies. (Cela après avoir payé au Parti une commission de 120 roupies par sac) Mais par cette voie, un petit entrepreneur (1.500 sacs) fait environ 160.000 roupies par saison et un gros (5.000 sacs) jusqu’à 550.000 roupies.
Une évaluation plus réaliste serait plusieurs fois ce montant. Pendant ce temps, la Plus Grave Menace pour la Sécurité Intérieure fait juste assez pour rester en vie jusqu’à la saison suivante.
Nous sommes interrompus par des rires et par la vue de Nilesh, un des jeunes camarades de la PLGA, marchant rapidement vers la zone de cuisine, se giflant lui-même. Quand il arrive plus près, je vois qu’il transporte un nid en feuilles de fourmis rouges en colère qui ont rampé partout sur lui et qui le mordent aux bras et au cou. Nilesh rigole aussi. «As-tu déjà mangé un chutney?» me demande le Camarade Venu. Je connais bien les fourmis rouges, de mon enfance dans le Kerala, j’ai été mordue par elles, mais je n’en ai jamais mangé. (Le chutney s’avère être bon. Aigre. Beaucoup d’acide folique)
Nilesh est de Bijapur, qui est au cœur des opérations de la Salwa Judum. Le plus jeune frère de Nilesh a rejoint la Judum lors d’un de ses pillages et incendies fous et a été fait Special Police Officer (SPO – Officier de Police Spécial [[Il ne s’agit pas d’un officier au sens des armées occidentale : à peine d’un auxiliaire de police]]). Il habite dans le camp de Basaguda avec sa mère. Son père a refusé d’y aller et est resté au village. En fait, c’est une querelle familiale sanglante.
Plus tard, quand j’ai eu l’occasion de lui parler, j’ai demandé à Nilesh pourquoi son frère avait fait ça. «Il était très jeune» a dit Nilesh, «Il a eu l’opportunité de se déchaîner, de blesser les gens et de brûler des maisons. Il est devenu fou, il a fait des choses terribles. Maintenant, il est coincé. Il ne pourra plus jamais rentrer au village. Il ne sera jamais pardonné. Il le sait».
Nous retournons à la leçon d’histoire. La grande lutte suivante du Parti, dit le Camarade Venu, a été contre l’usine de pâte à papier Ballarpur Paper Mills. Le gouvernement aurait donné aux Thapars un contrat de 45 ans pour extraire 15000 tonnes de bambou à un taux extrêmement subventionné. (De la petite bière comparé à la bauxite, mais tout de même). Les tribaux étaient payés dix paisas pour un fagot qui contenait vingt chaumes de bambou (je ne céderai pas à la tentation vulgaire de comparer cela aux profits que faisaient les Thapars). Une longue agitation, une grève, suivie de négociations avec les responsables de l’usine de pâte à papier en présence de la population, ont triplé le prix à trente paisas le fagot. Pour les peuples tribaux, c’étaient des énormes réussites. D’autres partis politiques avaient fait des promesses, mais n’ont montré aucun signe qu’ils allaient les tenir. Les gens ont commencé à approcher le PWG, demandant s’ils pouvaient s’y joindre.
Mais la politique du tendu, du bambou et d’autres produits forestiers était saisonnière. Le problème permanent, le vrai fléau des vies des gens était le plus grand propriétaire terrien de tous, le Département Forestier. Chaque matin, les représentants des services forestiers, jusqu’aux moindres sous-fifres, pouvaient apparaître dans les villages comme un cauchemar, empêchant les gens de labourer leurs champs, de ramasser le bois de chauffage, de cueillir les feuilles, de ramasser les fruits, de faire paître le bétail, de vivre. Ils amenaient des éléphants pour occuper les champs et dispersaient des graines de babul pour détruire le sol sur leur passage. Les gens étaient battus, arrêtés, humiliés, leurs récoltes détruites. Bien sûr, du point de vue du Département Forestier, ceux-ci étaient des gens illégaux engagés dans une activité anticonstitutionnelle et le Département ne faisait qu’appliquer le Règne de la Loi (Leur exploitation sexuelle des femmes était juste un avantage supplémentaire dans une mission difficile).
Enhardi par la participation populaire dans ces luttes, le Parti a décidé d’affronter le Département Forestier. Il a encouragé les gens à reprendre la terre de la forêt et à la cultiver. Le Département Forestier s’est vengé en brûlant les nouveaux villages qui avaient surgis dans les zones forestières. En 1986, il a annoncé un Parc National à Bijapur, ce qui signifiait l’expulsion de 60 villages. Plus de la moitié d’entre eux avaient déjà été déplacés et la construction de l’infrastructure du Parc National avait commencé quand le Parti y est entré. Il a démoli la construction et a stoppé l’expulsion des villages restants. Il a empêché le Département Forestier d’entrer dans la zone. A quelques occasions, des fonctionnaires ont été capturés, attachés aux arbres et battus par les villageois. C’était une vengeance cathartique de générations d’exploitation. Finalement, le Département Forestier a fui. Entre 1986 et 2000, le Parti a redistribué 300000 acres de terre forestière. Aujourd’hui, dit le Camarade Venu, il n’y a aucun paysan sans terre dans le Dandakaranya.

Roy écoute l’histoire des maoïstes
Pour la génération actuelle de jeunes gens, le Département Forestier est un souvenir distant, la matière d’histoires que les mères racontent à leurs enfants, à propos d’un passé mythologique de servitude et d’humiliation. Pour la génération plus vieille, la libération du Département Forestier signifiait l’authentique liberté. Ils pouvaient la toucher, la sentir. Cela signifiait beaucoup plus que ce que n’a jamais signifié l’indépendance de l’Inde. Ils ont commencé à se rallier au Parti qui avait lutté avec eux. L’équipe de sept bataillons avait parcouru un long chemin. Son influence couvrait maintenant une étendue de 60.000 kilomètres carrés de forêt, des milliers de villages et des millions de personnes.
Mais le départ du Département Forestier a annoncé l’arrivé de la police. Elle a déclenché un cycle de carnage. Fausses ‘combats’ mis en scène par la police, embuscades tendues par la PWG. Avec la redistribution de la terre sont arrivées d’autres responsabilités: irrigation, productivité agricole et le problème d’une population croissante dégageant arbitrairement la forêt. La décision a été prise de séparer le ‘travail de masse’ et le ‘travail militaire’.
Aujourd’hui, le Dandakaranya est administré par une structure complexe de Jantana Sarkars (gouvernements populaires). Les principes d’organisation venaient de la révolution chinoise et de la guerre du Vietnam. Chaque Jantana Sarkar est élu par un groupe de villages dont la population totale peut varier de 500 à 5000. Il a neuf départements: Krishi (agriculture), Kyapar-Udyog (commerce et industrie), Arthik (économie), Nyay (justice), Raksha (défense), Hospital (santé), Jan Sampak (relations publiques), School-Riti Rivaj (éducation et culture) et Jungle. Un groupe de Janatana Sarkars se trouve sous le Comité Régional. Trois Comités Régionaux forment une Division. Il y a dix Divisions dans le Dandakaranya.
«Nous avons un département Save the Jungle (Sauver la Jungle) maintenant» dit le Camarade Venu «tu dois avoir lu le Rapport Gouvernemental que la superficie forestière a augmenté dans les régions naxales?»
Ironiquement, dit le Camarade Venu, les premières personnes à bénéficier de la campagne du Parti contre le Département Forestier ont été les Mukhiyas (chefs de village) – la brigade Dwij. Ils ont utilisé leur main-d’œuvre et leurs ressources pour saisir autant de terre qu’ils le pouvaient, tant que les conditions étaient bonnes. Mais alors, la population a commencé à aborder le Parti avec ses ‘contradictions internes’, comme le dit bizarrement le Camarade Venu. Le Parti a commencé à tourner son attention vers les questions d’équité, de classe et d’injustice au sein de la société tribale. Les grands propriétaires terriens ont senti les ennuis à l’horizon. Vu que l’influence du Parti s’étendait, ils avaient commencé à faiblir. De plus en plus, les gens amenaient leurs problèmes au Parti au lieu des Mukhiyas. Les vieilles formes d’exploitation ont commencé à être mises en cause. Le premier jour de pluie, les gens étaient traditionnellement sensés labourer la terre des Mukhiyas au lieu de la leur. Cela s’est arrêté. Ils ne leur ont plus offert les premiers jours de ramassage de mahua ou d’autres produits forestiers. Manifestement, il fallait faire quelque chose.
Entre en scène Mahendra Karma, un des plus grands propriétaires terriens de la région et à ce moment, membre du Parti Communiste d’Inde (CPI) [[Il s’agit du Parti ‘communiste’ légaliste et réformiste, représenté au parlement]]. En 1990, il a rassemblé un groupe de Mukhiyas et de propriétaires terriens et a commencé une campagne appelée à Jan Jagran Abhiyan (Public Awakening Campaign – Campagne Publique d’Eveil). Leur façon de ‘réveiller’ le ‘public’ était de former un parti de chasse d’environ 300 hommes pour passer la forêt au peigne fin, tuant les gens, brûlant les maisons et attentant à la pudeur des femmes. Le Gouvernement du Madhya Pradesh d’alors – l’état du Chhattisgarh n’avait pas encore été constitué – a fourni le soutien de la police. Dans le Maharashtra, quelque chose de similaire, appelé ‘Front Démocratique’ a commencé son assaut. La Guerre Populaire a répondu à tout cela dans son vrai style de Guerre Populaire, en tuant quelques-uns des propriétaires terriens les plus notables. En quelques mois, la Jan Jagran Abhiyan, la ‘terreur blanche’ – comme la désigne le Camarade Venu – s’est effacée. En 1998, Mahendra Karma, qui avait alors rejoint le Parti du Congrès, a tenté de raviver la Jan Jagram Abhiyan. Cette fois, elle s’est éteinte encore plus vite qu’avant.
Puis, durant l’été 2005, la chance l’a favorisé. En avril, le gouvernement BJP [[Le Bharatiya Janata Party (BJP; Parti du Peuple Indien) est l’un des principaux partis politiques en Inde, de tendance chauviniste hindouiste]] du Chhattisgarh a signé deux MOU pour créer des aciéries intégrées (dont les termes sont secrets). Un pour 70 milliards de roupies avec Essar Steel à Bailadila, et l’autre pour 100 milliards de roupies avec Tata Steel à Lohandiguda. Le même mois, le Premier Ministre Manmohan Singh a énoncé sa fameuse déclaration à propos des maoïstes comme la ‘Menace la Plus Grave pour la Sécurité Intérieure’ de l’Inde. (C’était une chose étrange à dire à ce moment-là, parce qu’en fait, c’était l’opposé qui était vrai. Le Gouvernement du Congrès de l’Andhra Pradesh venait juste de mettre les maoïstes sur la touche, de les décimer. Ils avaient perdu environ 1.600 de leurs cadres et étaient dans le plus complet désordre). La déclaration du Premier Ministre a fait monter en flèche la valeur des actions des sociétés minières. Elle a également envoyé un signal aux médias que les maoïstes étaient une proie facile pour quiconque qui choisissait de courir après eux. En juin 2005, Mahendra Karma a appelé à une réunion secrète de Mukhiyas dans le village de Kutroo et a fondé la Salwa Judum. Un charmant mélange de traditionalisme tribal et de sentimentalisme hindou aux relents nazis.
Contrairement à la Jan Jagran Abhiyan, la Salwa Judum était une opération de nettoyage de terrain, destinée à déplacer les personnes de leurs villages vers des camps en bordure de route, où ils pouvaient être contrôlés policièrement. En termes militaires, cela s’appelle Hameaux Stratégiques. Cela a été conçu par le général Sir Harold Briggs en 1950 quand les Britanniques étaient en guerre contre les communistes en Malaisie. Le Plan Briggs est devenu très populaire dans l’armée indienne qui l’a utilisé dans le Nagaland, le Mizoram et le Telengana. Le Ministre en Chef BJP du Chhattisgarh, Raman Singh a annoncé que tant que, en ce qui concernait son gouvernement, les villageois qui n’avaient pas déménagé dans les camps seraient considérés comme maoïstes. Donc dans le Bastar, pour un villageois ordinaire, le simple fait de rester chez lui est devenu l’équivalent d’une dangereuse activité terroriste.
Avec une tasse en acier de thé noir, comme un plaisir spécial, quelqu’un me tend une paire d’écouteurs et allume un petit lecteur MP3. C’est un enregistrement rayé de Mr Manhar, le commissaire de police de Bijapur d’alors, briefant un officier subalterne à la radio à propos des récompenses et des primes que les gouvernements de l’Etat et de l’Etat central offrent aux villages ‘jagrit’ (réveillés) et aux gens qui acceptent de déménager dans les camps. Et puis il donne les instructions claires: les villages qui refusent de ‘se rendre’ devront être brûlés et les journalistes qui veulent couvrir les naxalites devront être abattus à vue. (J’avais lu ça dans les journaux il y a longtemps. Quand l’histoire s’est répandue, comme punition – pour punir qui, ce n’est pas clair – le commissaire a été transféré à la Commission des Droits Humains de l’Etat).
Le premier village que la Salwa Judum a brûlé (le 18 juin 2005) était Ambeli. Entre juin et décembre 2005, elle a brûlé, tué, violé et pillé sur son chemin à travers des centaines de villages du Dantewara Sud. Le centre de ses opérations était les districts de Bijapur et de Bhairamgarh, près de Bailadila, où la nouvelle usine Essar Steel était en projet. Ce n’est pas une coïncidence, il y avait aussi des bastions maoïstes, où les Jantan Sarkars avaient fait beaucoup de travail, surtout pour construire des structures de collecte d’eau. Les Janata Sarkars sont devenus la cible spéciale des attaques de la Salwa Judum. Des centaines de personnes ont été assassinées avec les manières les plus brutales. Environ 60.000 personnes ont déménagé dans les camps, certaines volontairement, d’autres sous la terreur. Parmi elles, environ 3.000 ont été nommées Special Police Officer (SPO) pour un salaire de 1.500 roupies.
Pour ces miettes dérisoires, des jeunes gens, comme le frère de Nilesh, se sont condamnés eux-mêmes à une réclusion à vie dans une enceinte de barbelés. Cruels comme ils l’ont été, ils pourraient finir par être les pires victimes de cette horrible guerre. Aucun jugement de la Cour Suprême ordonnant le démantèlement de la Salwa Judum ne pourra changer leur destin.
Les centaines de milliers de personnes restantes sont sorties de l’écran radar du gouvernement. (Mais pas les fonds de développement pour ces 644 villages. Qu’advient-il de cette petite mine d’or?) Beaucoup d’entre eux ont fait leur chemin vers l’Andhra Pradesh et l’Orissa où ils migraient d’habitude pour travailler comme contractuels durant la saison de la cueillette du piment. Mais des dizaines de milliers ont fui dans la forêt, où ils vivent toujours, sans abri, revenant dans leurs champs et leurs maisons uniquement dans la journée.
Dans le sillage de la Salwa Judum, un essaim de commissariats et de camps sont apparus. L’idée était de fournir un tapis de sécurité pour une ‘réoccupation rampante’ du territoire contrôlé par les maoïstes. La supposition était que les maoïstes n’oseraient pas s’attaquer une si grande concentration de forces de sécurité. Les maoïstes pour leur part, ont réalisé que s’ils ne brisaient pas ce tapis de sécurité, cela reviendrait à abandonner le peuple dont ils avaient gagné la confiance et avec qui ils avaient vécu et travaillé durant 25 ans. Ils ont riposté par une série de contre-attaques au cœur du dispositif de sécurité.
Le 26 janvier 2006, la PLGA a attaqué un camp de police de Gangalaur et a tué sept personnes. Le 17 juillet 2006, le camp de Salwa Judum à Erabar a été attaqué, vingt personnes ont été tuées et 150 blessées. (On a pu lire à ce sujet: «Les maoïstes ont attaqué un camp d’assistance créé par le gouvernement de l’Etat pour fournir un abri aux villageois qui avaient fui leur village à cause de la terreur déchaînée par les naxalites») Le 13 décembre, ils ont attaqué le camp ‘d’assistance’ de Basaguda et ont tué trois SPO et un agent de police. Le 15 mars 2007 est venue la plus audacieuse d’entre elles. 120 guérilleros de la PLGA ont attaqué la Rani Bodili Kanya Ashram, un foyer de filles qui avait été converti en caserne pour 80 policiers (et SPO) du Chhattisgarh pendant que les filles y vivaient encore comme boucliers humains. La PLGA a pénétré l’enceinte, a barré l’annexe où vivait les filles et a attaqué la caserne. 55 policiers et SPO ont été tués. Aucune des filles n’a été blessée. (Le commissaire de police franc de Dantewara m’avait montré sa présentation Power Point avec des photos horribles des brûlés, les corps éventrés des policiers au milieu des ruines du bâtiment scolaire explosé. Elles étaient si macabres, il était impossible de ne pas détourner le regard. Il semblé content de ma réaction).
L’attaque de Rani Bodili a causé un tumulte dans le pays. Les organisations de défense des droits humains ont condamné les maoïstes, pas seulement pour leur violence, mais également pour être anti-éducation et pour attaquer les écoles. Mais dans le Dandakaranya, l’attaque de Rani Bodili est devenue une légende: des chansons, des poèmes et des pièces ont été écrites à son sujet.
La contre-offensive maoïste a brisé le tapis de sécurité et a donné un répit à la population. La police et la Salwa Judum se sont retirées dans leurs camps, desquels elles émergent maintenant – habituellement dans le milieu de la nuit – seulement en paquets de 300 ou 1.000 pour mener des opérations Bouclage et Ratissage dans les villages. Graduellement, excepté les SPO et leurs familles, le reste des gens dans les camps de la Salwa Judum ont commencé à retourner dans leurs villages. Les maoïstes les ont accueillis et ont annoncé que même les SPO pouvaient revenir s’ils regrettaient sincèrement et publiquement leurs actions. Les jeunes gens ont commencé à affluer à la PLGA (La PLGA a été officiellement constituée en décembre 2000). Ces trente dernières années, ses brigades armées se sont très graduellement étendues en sections, les sections ont grandi en pelotons et les pelotons en compagnies. Mais après les ravages de la Salwa Judum, la PLGA a été rapidement capable de compter ses combattants en bataillons.
La Salwa Judum n’avait pas simplement échoué, elle s’était méchamment retournée contre ses créateurs.
Comme nous le savons maintenant, ce n’était pas juste une opération locale d’un petit truand. Sans tenir compte du double discours dans la presse, la Salwa Judum était une opération conjointe du gouvernement de l’Etat du Chhattisgarh et du Parti du Congrès qui était au pouvoir à l’Etat central. Elle n’avait pas le droit d’échouer. Pas alors que tous ces MOU étaient en attente, comme des espoirs flétris sur le marché matrimonial. Le Gouvernement subissait une pression terrible pour présenter un nouveau plan. Il a sorti l’Opération Green Hunt. Les SPO de la Salwa Judum sont maintenant appelé Commandos Koya. Il a déployé la Chhattisgarh Armed Force (CAF – Force Armée du Chhattisgarh), la Central Reserve Police Force (CRPF), la Border Security Force (BSF – Force de Sécurité Frontalière), la Indo-Tibetan Border Police (ITBP – Police Frontalière Indo-Tibétaine), la Central Industrial Security Force (CISF – Force Centrale de Sécurité Industrielle), les Grey Hounds, les Scorpions, les Cobras. Et une police affectueusement appelée WHAM – Winning Hearts and Arms (Gagnant les Cœurs et les Esprits).
Les guerres importantes sont souvent livrées dans des endroits improbables. Le capitalisme de libre marché a battu le communisme soviétique dans les montagnes lugubres d’Afghanistan. Ici, dans les forêts de Dantewara, une bataille fait fureur pour l’âme de l’Inde. Beaucoup de choses ont été dites à propos de l’aggravation de la crise dans la démocratie indienne et la complicité entre les grandes entreprises, les principaux partis politiques et le gratin de l’appareil sécuritaire. Si quelqu’un veut faire un rapide contrôle surprise, c’est à Dantewara qu’il doit aller.
Une ébauche de rapport sur les Relations Agraires de l’Etat et la Tâche Inachevée de la Réforme de la Terre (Volume 1) a dit que Tata Steel et Essar Steel étaient les premiers financeurs de la Salwa Judum. Vu que c’était un Rapport du gouvernement, il a fait des vagues quand il a été dévoilé à la presse. (Ce fait a été par la suite exclu du rapport final. Etait-ce une erreur sincère, ou quelqu’un a-t-il reçu une gentille petite tape d’acier intégré sur l’épaule?)
Le 12 octobre 2009, l’audience publique obligatoire pour l’aciérie Tata, sensée se tenir à Lohandigua où les habitants locaux auraient pu aller, a en fait eu lieu dans une petite salle au siège du Trésor public de Jagdalpur, éloigné de plusieurs miles et avec un cordon massif de sécurité. Un public de cinquante tribaux recrutés et rétribués a été amené dans un convoi escorté de jeeps du gouvernement. Après la réunion, le Percepteur du District a félicité ‘le peuple de Lohandiguda’ pour sa coopération. Les journaux locaux ont rapporté le mensonge, même s’ils savaientà quoi ‘en tenir (Les publicités ont afflué). Malgré les objections des villageois, les acquisitions de terres pour le projet ont commencé.
Les maoïstes ne sont pas les seuls à chercher à renverser l’Etat indien. Il a déjà été renversé plusieurs fois, par le fondamentalisme hindou et le totalitarisme économique.
Lohandiguda, un trajet de cinq heures depuis Dantewara, n’a jamais été une région naxalite. Mais maintenant, elle l’est. La Camarade Joori qui était assise à côté de moi pendant que je mangeais le chutney aux fourmis, travaille dans la région. Elle a dit qu’ils avaient décidé d’y entrer après que des tags aient commencé à apparaître sur les murs des villages, disant Naxali Ao, Hamein Bachao (Naxalites, venez et sauvez-nous)! Il y a quelques mois, Vimal Meshram, Président du panchayat (conseil municipal) du village était abattu au marché. «C’était un homme de Tata» dit Joori «Il obligeait les gens à laisser tomber leur terre et à accepter la compensation. C’est bien qu’il ait été tué. Nous avons aussi perdu un camarade. Ils l’ont abattu. T’veux un peu plus de chapoli?» Elle a seulement vingt ans. «Nous ne laisserons pas Tata venir ici. Le peuple ne les veut pas.» Joori n’est pas de la PLGA. Elle est dans la Chetna Natya Manch, l’aile culturelle du Parti. Elle chante. Elle écrit des chansons. Elle vient de Abhumad. (Elle est mariée avec le Camarade Madhav. Elle est tombée amoureuse de ses chants quand il a visité son village avec une troupe de la CNM).
A ce stade, je sens que je devrais dire quelque chose. A propos de la futilité de la violence, à propos du caractère inacceptable des exécutions sommaires. Mais que devrais-je suggérer de faire? Aller en justice? Faire un sit-in à Jantar Mantar, à New Delhi? Une manifestation? Une grève de la faim en chaîne? Cela semble ridicule. On devrait demander aux organisateurs de la Nouvelle Politique Economique – qui trouvent si facile de dire «Il n’y a Pas d’Alternative» – de suggérer une Politique de Résistance alternative. Une qui soit spécifique, à ces gens spécifiques, dans cette forêt spécifique. Ici. Maintenant. Pour quel parti voteraient-ils? Quelle institution démocratique de ce pays aborderaient-ils? A quelle porte Narmada Bachaor Andolan n’a-t-il pas frappé durant ces années et ces années où il a combattu contre les Grands Barrages de Narmada?
Il fait noir. Il y a beaucoup d’activité dans le camp, mais je ne peux rien voir. Juste des points de lumière qui bougent. Il est difficile de dire si ce sont des étoiles, ou des lucioles, ou des maoïstes en mouvement. Le petit Mangtu apparaît, sorti de nulle part. Je découvre qu’il fait partie d’un groupe de dix enfants du premier lot de la Young Communist Mobile School (Ecole Mobile des Jeunes Communistes) à qui l’on apprend à lire et à écrire, et les principes de base du communisme. («Endoctrinement des jeunes esprits!» hurle nos médias commerciaux. Les publicités à la TV qui lavent le cerveau des enfants avant même qu’ils ne puissent penser, n’étant pas vues comme une forme d’endoctrinement) Les jeunes communistes ne sont pas autorisés à porter des fusils ou des uniformes. Mais ils suivent les bataillons de la PGLA avec des étoiles dans les yeux, comme des groupies d’un groupe de rock.

Camp maoïste dans la forêt
Mangtu m’a adoptée avec un doux air de propriétaire. Il a rempli ma bouteille d’eau et dit que je devrais faire mon sac. Un coup de sifflet. La tente bleue en jhilli est démantelée et repliée en cinq minutes. Un autre coup de sifflet et toute la centaine de camarades se met en ligne. Cinq rangs. Le Camarade Raju est le Directeur des Opérations. Il y a un appel. Je suis dans la file aussi, criant mon numéro quand la Camarade Kamla, qui est en face de moi, me le souffle. (Nous comptons jusque vingt et puis recommençons à un, parce que les Gonds ne peuvent compter que jusque là. Vingt, c’est assez pour eux. Peut-être devrait-ce être assez pour nous aussi.) Chandu est en treillis maintenant et porte une mitraillette Sten. D’une voix grave, le Camarade Raju briefe le groupe. Tout est en Gondi, je n’y comprends rien, mais j’entends continuellement le mot RV. Plus tard, Raju me dit qu’il veut dire Rendez-vous. C’et maintenant un mont Gondi. «Nous faisons des points RV de telle manière que si nous sommes sous le feu et que les gens doivent se disperser, ils savent où se regrouper». Il lui est impossible de savoir le type de panique que cela provoque en moi. Pas parce que j’ai peur qu’on me tire dessus, mais parce que j’ai peur d’être perdue. Je suis une dyslexique directionnelle, capable de me perdre entre ma chambre et ma salle de bain. Que ferai-je dans 60.000 kilomètres carrés de forêt? Qu’il pleuve ou qu’il vente, je m’accrocherai au pallu [[Partie du sari qui couvre la poitrine et retombe dans le dos]] du Camarade Raju.
Avant que nous ne commencions à marcher, le Camarade Venu vient vers moi. «Okay Camarade. Je prends congé de toi». Je suis décontenancée. Il a l’air d’un petit moustique avec un capuchon de laine et des sandales, entouré par ses gardes du corps, trois femmes, trois hommes. Lourdement armés. «Nous te sommes très reconnaissants camarade, d’avoir fait tout le chemin jusqu’ici» dit-il. Une fois encore, la poignée de main, le poing serré. «Lal Salaam Camarade». Il disparait dans la forêt, le Gardien des Clés. Et en un instant, c’est comme s’il n’avait jamais été là. Je me sens un peu dépossédée. Mais j’ai des heures d’enregistrement à écouter. Et comme les jours se transforment en semaines, je vais rencontrer beaucoup de gens pour remplir de couleurs et de détails la grille qu’il a dessinée pour moi. Nous commençons à marcher dans la direction opposée. Le Camarade Raju, sentant l’iodex à un mile à la ronde, dit avec un sourire joyeux «Mes genoux sont finis. Je ne peux marcher que si j’ai pris une poignée d’anti-douleurs».
Le Camarade Raju parle parfaitement le hindi et a une façon pince-sans-rire de raconter les histoires les plus drôles. Il a travaillé comme avocat à Raipur durant 18 ans. Sa femme, Malti, et lui, étaient membres du Parti et faisaient partie de son réseau dans la ville. A la fin de 2007, l’une des personnes clé du réseau de Raipur a été arrêtée, torturée et finalement transformée en informateur. Elle a été conduite à travers Raipur dans un véhicule de police fermé et a dû désigner ses anciens collègues.
La Camarade Malti était l’une d’eux. Le 22 janvier 2008, elle a été arrêtée avec d’autres. L’accusation principale contre elle est qu’elle a envoyé des CD contenant des preuves vidéos des atrocités de la Salwa Judum à plusieurs membres du Parlement. Son affaire ne vient que rarement à l’audience parce que la police sait que son dossier est bidon. Mais la nouvelle Chhattisgarh Special Public Security Act (CSPSA – Loi Spéciale de Sécurité Publique du Chhattisgarh) autorise la police à le retenir sans possibilité de remise en liberté sous caution durant plusieurs années. «Maintenant, le gouvernement a déployé plusieurs bataillons de la police du Chhattisgarh pour protéger les pauvres membres du Parlement de leur propre courrier» dit le Camarade Raju. Lui ne s’est pas fait arrêter parce qu’à ce moment là, il était à Dandakoranya, où il assistait à une réunion. Il y est resté depuis. Ses deux enfants en âge scolaire qui étaient restés seuls à la maison ont été abondamment interrogés par la police. Finalement, ils ont fait leurs bagages et sont partis vivre chez un oncle. Le Camarade Raju n’a reçu de leurs nouvelles pour la première fois il y a seulement quelques semaines. Qu’est-ce qui lui donne cette force, cette capacité à garder son humour acide? Qu’est-ce qui les fait tous avancer, malgré tout ce qu’ils ont enduré? Leur confiance et leur espoir – et l’amour – pour le Parti. Je rencontre cela encore et encore, enraciné dans l’histoire personnelle des gens.
Nous avançons maintenant en une seule file. Moi et une centaine d’insurgés ‘d’une violence insensée’ et sanguinaires. J’ai regardé le camp avant que nous ne le quittions. Il n’y a aucun signe que pratiquement cent personnes ont campé ici, excepté quelques cendres à l’emplacement des feux. Cette armée est incroyable. En ce qui concerne la consommation, elle est plus gandhienne que tout gandhien, et a une empreinte carbone plus légère que n’importe quel évangéliste du changement climatique. Mais pour l’instant, elle a même une approche ‘gandhienne’ du sabotage; avant qu’un véhicule de police ne soit brûlé, par exemple, il est déshabillé et chaque partie est cannibalisée. Le volant est redressé et transformé en canon, la garniture intérieure en rexine est enlevée et utilisée pour faire des cartouchières, la batterie pour la charge d’énergie solaire. (Les nouvelles instructions du haut commandement sont que les véhicules capturés doivent être enterrés et non brûlés. De cette manière, ils peuvent être ressuscités quand on en a besoin). Je me demande si je devrais écrire une pièce de théâtre – Gandhi Prend Ton Fusil. Ou serai-je lynchée?
Nous marchons dans le noir et dans un silence de mort. Je suis la seule qui utilise une lampe électrique, pointée vers le bas et donc tout ce que je peux voir dans son cercle de lumière, ce sont les talons nus de la Camarade Kamla dans ses sandales noires éraflées, me montrant exactement où je dois mettre mes pieds. Elle transporte dix fois plus de poids que moi. Son sac à dos, un fusil, un énorme sac de provisions sur sa tête, un des grands plats de cuisine et deux sacs en bandoulière remplis de légumes. Le sac sur sa tête est parfaitement équilibré et elle peut descendre des pentes et des chemins de pierres glissants sans même le toucher. Elle est un miracle. Cela s’avère être une longue marche. Je suis reconnaissante pour la leçon d’histoire parce qu’en plus de tout le reste, elle a donné du repos à mes pieds durant toute une journée. (C’est la plus belle chose que de marcher dans la forêt pendant la nuit. Et je vais le faire nuit après nuit).
Nous nous rendons à une célébration pour le centenaire de la rébellion du Bhumkal en 1910 durant laquelle les Koyas se sont soulevés contre les Britanniques. Bhumkal signifie tremblement de terre. Le Camarde Raju dit que les gens marcheront pendant des jours ensemble pour venir à la célébration. La forêt doit être remplie de gens en mouvement. Il y a des célébrations dans toutes les divisions du DK. Nous sommes privilégiés parce que le Camarade Leng, le Maître de Cérémonie, marche avec nous. En Gondi, Leng signifie ‘la voix’.
Le Camarade Leng est un grand homme d’âge moyen originaire de l’Andhra Pradesh, un collègue du chanteur-poète légendaire et bien aimé Gadar, qui a fondé l’organisation culturelle radicale Jan Natya Manch (JNM) en 1972. Finalement, JNM est devenu une partie officielle de la PWG et dans l’Andhra Pradesh pouvait attirer des foules de dizaine de milliers de personnes. Le Camarade Leng s’est joint en 1977 et est devenu un célèbre chanteur. Il a vécu dans l’Andhra durant la pire répression, l’ère des assassinats au cours ‘combats’ dans lesquelles des amis mourraient pratiquement chaque jour. Il a lui-même été ramassé une nuit dans son lit d’hôpital, par une femme commissaire de police se faisant passer pour un médecin. Il a été amené dans la forêt à l’extérieur de Warangal pour être ‘combattu’. Mais par chance pour lui, dit le Camarade Leng, Gadar a appris la nouvelle et s’est arrangé pour donner l’alarme. Lorsque la PWG a décidé de commencer une organisation culturelle dans le DK en 1998, le Camarade Leng a été envoyé pour diriger le Chetana Natya Manch. Et il est ici maintenant, marchant avec moi, vêtu d’une chemise vert olive, et pour une raison quelconque, d’un pyjama mauve avec des lapins roses dessus. «Il y a 10.000 membres dans le CNM maintenant» m’a-t-il dit. «Nous avons 500 chansons, en hindi, en gondi, en chhattisgarhi et en halbi. Nous avons imprimé un livre avec 140 de nos chansons. Tout le monde en écrit».
La première fois que je lui ai parlé, il semblait très sérieux, très tenace. Mais quelques jours plus tard, assis autour du feu, toujours dans son pyjama, il nous parle d’un réalisateur important et à succès de films en télougou (un ami à lui), qui joue toujours un naxalite dans ses propres films. «Je lui ai demandé» a dit le Camarade Leng dans son hindi teinté d’un agréable accent télougou «Pourquoi penses-tu que les naxalites sont toujours comme ça?» – et il a mimé adroitement un homme accroupi, trottant, à l’air traqué, émergeant de la forêt avec un AK-47 et nous a fait hurler de rire.
Je ne suis pas sûre de savoir si je me réjouis des célébrations du Bhumkal. Je crains de voir des danses traditionnelles tribales teintées de propagande maoïste, des discours enthousiastes et rhétoriques et une assistance docile aux yeux vitreux. Nous arrivons sur le terrain assez tard dans la soirée. Un monument provisoire, un échafaudage de bambou enveloppé d’un drap rouge, a été érigé. Au sommet, au-dessus du marteau et de la faucille du Parti maoïste, se trouve l’arc et la flèche de la Janata Sarkar, enveloppés d’une feuille argentée. La hiérarchie appropriée. La scène est énorme, également provisoire, sur un échafaudage robuste recouvert par un épais plâtrage de boue séchée. Il y a déjà de petits feux dispersés sur le terrain, les gens ont commencé à arriver et se cuisinent leur repas du soir. Ce ne sont que des silhouettes dans le noir. Nous faisons notre chemin à travers eux, (lalsalaam, lalsalaam, lalsalaam) et continuons durant environ 15 minutes avant d’entrer à nouveau dans la forêt.
Sur notre nouveau terrain de camping, nous devons encore former les rangs. Un nouvel appel. Et puis les instructions pour les positions des sentinelles et les ‘arcs de tir’ – décisions de qui couvrira quelle zone dans l’éventualité d’une attaque policière. Des points RV sont à nouveau fixés.
Un détachement est arrivé en avance et a déjà préparé le souper. Pour le dessert, Kamla m’apporte une goyave sauvage qu’elle a cueilli pendant la marche et a gardé pour moi.
Dès l’aube, on sent que de plus en plus de gens se rassemblent pour la célébration du jour. Un brouhaha d’excitation augmente. Des gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps se retrouvent. On peut entendre le son des micros qui sont testés. Les drapeaux, les bannières, les affiches, les guirlandes se montent. Une affiche avec les photos des cinq personnes qui ont été tuées à Ongnaar le jour où nous sommes arrivés est apparue.
Je bois le thé avec les Camarades Narmada, Maase et Rupi. La Camarade Narmada parle des nombreuses années durant lesquelles elle a travaillé à Gadchiroli avant de devenir la dirigeante du Krantikari Adivasi Mahila Sanghatha (KAMS) du DK. Rupi et Maase ont été des militantes urbaines dans l’Andhra Pradesh et me racontent les longues années de lutte des femmes au sein du Parti, pas seulement pour leurs droits mais également pour que le Parti se rende compte que l’égalité entre les hommes et les femmes est centrale dans le rêve d’une société juste. Nous parlons des années 70 et des histoires des femmes au sein du mouvement naxalite qui étaient désillusionnées par les camarades masculins qui se croyaient grands révolutionnaires mais étaient entravés par le même vieux patriarcat, le même vieux chauvinisme. Maas dit que les choses ont beaucoup changé depuis lors, bien qu’ils aient encore un long chemin à faire. (Le Comité Central du Parti et le Bureau Politique ne comptent toujours pas de femmes). Aux alentours de midi, un autre contingent de la PLGA arrive. Celui-ci est dirigé par un homme grand, souple, avec un air gamin. Ce camarade a deux noms – Sukhdev et Gudsa Usendi – dont aucun n’est le sien. Sukhdev est le nom d’un camarade très aimé qui est tombé martyr (Dans cette guerre, seuls les morts sont assez en sécurité pour utiliser leurs vrais noms) Comme pour Gudsa Usendi, beaucoup de camarades ont été Gudsa Usendi à un moment ou à un autre. (Il y a quelques mois, c’était la Camarade Raju) Gudsa Usendi est le nom du porte-parole du Parti pour le Dandakaranya. Ainsi même si Sukhdev passe le reste du voyage avec moi, je n’ai aucune idée de comment je pourrais le retrouver. Cependant, je reconnaîtrais son rire n’importe où. Il dit qu’il est venu dans le DK en 1988, quand la PWG a décidé d’envoyer un tiers de ses forces du Telengana Nord vers le DK. Il est joliment habillé, en ‘civil’ (Gondi pour ‘vêtements civils’) opposé à ‘l’habit’ (‘uniforme’ maoïste) et pourrait se faire passer pour un jeune cadre. Je lui demande pourquoi il ne porte pas d’uniforme. Il dit qu’il a voyagé et qu’il revient juste de Keshkal Gats près de Kanker. Il y a des rapports sur un gisements de bauxite – trois millions de tonnes – sur lesquels une compagnie appelée Vedanta à un œil.
Bingo, dix sur dix pour mon instinct.
Sukhdev dit qu’il est allé là pour prendre la température du peuple. Pour voir s’il était préparé à se battre. «Ils veulent des brigades maintenant. Et des fusils». Il penche la tête en arrière et se tord de rire. «Je leur ai dit que ce n’était pas si facile». Grâce à ses brins perdus de conversation et la facilité avec laquelle il porte son AK-47, je peux dire qu’il est aussi très haut placé dans la PLGA.
La poste de la jungle arrive. Il y a un biscuit pour moi! C’est de la part du Camarade Venu. Sur un minuscule morceau de papier, plié et replié, il a écrit les paroles d’une chanson qu’il avait promis de m’envoyer. La Camarade Narmada souri quand elle les lit. Elle connait cette histoire. Elle renvoie aux années 80, au moment où les gens ont commencé à faire confiance au Parti et à venir vers lui avec leurs problèmes – leurs ‘contradictions intimes’ comme les qualifie le Camarade Venu. Les femmes ont été parmi les premières à venir. Un soir, une vieille femme assise près du feu, s’est levée et a chanté une chanson pour le dada log. C’était une Maadiya, une tribu dans laquelle les femmes avaient coutume d’enlever leur chemisier et de rester seins nus après leur mariage.
-Jumper polo intor Dada, Dakoniley
-Taane tasom intor Dada, Dakoniley
-Bata papam kitom Dada, Dakoniley
-duniya kadile maata Dada, Dakoniley
-Ils disent que nous ne pouvons pas garder nos chemisiers, dada, Dakoniley
-Ils nous les font enlever, Dada,
-De quelle manière avons-nous pêché, Dada,
-Le monde change n’est-ce pas, Dada,
-Aatum hatteke Dada, Dakoniley
-Aada nanga dantom Dada, Dakoniley
-Id pisval manni Dada, Dakoniley
-Mava koyaturku vehat Dada, Dakoniley
-Mais quand nous allons au marché Dada,
-Nous devons y aller à moitié nues Dada,
-Nous ne voulons pas cette vie Dada,
-Dites cela à nos ancêtres Dada,
Ceci a été la première question féminine contre laquelle le Parti a décidé de faire campagne. Cela devait se faire délicatement, avec des instruments chirurgicaux. En 1986, il a mis en place le Adivasi Mahila Sanghathana (AMS) qui a évolué vers le Krantikari Adivasi Mahila Sanghatan (KAMS) et a aujourd’hui 90.000 membres enregistrés. Cela pourrait bien être la plus grande organisation de femmes du pays. (D’ailleurs, ils sont tous maoïstes, tous les 90.000. Seront-ils ‘ratissés’? Et qu’en est-il des 10.000 membres du CNM? Eux aussi?) Les campagnes du KAMS contre les traditions adivasis du mariage forcé et de l’enlèvement. Contre la coutume de faire vivre les femmes réglées en dehors du village dans une hutte dans la forêt. Contre la bigamie et la violence domestique. Il n’a pas gagné toutes ses batailles, mais quelles féministes les ont toutes gagnées? Par exemple, encore aujourd’hui dans le Dandakaranya, les femmes ne sont pas autorisées à semer les graines. Dans les réunions du Parti, les hommes approuvent que c’est injuste et cela devrait être supprimé. Mais dans la pratique, ils ne l’autorisent simplement pas. Donc le Parti a décidé que les femmes allaient semer les graines sur les terres communes, qui appartiennent à la Janata Sarkar. Sur cette terre, elles sèment les graines, cultivent les légumes et construisent les barrages de retenue. Une demi victoire, pas une entière.
Au fur et à mesure que la répression policière augmentait dans le Bastar, les femmes du KAMS sont devenues une force formidable et se rassemblent par centaines, parfois par milliers pour faire physiquement face à la police. Le simple fait que le KAMS existe a changé radicalement les attitudes traditionnelles et a diminué beaucoup des formes traditionnelles de discrimination contre les femmes. Pour de nombreuses jeunes femmes, rejoindre le Parti, en particulier la PLGA, est devenu une manière d’échapper à la suffocation de leur propre société. La Camarade Sushila, une ancienne membre du KAMS parle de la rage de la Salwa Judum contre les femmes KAMS. Elle dit qu’un de leurs slogans était Hum Do Bibi layenge! Layenge! (Nous voulons avoir deux femmes! Nous le voulons!) Un grand nombre de viols et de mutilations sexuelles bestiales étaient dirigés contre les membres des KAMS. Beaucoup de jeunes femmes qui ont été témoins de cette sauvagerie ont alors rejoint la PLGA et maintenant, les femmes constituent 45% de ses cadres. La Camarade Narmada envoie chercher certaines d’entre elles, qui nous rejoignent un moment plus tard.
La Camarade Rinki a les cheveux très courts. Un bob-cut comme ils disent en gondi. C’est courageux de sa part, parce qu’ici, ‘bob-cut’ signifie ‘maoïste’. Pour la police, c’est plus qu’assez comme preuve pour justifier une exécution sommaire. Le village de la Camarade Rinki, Korma, a été attaqué par le Bataillon Naga et la Salwa Judum en 2005. A ce moment là, Rinki faisait partie de la milice du village. Tout comme ses amies Lukki et Sukki, qui étaient également membres du KAMS. Après avoir brûlé le village, le Bataillon Naga a arrêté Lukki et Sukki et un autre fille, les ont violées collectivement et les ont tuées. «Ils les ont violées sur l’herbe», dit Rinki, «mais quand ça a été fini, il ne restait plus d’herbe». C’était il y a des années maintenant, le Bataillon Naga est parti, mais la police vient toujours. «Ils viennent dès qu’ils ont besoin de femmes, ou de poulets».
Ajitha a aussi un bob-cut. La Judum est venue à Korseel, son village, et a tué trois personnes en les noyant. Ajitha était avec la milice et a suivi la Judum à distance jusqu’à un endroit proche du village appelé Paral Nar Todak. Elle les a regardés violer six femmes et tirer dans la gorge d’un homme.
La Camarade Laxmi, qui est une fille magnifique avec une longue tresse, me raconte qu’elle a regardé la Judum brûler trente maisons dans son village Jojar. «Nous n’avions pas d’armes alors» dit-elle «nous ne pouvions rien faire d’autre que regarder». Elle a rejoint la PLGA juste après. Laxmi était une des 150 guérilleros qui ont marché à travers la jungle durant trois mois et demi en 2008, de Nayagarh dans l’Orissa, pour faire une descente dans un arsenal de la police où ils ont saisi 1.200 fusils et 2 millions de cartouches.
La Camarade Sumitra a rejoint la PLGA en 2004, avant que la Salwa Judum ne commence à tout saccager. Elle dit qu’elle l’a rejointe parce qu’elle voulait s’enfuir de sa maison. «Les femmes sont contrôlées dans tous les sens» me dit-elle. «Dans notre village, les filles n’étaient pas autorisées à grimper dans les arbres et si elles le faisaient, elles devaient payer une amende de 500 roupies ou d’une poule. Si un homme frappe une femme et qu’elle le frappe en retour, elle doit donner une chèvre au village. Les hommes s’en vont ensemble dans les collines durant des mois pour chasser. Les femmes ne sont pas autorisées à s’y rendre, la meilleure partie de la viande est pour les hommes. Les femmes ne peuvent pas manger d’œufs». Une bonne raison pour rejoindre une armée de guérilla?
Sumitra raconte l’histoire de deux de ses amies, Telam Parvati et Kamla qui travaillaient avec le KAMS. Telam Parvati venait du village de Polekaya dans le Bastar Sud. Comme tout le monde là, elle a aussi regardé la Salwa Judum brûler son village. Elle a alors rejoint la PLGA et est allée travailler dans les Keshkal Ghats. En 2009, elle et Kamla venaient juste de terminer d’organiser les célébrations de la journée des femmes du 8 mars dans la région. Elles étaient ensemble dans une petite hutte juste à l’extérieur d’un village appelé Vadgo. Durant la nuit, la police a encerclé la hutte et a commencé à tirer. Kamla a risposté mais a été tuée. Parvati s’est échappée, mais a été retrouvée et tuée le jour suivant. C’est ce qui est arrivé l’an dernier lors de la Journée des Femmes. Et voici un reportage d’un journal national à propos de la Journée des Femmes cette année.
Les rebelles du Bastar se battent pour les droits des femmes, Sahar Khan, Mail Today, Raipur, 7 mars 2010.
Le gouvernement peut avoir sorti le grand jeu pour combattre la menace maoïste dans le pays. Mais une section de rebelles du Chhattisgarh a des questions plus urgentes à régler que leur propre survie. Avec l’imminence la Journée Internationale des Femmes, les maoïstes de la région du Bastar ont appelé à une semaine de ‘célébrations’ pour plaider en faveur les droits des femmes. Des affiches ont également été apposées à Bijapur, dans le district de Bastar. L’appel de ces champions auto-proclamés des droits des femmes a ébahi la police. L’inspecteur général (IG) du Bastar T.J. Longkumer a dit «Je n’ai jamais vu un tel appel venant des naxalites, qui ne croient qu’à la violence et au carnage».
Et puis le reportage poursuit:
«Je pense que les maoïstes essayent de riposter à notre Jan Jagran Abhiyaan (campagne de sensibilisation de masse) très réussie. Nous avons commencé la campagne en cours avec l’objectif de gagner un soutien populaire pour l’Opération Green Hunt, qui a été lancée par la police pour éradiquer les extrémistes d’extrême gauche» a dit l’IG.
Ce cocktail de méchanceté et d’ignorance n’est pas inhabituel. Gudsa Usendi, chroniqueur de l’actualité du Parti en sait plus à propos là-dessus que la plupart des gens. Son petit ordinateur et son enregistreur MP3 sont remplis de déclarations de presse, de démentis, de corrections, de littérature du Parti, de listes des morts, de clips vidéos et audio et de matériel vidéo. «La pire chose quand vous êtes un Gudsa Usendi» dit-il «est d’émettre des mises au point qui ne sont jamais publiées. Nous pourrions sortir un épais livre de nos mises au point non publiées, à propos des mensonges qu’ils disent à propos de nous». Il parle sans trace d’indignation, en fait avec un certain amusement.
«Quelle est l’accusation la plus ridicule que vous ayez eu a démentir?»
Il réfléchi. «En 2007, nous avons dû sortir une déclaration disant «Nahi bhai, humney gai ko hathode say nahin mara» (Non frère, nous n’avons pas tué les vaches à coups de marteau). En 2007, le Gouvernement Raman Singh a annoncé un Gai Yojana (plan vache), une promesse électorale, une vache pour chaque Adivasi. Un jour, les chaînes de télévision et les journaux ont rapporté que les naxalites avaient attaqué un troupeau de vaches et les avaient matraquées à mort – avec des marteaux – parce qu’ils étaient anti-hindous, anti-BJP. On peut imaginer ce qui est arrivé. Nous avons publié un démenti. Presque personne ne l’a reproduit. Plus tard, il s’est avéré que l’homme qui avait reçu les vaches pour les distribuer était une crapule. Il les a vendues et a dit que nous lui avions tendu une embuscade et tué les vaches».
Et la plus grave?
«Oh, il y en a des douzaines. Ils mènent une campagne après tout. Quand la Salwa Judum a débuté, le premier jour, ils ont attaqué un village appelé Ambeli, l’ont brûlé et puis l’ensemble d’entre eux, les SPO, le Bataillon Naga, la police, a bougé vers Kotrapal… vous devez avoir entendu parler de Kotrapal? C’est un célèbre village qui a été brûlé 22 fois pour avoir refusé de capituler. Quand la Judum a atteint Kotrapal, notre milice l’attendait. Ils avaient préparé une embuscade. Deux SPO sont morts. La milice en a capturé sept, le reste s’est enfui. Le lendemain, les journaux ont rapporté que les naxalites avaient massacré de pauvres Adivasis. Certains ont dit que nous en avions tué des centaines. Même un magazine honorable tel que ‘Frontline’ a dit que nous avions tué 18 adivasis innocents. Même K. Balagopal, le militant pour les droits humains, qui est habituellement méticuleux à propos des faits, a dit cela. Nous avons envoyé une mise au point. Personne ne l’a publiée. Plus tard, dans son livre, Balagopal a reconnu son erreur … Mais qui l’a noté?»
J’ai demandé ce qui était arrivé aux sept personnes qui avaient été capturées.
«Le Comité Régional a appelé un Jan Adalat (Tribunal Populaire), 4.000 personnes y ont assisté. Ils ont écouté toute l’histoire. Deux des SPO ont été condamnés à mort. Cinq ont été avertis mais pas punis. Le peuple a décidé. Même pour les indicateurs – ce qui est en train de devenir actuellement un problème énorme – les gens ont écouté l’affaire, les histoires et les confessions et ont dit «Iska hum risk nahin le sakte» (Nous ne sommes pas prêts à prendre le risque de faire confiance à cette personne) ou «Iska risk hum lenge» (Nous sommes prêts à prendre le risque de faire confiance à cette personne). La presse parle toujours des informateurs qui sont tués. Jamais des nombreux autres que nous laissons partir. Jamais des gens que ces informateurs ont tués. Donc, tout le monde pense que c’est une procédure sanguinaire durant laquelle tout le monde est toujours tué. Il ne s’agit pas de vengeance, il en va de notre survie et de la sauvegarde de nos vies futures. Bien sûr, il y a des problèmes, nous avons fait des erreurs terribles, nous avons même tué les mauvaises personnes dans nos embuscades, pensant que c’était des policiers, mais ce n’est pas la façon dont c’est raconté dans les médias».
Les redoutables ‘Tribunaux Populaires’. Comment pouvons-nous les accepter? Ou approuver cette forme de justice sommaire?
D’autre part, qu’en est-il des faux ‘combats’ mis en scène et autres – la pire forme de justice sommaire – qui rapportent aux policiers et aux soldats des médailles de bravoure, des récompenses pécuniaires et des promotions de la part du gouvernement indien? Plus ils tuent, plus ils sont récompensés. Ils sont appelés ‘Cœurs Vaillants’, ‘spécialistes des affrontements’. Nous sommes appelés ‘anti-nationaux’, ceux d’entre nous qui osent les remettre en cause. Qu’en est-il de la Cour Suprême qui a admis avec impudence ne pas avoir assez de preuves pour condamner Mohammed Afzal (accusé dans l’Attaque du Parlement en décembre 2001) à mort, mais l’a fait quand même, parce que ‘la conscience collective de la société ne sera satisfaite que si la peine capitale est infligée au coupable’.
Au moins, dans l’affaire du Jan Adalat du Kotrapal, le collectif était physiquement présent pour prendre sa propre décision. Elle n’a pas été prise par des juges qui avaient perdu tout contact avec la vie ordinaire il y a très longtemps, censés parler au nom d’un collectif absent.
Je me demande ce qu’aurait du faire la population de Kotrapal? Aller chercher la police?
Le son des tambours est devenu vraiment fort. C’est l’heure de Bhumkal. Nous marchons vers le terrain. Je peux difficilement en croire mes yeux. Il y a une mer de gens, la plupart sauvages et beaux, vêtus des façons les plus fantaisistes et magnifiques. Les hommes semblent avoir beaucoup plus pris soin d’eux-mêmes que les femmes. Ils ont des coiffures à plumes et des tatouages peints sur leur visage. Beaucoup ont les yeux maquillés et les visages poudrés en blanc. Il y a beaucoup de miliciens, de filles en saris de couleurs à couper le souffle avec des fusils suspendus négligemment à l’épaule. Il y a des vieux, des enfants et des arcs de guirlandes rouges à travers le ciel.

Fête de Bhumkal
Le soleil est haut et vif. Le Camarade Leng parle. Ainsi que plusieurs dirigeants des diverses Janatana Srakars. La Camarade Niti, une femme extraordinaire qui est au Parti depuis 1997, est une telle menace pour la nation, qu’en janvier 2007, plus de 700 policiers ont encerclé le village d’Innar parce qu’ils avaient entendu qu’elle était là. La Camarade Niti est considérée comme tellement dangereuse, et est chassée avec un tel désespoir, pas parce qu’elle a mené de nombreuses embuscades (ce qu’elle a fait), mais parce qu’elle est une femme adivasi aimée par les gens dans le village et est une réelle inspiration pour les jeunes. Elle parle avec son AK à l’épaule. (C’est un fusil qui a une histoire. Le fusil de pratiquement chacun a une histoire: à qui il a été saisi, comment, et par qui)
Une troupe CNM présente une pièce à propos du soulèvement de Bhumkal. Les méchants colonialistes blancs portent des chapeaux et des cheveux de paille dorée, et tyrannisent et frappent les adivasis comme plâtre – entraînant un délice sans fin dans le public. Une autre troupe venant du Gangalaur Sud présente un spectacle appelé Nitir Judum Pito (Histoire de la Chasse Sanguinaire). Joori traduit pour moi. C’est l’histoire de deux vieilles personnes qui s’en vont à la recherche du village de leur fille. Alors qu’ils marchent à travers la forêt, ils se perdent parce que tout est brûlé et méconnaissable. La Salwa Judum a même brûlé les tambours et les instruments de musique. Il n’y a pas de cendres parce qu’il a plu. Ils ne peuvent pas trouver leur fille. Dans son chagrin, le vieux couple commence à chanter, et les entendant, la voix de leur fille venant des ruines leur chante en retour: le bruit de notre village a été réduit au silence, chant-t-elle. Il n’y a plus de de bruit du battage de riz, plus de rires. Plus d’oiseaux, plus de chèvres qui bêlent. La corde tendue de notre bonheur a été cassée net.
Son père chante en retour: Ma fille magnifique, ne pleure pas aujourd’hui. Tous ceux qui naissent doivent mourir. Ces arbres autour de nous tomberons, les fleurs fleuriront et se flétriront, un jour ce monde vieillira. Mais pour qui mourons-nous? Un jour, nos pillards apprendront, un jour la Vérité l’emportera, mais notre peuple ne t’oubliera jamais, pour des milliers d’années.

Performance à la fête de Bhumkal
Quelques discours supplémentaires. Puis les tambours et des danses commencent. Chaque Janatana Sarkar a sa propre troupe. Chaque troupe a préparé sa propre danse. Elles arrivent une par une, avec d’énormes tambours et elles dansent des histoires sauvages. Le seul personnage que toutes les troupes ont en commun est Bad Mining Man, avec un casque et des lunettes sombres, qui fume habituellement une cigarette. Mais il n’y a rien de rigide ou de mécanique dans leurs danses. Tandis qu’elles dansent, la poussière s’élève. Le son des tambours devient assourdissant. Petit à petit, la foule commence à se balancer. Et puis elle se met à danser. Ils dansent en petite lignes de six ou sept, les hommes séparés des femmes, avec leur bras autour de la taille l’un de l’autre. Des milliers de gens.
C’est pour cela qu’ils sont venus. Pour ça. On prend la joie très au sérieux ici, dans la forêt de Dandakaranya. Les gens marcheront des kilomètres, durant des jours ensemble pour fêter et chanter, pour mettre des plumes dans leurs turbans et des fleurs dans leurs cheveux, pour se serrer l’un l’autre dans les bras et boire la mahua [[Boisson très appréciée à base de fleur de mahua]] et danser toute la nuit. Personne ne chante ou ne danse tout seul. Ceci, plus que tout le reste, est le signe du défi qu’ils lancent à une civilisation qui cherche à les anéantir.
Je ne peux pas croire que tout ceci se déroule sous le nez de la police. En plein milieu de l’Opération Green Hunt.
D’abord, les camarades de la PLGA regardent les danseurs, se tenant sur les côtés, avec leurs fusils. Mais ensuite, un par un, comme des canards qui ne peuvent pas supporter de rester sur le bord et regarder les autres canards nager, ils entrent à leur tour dans la danse. Bientôt, il y a des lignes de danseurs vert olive, tourbillonnant avec toutes les autres couleurs. Et puis, alors que des sœurs et des frères, des parents et des enfants et des amis, qui ne se sont pas rencontrés depuis des mois, parfois des années, se rencontrent, les lignes se brisent et se reforment et le vert olive s’éparpille parmi les saris tourbillonnants et les fleurs, les tambours et les turbans. C’est sûrement une Armée Populaire. Pour l’instant, du moins. Et ce que le Président Mao a dit à propos des guérilleros qui sont le poisson, et la population l’eau dans laquelle ils nagent est, à ce moment, littéralement vrai.
Le Président Mao. Il est ici aussi. Un peu solitaire peut-être, mais présent. Il y a une photo de lui, sur un écran en toile rouge. Marx aussi. Et Charu Majumdar, le fondateur et le théoricien en chef du mouvement naxalite. Sa rhétorique acerbe fétichise la violence, le sang et le martyre, et emploie souvent un langage tellement dru qu’il est presque génocidaire. Debout ici, le jour de Bhumkal, je ne peux m’empêcher de penser que son analyse, si vitale pour la structure de cette révolution, est si éloignée de son émotion et de sa texture. Quand il a dit que seule ‘une campagne d’anéantissement’ pourrait produire ‘l’homme nouveau qui défiera la mort et sera libre de toute pensée d’intérêt personnel’ – aurait-il pu imaginer que ce peuple ancien, dansant dans la nuit, serait celui sur les épaules duquel reposeraient ses rêves.
Cela rend un mauvais service à tout ce qui se déroule ici que la seule chose qui semble aller vers le monde extérieur est la rhétorique rigide et inflexible des idéologues d’un parti qui a évolué par rapport à son histoire problématique. Quand Charu Mazumdar a dit cette phrase célèbre «Le Président de la Chine est notre Président et le Chemin de la Chine est notre Chemin», il était prêt à l’étendre juqu’au point où les naxalites sont restés silencieux pendant que le général Yahya Khan a commis un génocide dans l’est du Pakistan (Bengladesh) parce qu’à ce moment, la Chine était un allié du Pakistan.
Il y avait le silence aussi sur le Khmers Rouges et leurs champs de la mort au Cambodge. Il y avait eu le silence sur les excès énormes des Révolutions chinoise et russe. Silence sur le Tibet. Au sein du mouvement naxalite aussi, il y a eu des excès violents et nombre de choses qu’ils ont faites sont impossible à défendre. Mais on peut comparer tout ce qu’ils ont fait avec les réalisations sordides du Congrès et du BJP au Bunjab, au Cachemire, à Delhi, à Mumbai, dans le Gujarat,… Et cependant, malgré ces contradictions terrifiantes, Charu Mazumdar était un visionnaire dans beaucoup de ce qu’il a dit et écrit. Le parti qu’il a créé (et ses nombreux groupes dissidents) a gardé présent et réel le rêve de la Révolution en Inde. Imaginez une société sans ce rêve. Rien que pour ça, nous ne pouvons pas le juger trop sévèrement. Particulièrement pas pendant que nous nous emmaillotons nous-mêmes dans l’hypocrisie pieuse de Gandhi à propos de la supériorité de la ‘manière non violente’ et sa notion de curatelle.
«L’homme riche gardera la possession de sa richesse, dont il utilisera ce dont il a nécessairement besoin pour ses besoins personnelles et agira en tant que fiduciaire pour que le reste soit utilisé pour le bien de la société». Comme il est étrange cependant, que les tsars contemporains de l’establishment indien – l’Etat qui a écrasé les naxalites si impitoyablement – doivent maintenant dire ce que Charu Mazumdar a dit il y a si longtemps: le chemin de la Chine est notre chemin.
A l’envers, la tête en bas.
Le chemin de la Chine a changé. La Chine est devenue une puissance impériale maintenant, pratiquant la prédation des ressources d’autres pays et d’autres peuples. Mais le Parti a toujours raison, simplement, le Parti a changé d’avis.
Quand le Parti est un prétendant (comme il l’est maintenant dans le Dandakaranya) courtisant la population, attentif à chacun de ses besoins, alors il est sincèrement un Parti Populaire, son armée authentiquement une Armée Populaire. Mais après la Révolution, cette histoire d’amour peut si facilement se transformer en mariage amer. L’Armée Populaire peut se retourner sur le peuple si facilement. Aujourd’hui, dans le Dandakaranya, le Parti veut que la bauxite reste dans les montagnes. Demain, changera-t-il d’avis? Mais pouvons-nous, devons-nous laisser les inquiétudes à propos du futur nous immobiliser pour le présent?
Les danses continueront toute la nuit. Je retourne en marchant au camp. Maase est là, réveillée. Nous discutons tard dans la nuit. Je lui donne mon exemplaire des ‘Neruda’s Captain’s Verses (Vers du Capitaine Neruda) (Je l’avais emporté, juste au cas où). Elle demande encore et encore «Que pensent-ils de nous à l’extérieur? Que disent les étudiants? Raconte-moi le mouvement des femmes, quelles sont les grandes questions maintenant?» Elle me pose des questions sur moi, mes écrits. J’essaye de lui donner un compte-rendu honnête de mon chaos. Puis, elle commence à me parler d’elle, de comment elle a rejoint le Parti. Elle me raconte que son partenaire a été tué en mai dernier, dans un faux combat. Il a été arrêté à Nashik et emmené à Warangal pour être tué. «Ils doivent l’avoir sérieusement torturé». Elle était en route pour aller le retrouver quand elle a entendu qu’il avait été arrêté. Elle est restée dans la forêt depuis lors. Après un long silence, elle me raconte qu’elle a été mariée une fois avant, il y a des années. «Il a aussi été tué dans un combat» dit-elle et ajoute cette précision à briser le cœur «mais dans un vrai».
Je suis couchée éveillée sur mon jhilli, pensant à la tristesse prolongée de Maase, écoutant les tambours et les sons de la joie prolongée sur le terrain et réfléchissant à l’idée de Charu Mazumdar de guerre prolongée, précepte central du Parti maoïste. C’est ce qui fait que les gens pensent que l’offre d’entrer dans des ‘dialogues de paix’ des maoïstes est un canular, une ruse pour obtenir un répit pour se regrouper, se ré-armer et retourner mener la guerre prolongée? Qu’est-ce que la guerre prolongée? Est-ce une chose terrible en soi, ou dépend-elle de la nature de la guerre? Qu’en serait-il des gens ici dans le Dandakaranya s’ils n’avaient pas mené leur guerre prolongée ces trente dernières années, où en seraient-ils maintenant?
Et les maoïstes sont-ils les seuls à croire à la guerre prolongée? Pratiquement dès le moment où l’Inde est devenue une nation souveraine, elle s’est transformée en puissance coloniale, annexant des territoires, menant la guerre. Elle n’a jamais hésité à faire usage des interventions militaires pour aborder les problèmes politiques – Cachemire, Hyderabad, Goa, Nagaland, Manipur, Telengana, Assam, Punjab, le soulèvement naxalite au Bengale occidental, Bihar, Andhra Pradesh et maintenant à travers les régions tribales de l’Inde centrale. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées impunément, des centaines de milliers torturées.
Tout ceci derrière le masque bienveillant de la démocratie. Contre qui ces guerres sont-elles menées? Contre les musulmans, les chrétiens, les sikhs, les communistes, les dalits, les tribaux et plus que tout contre les pauvres qui osent interroger leur sort au lieu d’accepter les miettes qui leur sont lancées. Il est difficile de ne pas voir l’Etat indien comme étant essentiellement un Etat hindou de caste supérieure (sans tenir compte de quel parti est au pouvoir) qui entretient une hostilité réfléchie vis à vis de ‘l’autre’. Quelqu’un qui, sur un véritable mode colonial, envoie les Nagas et les Mizos pour se battre dans le Chhattisgarh, les Sikhs dans le Cachemire, les Cachemiris dans l’Orissa, les Tamilians dans l’Assam, etc. Si cela n’est pas la guerre prolongée, qu’est-ce donc?
Pensées déplaisantes durant une nuit étoilée magnifique. Sukhdev se sourit à lui-même, son visage éclairé par son écran d’ordinateur. C’est un bourreau de travail. Je lui demande ce qu’il y a de drôle. «J’étais en train de penser aux journalistes qui étaient venus l’an dernier aux célébrations de Bhumkal. Ils sont venu un jour ou deux. L’un d’eux a posé avec mon AK, s’est fait photographié et puis est reparti et nous a appelé Machines à Tuer ou quelque chose comme ça». Les danses ne se sont pas arrêtées et il fait jour. Les lignes continuent encore, des centaines de jeunes gens dansent encore. «Ils ne s’arrêteront pas» dit le Camarade Raju «pas avant que nous commencions à plier bagages».
Sur le terrain, je cours vers le Camarade Docteur. Il a fait fonctionner un petit camp médical au bord de la piste de danse. J’ai envie d’embrasser ses grosses joues. Pourquoi ne peut-il pas être au moins trente personnes au lieu d’une? Pourquoi ne peut-il pas être des milliers de gens? Je lui demande à quoi elle ressemble, la santé du Dandakaranya. Sa réponse me glace le sang. La plupart des gens qu’il a vu, dit-il, y compris ceux de la PLGA, ont un taux d’hémoglobine entre 5 et 6 (alors que le taux standard des femmes indiennes est de 11). Il y a la tuberculose, causée par plus de deux années d’anémie chronique. Les jeunes enfants souffrent d’une malnutrition protéino-énergétique au stade deux, appelée en termes médicaux Kwashiorkor (Je l’ai cherché plus tard. C’est un mot dérivé du langage Ga de la région côtière du Ghana et qui signifie ‘la maladie que l’enfant attrape quand le nouveau bébé arrive’. En fait, le précédent bébé ne reçoit plus le lait maternel, et il n’y a pas assez d’aliments pour fournir sa nutrition). C’est une épidémie ici, comme au Biafra, dit le Camarade Docteur. «J’ai travaillé dans des villages avant, mais je n’ai jamais rien vu de tel».
A côté de cela, il y a la malaria, l’ostéoporose, le ver solitaire, de graves infections de l’oreille et des dents et l’aménorrhée précoce – ce qui arrive quand la malnutrition durant la puberté entraîne la disparition du cycle menstruel de la femme, ou fait qu’il ne se déclenche pas du tout.
«Il n’y a aucune clinique dans cette forêt, excepté une ou deux à Gadchiroli. Aucun médecin. Aucun médicament».
Il part maintenant, avec sa petite équipe, pour un trek de huit jours jusqu’à Abhujmad. Il est en ‘habit’ aussi, le Camarade Docteur. Donc, s’ils le trouvent, ils le tueront.
Le Camarade Raju dit qu’il n’est pas sûr de continuer à camper ici. Nous devons bouger. Quitter Bhumkal implique beaucoup d’adieux étalés dans le temps.
-Lal lal salaam, Lal lal salaam.
-Jaane waley Sathiyon ko Lal Lal Salaam (Salut Rouge aux camarades sur le départ)
-Phir milenge, Phir milenge
-Dandakaranya jungle mein phir milenge(Nous nous reverrons, un jour, dans la jungle de Dandakaranya)
La cérémonie d’arrivée et de départ ne sont jamais prises à la légère, parce que tout le monde sait que quand on dit «nous nous reverrons encore», on veut en fait dire «nous pourrions ne jamais nous revoir». La Camarade Narmada, la Camarade Maase et la Camarade Roopi prennent des chemins séparés. Les reverrai-je jamais?
Donc une fois encore, nous marchons. Il fait plus chaud chaque jour. Kamla cueille le premier fruit de tendu pour moi. Il a un goût de chikoo. Je suis devenue mordue du tamarin. Cette fois, nous campons près d’un ruisseau. Les femmes et les hommes se lavent tour à tour en équipes. Durant la soirée, la Camarade Raju reçoit un paquet entier de ‘biscuits’.
Nouvelles:
-60 personnes arrêtées dans la Division de Manpur à la fin de janvier 2010 n’ont toujours pas comparu au Tribunal.
-D’énormes contingents de police sont arrivés dans le Bastar Sud. Des attaques au hasard ont lieu.
-Le 8 novembre 2009, dans le village de Kachlaram, Bijapur Jila, Dirko Madka (60 ans) et Kovasi Suklu (68) ont été tués.
-Le 24 novembre, Madavi Baman (15) a été tué dans le village de Pangodi.
-Le 3 décembre, Madavi Budram de Korenjad également tué.
-Le 11 décembre, village de Gumiapal, Division de Darba, 7 personnes tuées (noms encore à venir).
-Le 15 décembre, village de Kotrapal, Veko Sombar et Madavi Matti (tous les deux des KAMS) tués.
-Le 30 décembre, village de Vechapal, Poonem Pandu et Poonem Motu (père et fils) tués.
-En janvier 2010 (date inconnue), Chef de la Janatana Sarkar du village de Kaika, Gangalaur tué.
-Le 9 janvier, 4 personnes tuées dans le village de Surpangooden, Région de Jagargonda.
-Le 10 janvier, 3 personnes tuées dans le village de Pullem Pulladi (pas encore de noms).
-Le 25 janvier, 7 personnes tuées dans le village de Takilod, Région d’Indrivadi.
-Le 10 février (Jour de Bhumkal) Kumli violée et tuée dans le village de Dumnaar, Abhujmad. Elle venait d’un village appelé Paiver.
-2.000 hommes de troupe de la Indo Tibetan Border Patrol (ITBP – Patrouille Frontalière Indo-Tibétaine) sont campés dans les forêts de Rajnandgaan.
-5.000 hommes supplémentaires de la BSF sont arrivés à Kanker.
Et puis:
-Quota PLGA rempli
Quelques journaux anciens sont également arrivés. Il y a beaucoup de presse à propos des naxalites. Un titre perçant résume parfaitement le climat politique: Khadedo, Maaro, Samarpan Karao (Eliminer, Tuer, Les faire Capituler). En dessous de ça: Varta ke liye loktantra ka dwar khula hai (La porte de la démocratie est toujours ouverte aux discussions). Un deuxième dit que les maoïstes font pousser du cannabis pour se faire de l’argent. L’éditorial du troisième dit que la région dans laquelle nous avons campé et marché est totalement sous contrôle policier.
Les jeunes communistes prennent les extraits pour s’entraîner à lire. Ils marchent autour du camp en lisant très haut les articles anti-maoïstes avec des voix de présentateurs radio. Nouveau jour. Nouveau lieu. Nous sommes stationnés dans la banlieue du village d’Usir, sous d’énormes arbres mahua. Le mahua vient juste de commencer à fleurir et laisse tomber ses pâles fleurs vertes comme des bijoux sur le sol de la forêt. L’air est baigné de son odeur légèrement capiteuse. Nous attendons les enfants de l’école de Bhatpal qui a été fermée après le ‘combat’ d’Ongaar. Elle a été transformée en camp de police. Les enfants ont été renvoyés chez eux. Ceci est aussi vrai pour les écoles de Nelwad, Moojmetta, Edka, Vedomakot et Dhanora.
Les enfants de l’école de Bhatpal ne se montrent pas.
La Camarade Niti (la plus recherchée) et le Camarade Vinod nous mènent dans une longue marche pour voir les séries de structures pour récolter l’eau et les étangs d’irrigation qui ont été construits par la Janatana Sarkar locale. La Camarade Niti parle de l’éventail des problèmes agricoles qu’ils doivent gérer. Seuls 2% de la terre sont irrigués. A Abhujmad, le labour était impensable jusqu’à il y a 10 ans. D’autre par, à Gadricholi, les graines hybrides et les pesticides chimiques font tout doucement leur chemin. «Nous avons besoin de gens qui connaissent les graines, les pesticides organiques, la permaculture. Avec un peu d’aide, nous pourrions faire beaucoup».
Le Camarade Ramu est le fermier en charge de la région de la Janatana Sarkar. Il nous montre fièrement les champs, où ils cultivent le riz, l’aubergine, le gongura, l’oignon, le chou-rave. Puis avec la même fierté, un étang d’irrigation énorme, mais totalement sec. Qu’est-ce que c’est? «Celui-ci n’a même pas d’eau durant la saison des pluies. Il est creusé au mauvais endroit» dit-il, un sourire enveloppant son visage, «ce n’est pas le nôtre, il a été creusé par la Lotti Sarkar» (Le Gouvernement qui Pille). Il y a deux systèmes de gouvernement parallèles ici, Janatana Sarkar et Looti Sarkar. Je pense à ce que le Camarade Venu m’a dit: Ils veulent nous écraser, pas seulement à cause des minéraux, mais parce que nous proposons un modèle alternatif au monde.
Cette idée de Gram Swaraj avec un fusil n’est pas encore une alternative. Il y a trop de famine, trop de maladie ici. Mais elle a certainement créé les possibilités pour une alternative. Pas pour le monde entier, pas pour l’Alaska, ou New Delhi, ou même peut-être pour l’ensemble du Chhattisgarh, mais pour lui-même. Pour Dandakaranya. C’est le secret le mieux gardé du monde. Elle a posé les fondations pour une alternative à sa propre extermination. Elle a défié l’histoire. Contre toute attente, elle a forgé un projet pour sa propre survie. Elle a besoin d’aide et d’imagination, elle a besoin de docteurs, de profs, de fermiers. Elle n’a pas besoin de guerre.
Mais si la guerre est tout ce qu’elle reçoit, elle combattra en retour.
Durant les quelques jours qui suivent, je rencontre des femmes qui travaillent avec les KAMS, divers dirigeants des Janatana Sarkars, des membres du Dandakaranya Adivasi Kisan Mazdoor Sangathan DAKMS, les familles de personnes qui ont été tuées et simplement des gens ordinaires qui essayent de faire face à la vie en ces temps terrifiants.
J’ai rencontré trois sœurs, Sukhiyari, Sukdai et Sukkali, pas jeunes, peut-être dans la quarantaine, du district de Narainpur. Elles sont dans le KAMS depuis douze ans. Les villageois dépendent d’elles pour s’arranger avec la police. «La police vient en groupes de 200 ou 300. Ils volent tout, les bijoux, les poulets, les cochons, les casseroles et les poêles, les arcs et les flèches» dit Sukkali «ils ne laisseraient même pas un couteau». Sa maison à Innar a été brûlée deux fois, une fois par le Bataillon Naga et une fois par le CRPF. Sukhiary a été arrêtée et emprisonnée à Jagdalpur durant sept mois.
«Un jour, ils ont emmené l’ensemble du village, en disant que les hommes étaient des naxalites». Sukhiari a suivi avec toutes les femmes et les enfants. Ils ont cerné le commissariat et ont refusé de partir jusqu’à ce que les hommes soient libérés. «A chaque fois qu’ils emmènent quelqu’un» dit Sukdai «il faut y aller immédiatement et le reprendre. Avant qu’ils n’écrivent un quelconque rapport. Une fois qu’ils écrivent dans leur livre, cela devient très difficile».
Sukhiari qui enfant, a été enlevée et mariée de force à un homme plus âgé (elle s’est enfuie et est allée vivre avec sa sœur), organise maintenant des rassemblements de masse, parle à des meetings. Les hommes dépendent d’elle pour leur protection. Je lui ai demandé ce que le Parti signifie pour elle. «Naxalvaad ka matlab humaara Parivaar (Naxalvaad signifie notre famille). Quand nous entendons parler d’une attaque, c’est comme si c’était notre famille qui avait été blessée» dit Sukhiari.
Je lui ai demandé si elle savait qui est Mao. Elle a souri timidement. «C’était un dirigeant. Nous travaillons pour sa vision».
J’ai rencontré la Camarade Somari Gawdi. Vingt ans, et elle a déjà purgé une peine de deux ans de prison à Jagdalpur.
Elle était dans le village d’Innar le 8 janvier 2007, le jour où 740 policiers ont disposé un cordon autour du village parce qu’ils avaient l’information que la Camarade Niti s’y trouvait. (Elle y était, mais l’avait quitté au moment où ils sont arrivés). Mais la milice du village, dont Somari était membre, était toujours là. La police a ouvert le feu à l’aube. Ils ont tué deux garçons, Suklal Gawdi et Kachroo Gota. Puis, ils en ont attrapé trois autres, deux garçons, Dusri Salam et Ranai, et Somari. Dusri et Ranai ont été attachés et abattus. Somari a été battue jusqu’à deux doigts de la mort. La police s’est procurée un tracteur avec une remorque et y a chargé les corps morts. Ils ont fait asseoir Somari avec les corps et l’ont emmenée à Narayanpur.
J’ai rencontré Chamri, la mère du Camarade Dilip qui a été abattu le 6 juillet 2009. Elle dit qu’après l’avoir tué, la police a attaché le corps de son fils à un piquet, comme un animal, et l’ont transporté avec eux. (Ils doivent présenter les corps pour recevoir leurs récompenses en argent, avant que quelqu’un d’autre ne vienne revendiquer l’assassinat). Chamri a couru derrière eux toute la route jusqu’au commissariat. Au moment où ils l’ont atteint, il n’y avait plus une bribe de vêtements sur le corps. Sur le chemin, dit Chamri, ils ont laissé le corps le long de la route pendant qu’ils s’arrêtaient dans un dhaba pour prendre le thé et des biscuits (pour lesquels ils n’ont pas payé). Imaginez cette mère un instant, suivant le cadavre de son fils à travers la forêt, s’arrêtant à distance pour attendre que ses meurtriers aient fini de prendre le thé. Ils ne l’ont pas laissée récupérer le corps de son fils afin qu’elle puisse lui donner des funérailles convenables. Ils l’ont seulement laissée jeter une poignée de terre dans le trou dans lequel ils avaient enterré les autres personnes qu’ils avaient tuées ce jour-là. Chamri dit qu’elle veut une vengeance. Badla ku badla. Sang pour sang.
J’ai rencontré les membres élus de la Janatana Sarkar de Marskola, qui administre six villages. Ils ont décrit une descente de police: Ils viennent la nuit, 300, 400, parfois 1.000 d’entre eux. Ils disposent un cordon autour d’un village et guettent. A l’aube, ils attrapent les premières personnes qui sortent pour aller aux champs et les utilisent comme boucliers humains pour entrer dans le village, pour qu’elles leur montrent où sont les pièges. ‘Booby traps’ (objets piégés) est devenu un mot Gondi. Tout le monde sourit chaque fois qu’il est prononcé. La forêt est pleine de pièges, de vrais et de faux (même la PLGA doit être guidée dans les villages). Une fois que la police entre dans le village, ils pillent, volent et brûlent les maisons. Ils viennent avec des chiens. Les chiens attrapent ceux qui tentent de s’enfuir. Ils poursuivent les poulets et les cochons et la police les tue et les emmène dans des sacs. Les SPO viennent avec la police. Ce sont eux qui savent où les gens cachent leur argent et leurs bijoux. Ils attrapent les gens et les emmènent. Ils leur arrachent de l’argent avant de les libérer. Ils transportent toujours quelques ‘habits’ naxals en plus avec eux, dans le cas où ils trouvent quelqu’un à tuer. Ils reçoivent plus d’argent pour tuer les naxals, donc ils en fabriquent. Les villageois sont trop effrayés pour rester à la maison.
Dans cette forêt apparemment tranquille, la vie semble maintenant complètement militarisée. Les gens connaissent des mots tels que Bouclage et Ratissage, Fusillade, Progression, Retraite, Abattre, Action! Pour faire leur récolte, ils ont besoin que la PLGA fasse une patrouille de sentinelles. Aller au marché est une opération militaire. Les marchés sont remplis de mukhbirs (informateurs) que la police a attirés depuis leur village avec de l’argent (1.500 roupies par mois). On me dit qu’il y a une mukhbir mohallah – colonie d’informateurs – à Narayanpur où se trouvent au moins 4000 mukhbirs. Les hommes ne peuvent plus aller au marché. Les femmes y vont, mais elles sont surveillées de près. Si elles achètent régulièrement un petit extra, la police les accuse de l’acheter pour les naxals. Les pharmaciens ont des instructions pour ne pas laisser les gens acheter des médicaments excepté en très petites quantités. Les rations à bas prix du Public Distribution System (PDS – Système de Distribution Publique), le sucre, le riz, le kérosène sont entreposés dans ou près des commissariats, rendant impossible leur achat pour la plupart des gens.
Selon l’article 2 de la Convention des Nations Unies sur la Prévention et la Répression du Crime et du Génocide:
Le génocide s’entend de l’un des quelconque des actes ci-après, commis avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel: meurtre de membres du groupe; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; soumission intentionnelle au groupe de conditions d’existence entraînant sa destruction physique totale ou partielle; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe: (ou) transfert d’enfants du groupe à un autre groupe.
Toutes les marches semblent avoir eu raison de moi. Je suis fatiguée. Kamla me trouve une casserole d’eau chaude. Je me baigne derrière un arbre dans le noir. Mais je ne peux pas manger le souper et je me traîne dans mon sac pour dormir. Le Camarade Raju annonce que nous devons bouger.
Ceci arrive fréquemment bien sûr, mais ce soir, c’est difficile. Nous campions dans un champ ouvert. Nous avions entendu des bombardements au loin. Nous sommes 104. Une fois encore, une file indienne à travers la nuit. L’odeur de quelque chose comme de la lavande. Il devait être 11 heures passées quand nous sommes arrivés à l’endroit où nous allions passer la nuit. Un affleurement de pierres. Formation. Appel. Quelqu’un allume la radio. La BBC dit qu’il y a eu une attaque sur un camp des Eastern Frontier Rifles (Fusils de la Frontière Orientale) à Lalgarh dans le Bengale occidental. 60 maoïstes sur des motos. 14 policiers tués. 10 disparus. Armes saisies. Il y a un murmure de plaisir dans les rangs. Le dirigeant maoïste Kishenji est interviewé. Quand cesserez-vous cette violence et viendrez-vous pour discuter? Quand l’Opération Green Hunt sera annulée. N’importe quand. Dites à Chidambaram que nous discuterons. Question suivante: il fait noir maintenant, vous avez posé des mines terrestres, des renforts ont été appelés, les attaquerez-vous aussi? Kishenji: Oui bien sûr, sinon le peuple me battra. Il y a des rires dans les rangs. Sukhdev le clarificateur dit, «Ils disent toujours mines terrestres. Nous n’utilisons pas de mines terrestres. Nous utilisons des IED[[IED (pour engin explosif improvisé: improvised explosive device), il s’agit d’une bombe artisanale, posée le long d’une route. L’explosion de la charge principale (explosive artisanal ou empilement d’obus) est provoquée par une petite charge d’explosif déclenchée électriquement, à distance, au passage d’un véhicule]]».
Une autre suite luxueuse dans un hôtel 1000 étoiles. Je me sens malade. Il commence à pleuvoir. Il y a de petits gloussements. Kamla me lance un jhilli. Qu’ai-je besoin de plus? Tous les autres s’enroulent dans leurs jhillis.
Le lendemain matin, le décompte des morts est monté à 21, 10 disparus.
Le Camarade Raju est prévenant ce matin. Nous ne bougeons pas avant le soir.
Une nuit, les gens sont amassés comme des papillons de nuit autour d’un point de lumière. C’est le petit ordinateur du Camarade Sukhdev, alimenté par un panneau solaire, et ils regardent Mother India [[Classique du cinéma indien (1957),]] les silhouettes des canons de leurs fusils se détachant sur le fond du ciel. Kamla ne semble pas intéressée. Je lui demande si elle aime les films. «Nhai didi. Sirf ambush video» (Non didi. Uniquement des vidéos d’embuscades). Plus tard, je demande au Camarade Sukhdev ce qu’il en est des vidéos d’embuscades. Sans un clignement de paupière, il m’en montre une.
Elle commence par des vues du Dandakaranya, rivières, cascades, gros plan d’une branche d’arbre nue, le cri d’un oiseau. Puis soudainement, un camarade bidouille les fils d’un IED, le cachant avec des feuilles sèches. Un cortège de motos explose. Il y a des corps mutilés et des motos qui brûlent. Les armes sont saisies. Trois policiers, sous le choc, ont été ligotés.
Qui filme? Qui dirige les opérations? Qui rassure les policiers capturés, qu’ils seront relâchés s’ils se rendent? (Ils ont été libérés, j’en ai eu la confirmation plus tard).
Je connais cette douce voix rassurante. C’est le Camarade Venu.
«C’est l’embuscade de Kudur» dit le Camarade Sukhdev.
Il a également l’archive vidéo de villages brûlés, les témoignages de témoins visuels et de parents des morts. Sur le mur roussi d’une maison brûlée, il est écrit ‘Nagaaa! Né pour Tuer!’ Il y a des séquences du petit garçons dont les doigts ont été coupés pour inaugurer le chapitre Bastar de l’Opération Green Hunt. (Il y a même une interview télé de moi. Mon bureau. Mes livres. Etrange)
Durant la nuit, à la radio, il y a des nouvelles d’une autre attaque naxale. Celle-ci à Jamui, Bihar. Elles disent que 125 maoïstes ont attaqué un village et tué dix personnes appartenant à la tribu Kora en représailles d’information donnée à la police ayant entraîné la mort de six maoïstes. Bien sûr, nous savons que le reportage peut être vrai, ou pas. Mais si c’est vrai, celle-ci est impardonnable. Les Camarade Raju et Sukhdev ont l’air nettement mal à l’aise.
Les nouvelles qui sont venues du Jharkhand et du Bihar sont inquiétantes. L’horrible décapitation du policier Francis Induvar reste fraîche dans tous les esprits [Cf. [Inde : Nouveaux combats entre policiers et guérilleros maoïstes]]. C’est un rappel de la facilité avec laquelle la discipline de la lutte armée peut se dissoudre en actes grossiers de violence criminalisée ou en laides guerres d’identités entre les castes, les communautés et les groupes religieux. En institutionnalisant l’injustice comme il le fait, l’Etat indien a transformé ce pays en une poudrière de troubles massifs. Le gouvernement se trompe complètement s’il pense qu’en effectuant des ‘assassinats ciblés’ pour ‘décapiter’ le CPI(Maoïste), il arrêtera la violence. Au contraire, la violence se répandra et s’intensifiera, et le gouvernement n’aura personne à qui parler.
Durant mes quelques derniers jours, nous serpentons à travers la luxuriante et magnifique vallée d’Indravati. Comme nous marchons le long d’un flanc de colline, nous voyons une autre file de gens marchant dans la même direction, mais de l’autre côté de la rivière. On me dit qu’ils sont en route pour la réunion anti-barrage du village de Kudur. Ce ne sont pas des clandestins, mais ils ne sont pas armés. Un rassemblement local pour la vallée. J’ai sauté dans une barque et les ai rejoints. Le barrage de Bodhghat submergera la totalité de la région dans laquelle nous avons marché durant des jours. Toute cette forêt, toute cette histoire, toutes ces histoires. Plus de cent villages. Est-ce donc ça le plan? De noyer les gens comme des rats, afin que l’aciérie intégrée à Lohandiguda et la mine de bauxite et la raffinerie d’aluminium des Keshkal Ghats puissent avoir la rivière?
A la réunion, des gens qui sont venus de loin, disent la même chose que ce que nous entendons depuis des années. Nous nous noierons, mais nous ne bougerons pas! Ils sont ravis que quelqu’un de Delhi soit avec eux. Je leur dit que Delhi est une ville cruelle qui ne les connaît pas et ne s’intéresse pas à eux.
Juste quelques semaines avant de venir à Dandakaranya, j’ai visité Gujarat. Le barrage Sardar Sarovar est plus ou moins achevé maintenant. Et pratiquement chaque chose que le Narmade Bachao Andolan (NBA) avait prédit s’est produit. Les gens qui ont été déplacés n’ont pas été réinsérés, mais cela va sans dire. Les canaux n’ont pas été construits. Il n’y a pas d’argent. Donc l’eau de Narmada est détournée vers le lit vide de la Sabarmadi (sur laquelle on a fait un barrage il y a longtemps). Une grande partie de l’eau est lampée par les villes et la grande industrie. Les effets en aval – l’entrée d’eau salée dans un estuaire sans rivière – deviennent impossibles à atténuer.
Il fut un temps où croire que les grands barrages étaient ‘les temples de l’Inde Moderne’ était peu judicieux, mais peut-être compréhensible. Mais aujourd’hui, après tout ce qui s’est passé, et alors que nous savons tout ce que nous faisons, il doit être dit que les grands barrages sont un crime contre l’humanité.
Le barrage de Bodhghat a été mis au frigo en 1984 après la protestation de la population locale. Qui l’arrêtera maintenant? Qui empêchera que la première pierre soit posée? Qui arrêtera le vol de l’Indrivati? Quelqu’un doit le faire.
Pour la dernière nuit, nous avons campé au pied de la colline escarpée que nous allions escalader durant la matinée, pour émerger sur la route où une moto me prendrait. La forêt à même changé depuis que j’y suis entrée. Les chiraunjis, les kapokiers et les manguiers ont commencé à fleurir.
Les villageois de Kudur envoient une énorme casserole de poisson fraîchement pêché au camp. Et une liste pour moi, de 71 variétés de fruits, de légumes, de légumes secs et d’insectes qu’ils prennent dans la forêt et cultivent dans leurs champs, ainsi que leurs prix sur le marché. C’est juste une liste. Mais c’est aussi une carte de leur monde.
La poste de la jungle arrive. Deux ‘biscuits’ pour moi. Un poème et une fleur séchée de la Camarade Narmada. Une très jolie lettre de Maase. (Qui est-elle? Le saurai-je jamais?)
Le Camarade Sukhdev demande s’il peut télécharger la musique de mon Ipod sur son ordinateur. Nous écoutons un enregistrement de Iqbal Bano chantant ‘Hum Dekheige’ (Nous assisterons à la journée) de Faiz Ahmed Faiz au célèbre concert de Lahore au sommet de la répression durant les années Zia-ul-Haq.
-Jab ahl-e-safa-Mardud-e-haram,
-Masnad pe bithaiye jayenge
-Quand les hérétiques et les honnis
-Seront assis en haut
-Sab taaj uchhale jayenge
-Sab takht giraye jayenge
-Toutes les couronnes seront arrachées
-Tous les trônes renversés
-Hum Dekhenge
50.000 personnes du public dans ce ‘Pakistan’-là commencent un chant de défi: Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Toutes ces années plus tard, ce chant retenti dans cette forêt. Etrange, ces alliances qui se font.
Le Ministre de l’Intérieur a émis des menaces voilées à ceux qui ‘offrent par erreur un soutien intellectuel et matériel aux maoïstes’. Est-ce que partager l’écoute d’Iqbal Bano rempli ces conditions?
A l’aube, je dis au revoir aux Camarades Madhav et Joori, au jeune Mangtu et aux autres. Le Camarade Chandu est parti pour organiser les motos et viendra avec moi jusqu’à la route principale. Le Camarade Raju ne vient pas (L’escalade serait un enfer pour ses genoux). La Camarade Niti (la Plus Recherchée), les Camarades Sukhdev, Kamla et cinq autres m’emmèneront en haut de la colline. Comme nous commençons à marcher, Niti et Sukhdev détachent avec désinvolture, mais simultanément, les crans de sûreté de leurs AK. C’est la première fois que je les ai vu faire ça. Nous approchons de la ‘frontière’. «Tu sais quoi faire si nous nous retrouvons sous le feu?». Sukhdev demande ça avec désinvolture, comme si c’était la chose la plus naturelle du monde.
«Oui» dis-je «déclarer immédiatement une grève de la faim indéfinie».
Il s’est assis sur une pierre et a rigolé. Nous avons escaladé durant environ une heure. Juste en-dessous de la route, nous nous sommes assis dans une alcôve pierreuse, complètement dissimulés, comme un parti en embuscade, guettant le son des motos. Quand il arrive, l’adieu doit être rapide. Lal Salaam Camarades.
Quand j’ai regardé en arrière, ils étaient toujours là. Agitant la main. Un petit attroupement. Des gens qui vivent avec leurs rêves, alors que le reste du monde vit avec ses cauchemars. Chaque nuit, je pense à ce voyage. Ce ciel nocturne, ces chemins forestiers. Je vois les talons de la Camarade Kamala dans ses sandales éraflées, éclairés par la lumière de ma lampe électrique. Je sais qu’elle doit être en mouvement. Marchant, pas seulement pour elle-même, mais pour garder l’espoir en vie pour nous tous.
Plainte du 12 avril 2010 contre Arundhati Roy
Le 12 avril 2010, un ‘citoyen ordinaire’ dépose plainte contre Arundhati Roy suite à la publication de son texte Walking With The Comrades. Celui-ci est paru dans l’édition du 29 mars 2010 du magazine hebdomadaire Outlook. Dans le courant du mois de février, l’écrivain a eu l’occasion de passer plusieurs jours dans la forêt du Dandakaranya en compagnie des guérilleros maoïstes. Elle a donc franchi la ‘frontière’ interdite pour vivre à l’intérieur et témoigner de ce qui se passe de l’autre côté de la ligne de front de l’Opération Green Hunt actuellement menée par le gouvernement indien pour éradiquer ceux qu’il qualifie de ‘plus grande menace pour la sécurité intérieure du pays’. Dans son compte-rendu, Roy évoque son voyage, les mesures de précautions quant à sa venue, ses rencontres avec les combattants, de nombreuses femmes souvent très jeunes. Elle raconte également une grande fête traditionnelle populaire à laquelle elle a pu assister. Mais elle pointe aussi les conditions de vie déplorables des villageois de ces endroits reculés, l’absence totale d’infrastructures de soin, d’écoles, et l’état de santé extrêmement mauvais de l’ensemble des personnes qu’elle a rencontré. Comme elle le dit, son objectif était de rapporter des informations à propos d’une situation qui est peut être qualifiée d’Etat d’Urgence. Sachant qu’aucune nouvelle ne filtre dans les médias bourgeois, elle affirme qu’il est crucial pour la population indienne, notamment dans les villes, de savoir ce qui se déroule de l’autre côté, et ce afin de prendre des décisions en connaissance de cause. Mais pour le plaignant Viswajit Mitra, ce texte n’est qu’une glorification du mouvement maoïste. En outre, il affirme que Roy cherche à dénigrer le système établi de l’Etat, y compris son système judiciaire. Et de la citer ‘au moins, là, le collectif est présent pour prendre une décision. Elle n’est pas prise par des juges qui ont perdu tout contact avec la vie ordinaire’. Sa plainte a été déposée en vertu du CSPSA de 2005 (Loi Spéciale de Sécurité Publique du Chhattisgarh) qui interdit toute aide ou contribution à une organisation terroriste. Or pour lui, le texte peut être interprété comme visant à créer un soutien envers les maoïste. Cette loi, selon laquelle plusieurs militants ont déjà été condamnés et emprisonnés, est critiquée depuis son adoption. Elle l’est pour sa large définition de ce qui peut être qualifié d’activité illégale ainsi que pour les sanctions strictes qu’elle applique à ceux qu’elle condamne. Un avocat de la Cour Suprême parle du CSPSA en ces termes ‘Le langage approximatif et large utilisé pour définir et criminaliser le soutien à une organisation terroriste peut et a été mal employé par le passé. En vertu de la Loi, même un avocat représentant un maoïste au tribunal ou un médecin ayant soigné un maoïste blessé peut être poursuivi’. Pour avoir rendu public le témoignage de ce qu’elle a vu et vécu dans les forêts retirées et isolées du Dandakaranya, Arundhati Roy se voit donc tomber sous l’application de cette loi vivement critiquée mais toujours d’application. Elle risque jusqu’à deux ans de prison.
L’affaire ‘Binayak Sen’
Binayak Sen est un pédiatre et un spécialiste de la santé publique de renon. Il est connu pour oeuvrer à l’extension des soins de santé aux populations les plus pauvres, surveillant la santé et l’état nutritionnel des habitants du Chhattisgarh. Enfin, il milite pour la défense des droits humains des tribaux et des autres démunis indiens. Sen est le vice-président national de la PUCL (People’s Union for Civil Liberties) basée dans l’état du Chhattisgarh et secrétaire général de son unité de l’état. En sa qualité de membre de la PUCL, il a aidé à organiser de nombreuses missions d’enquête sur les violations des droits humains. Il a pris part à des recherches qui ont attiré l’attention sur de graves violations de droits humains, y compris le meurtre de personnes désarmées et de civils innocents par la Salwa Judum. Sen a été noté pour sa défense des méthodes pacifiques. Peu avant son arrestation, il disait ‘Ces dernières années, nous constatons partout en Inde – et donc dans l’état du Chhattisgarh également – un programme concerté pour enlever à la population la plus pauvre de la nation indienne son accès aux ressources essentielles des propriétés communes et aux ressources naturelles en ce y compris la terre et l’eau… La campagne appelée Salwa Judum dans le Chhattisgarh est une partie de ce processus dans lequel des centaines de villages ont été dénudés de la population qui y vivait et des centaines de personnes – hommes et femmes – ont été tués. Des milices armées gouvernementales ont été déployées et les gens qui ont protesté contre de tels mouvements et ont essayé de montrer au monde la réalité de ces campagnes – des travailleurs pour les droits humains comme moi – ont également été visés par des actions d’état contre eux. Au moment présent, les travailleurs de la PUCL de la section du Chhattisgarh, dont je suis le secrétaire général, sont particulièrement devenus la cible de cette action d’état; et moi, comme plusieurs de mes collègues, suis visé par l’état du Chhattisgarh sous forme d’action punitive et d’emprisonnement illégal. Et toutes ces mesures sont prises principalement sous l’égide du CSPSA‘.
Le 14 mai 2007, Binayak Sen a été arrêté en vertu du CSPSA dans la ville de Bilaspur dans le Chhattisgarh. Les autorités l’accusaient d’agir en qualité de coursier entre le dirigeant maoïste emprisonné Narayan Sanyal et l’homme d’affaire Piyush Gutia, également accusé d’entretenir des liens avec les maoïstes. Dès son arrestation, les réactions ont été multiples et une campagne internationale a été mise en place pour exiger sa libération immédiate.

Un communiqué de presse émanant de personnalités importantes est publié le 16 mai: ‘Les fausses ‘rencontres’, les viols, les incendies de villages et le déplacement des adivasis (tribaux autochtones) par dizaine de milliers et la perte conséquente de leurs moyens de subsistance ont été rapporté abondemment dans plusieurs enquêtes indépendantes. L’arrestation de Sen est clairement une tentative pour intimider la PUCL et d’autres voix démocratiques qui se sont prononcées contre les violations des droits humains dans l’état’.
Dès son incarcération, son avocat demande qu’il soit libéré sous caution. A chaque fois qu’il en a introduit la demande, celle-ci a été refusée et la garde à vue de Sen a été prolongée. Début juin, après avoir saisi et analysé le contenu de son ordinateur, la police affirme détenir des preuves compromettantes contre Sen et le 3 août, il est inculpé en vertu du CSPSA. Le 10 décembre, devant plusieurs juges, le militant affirme qu’il a été arrêté sur des accusations fabriquées de prétendus liens avec les naxalites, affirmant qu’il n’était qu’un militant de la PUCL et qu’il n’était d’aucune manière en liaison avec les maoïstes. Mais chacun de ses arguments est contré par les juges qui déclarent que le fait d’appartenir à la PUCL ne signifie pas qu’il est a l’abri. Le gouvernement d’état du Chhattisgarh doit alors statué sur le sort de Sen et abonde dans le sens du tribunal affirmant qu’il est évident qu’aucune affaire n’aurait été ouverte s’il n’y avait pas de preuve de son implication avec les maoïstes. Sen reste donc en prison et ce jusqu’au 25 mai 2009, jour où il est finalement libéré sous caution par la Cour Suprême au vu de la détérioration de son état de santé.

Binayak Sen
Qu’étaient ces preuves contre Binayak Sen, à cause desquelles il a passé deux années en prison, en grande partie à l’isolement?
Une carte postale datée du 3 juin 2006 destinée à Sen de la part du dirigeant maoïste Sri Narayan Sanyal emprisonné à Raipur, mentionnant son état de santé et son affaire, ornée du cachet de la prison; une brochure jaune en hindou ‘A propos de l’unité entre le CPI (Guerre Populaire) et le Centre Communiste Maoïste’; une lettre écrite par Madanlal Banjare (membre du CPI-maoïste) depuis sa prison et adressée au Camarade Binayak Sen; un article photocopié en anglais intitulé ‘Mouvement naxal, mouvements tribaux et des femmes’; une note écrite à la main photocopiée de quatre pages sur ‘comment construire un front anti-impérialiste américain’; un article de huit pages intitulé ‘Globalisation et le secteur des services en Inde’. Aujourd’hui, Binayak Sen n’est donc plus en prison, mais libéré sous caution, il n’est toujours pas entièrement libre.
En avril 2009, Arundhati Roy avait fait une déclaration publique afin de dénoncer l’emprisonnement du Dr Binayak Sen, et pour exiger sa libération.
Lire la déclaration d’Arundhati Roy sur l’affaire Sen – format pdf