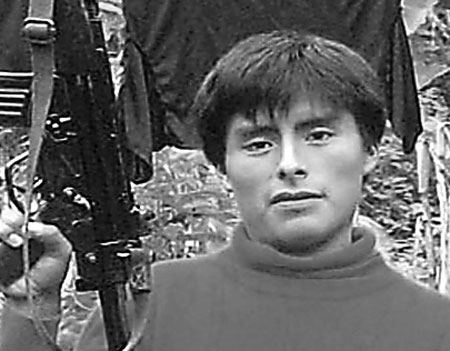Ce 12 juin 2010, le groupe Yorum a célébré son 25e anniversaire devant 55.000 personne dans le stade du club sportif de Besiktas. Le groupe a été crée en 1985 à Istanbul par des étudiants d’université, dans le but de réagir au coup d’état militaire de 1980 et aux politiques de dépolitisation et d’oppression qui ont en résultèrent. Aujourd’hui, le groupe n’aligne plus un seul vétéran. La répression permanente qui pèse sur le groupe depuis 1985 et qui n’a que peu diminué, a provoqué au total la perte de près de 50 musiciens arrêtés, emprisonnés, torturés, exilés et même assassinés pour trois d’entre eux. Mais groupe Yorum est une véritable institution, une école qui compte des centaines de disciples. Aujourd’hui encore, un musicien du groupe, Muharrem Cengiz, est incarcéré à la prison de Trabzon pour son appartenance présumée à une action révolutionnaire. Il a envoyé un message. Un autre musicien du groupe, Ihsan Cibelik, recherché lui aussi pour son appartenance au DHKP-C et exilé en Europe, a participé au concert par vidéoconférence en chantant une élégie dédiée au révolutionnaire Ulas Bardakçi.
Au début des années 1990, les chansons de Yorum s’écoutaient dans la plus haute discrétion. Leurs concerts et leurs clips étaient alors totalement interdits, leurs fans étaient arrêtés pour « appartenance à une organisation terroriste ». Lorsqu’ils étaient emprisonnés voire isolés les uns des autres, les révolutionnaires du Yorum (ils se définissent d’abord comme révolutionnaires, ensuite comme musiciens) recréaient leur groupe en fabriquant des flutes pastorales (kaval) avec de vieux tuyaux rouillés, des percussions avec des poubelles cabossées, des flutes de pan avec des manches de rasoir en plastique. Ils s’échangeaient leurs ébauches de chansons, leurs partitions, leurs remarques et critiques puis enregistraient leurs compositions sur cassettes audio qu’ils envoyaient à leurs camarades encore libres. Depuis que leurs concerts sont tolérés, davantage grâce à leur obstination et à celle de leur fans qu’à la bonne volonté des autorités, les membres de Yorum ont écumé les plus grandes salles du pays et ils les remplissent tant et si bien que désormais, même les stades ne sont plus assez grands pour accueillir leur public.
Le groupe a revisité son riche répertoire constitué de chansons d’amour, de ballades exaltant l’esprit révolutionnaire, la dignité ou la fraternité, d’élégies en hommage aux révolutionnaires assassinés ou incarcérés, d’hymnes antifascistes et ouvriers chantées en turc, en kurde, en arabe, en laze et en circassien. Les 55.000 spectateurs l’ont accompagné dans une chorale improvisée qui a littéralement fait trembler le stade.
Concert anniversaire du groupe Yorum