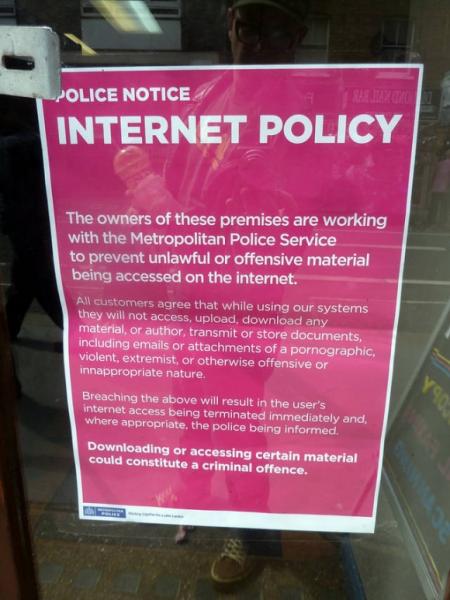Le 8 mai dernier, une double explosion a fait 66 morts dans la plus grande mine de Russie, située dans la région de Kemerovo. 24 autres personnes sont toujours portées disparues alors que les opérations de secours ont été suspendues pour des raisons de sécurité depuis jeudi et ne reprendront pas avant ce jeudi. Alors qu’aucune membre de la direction ne s’est rendu sur les lieux du drame et que les négociations avec des représentants du gouvernement régional n’ont abouti à rien, les travailleurs ont manifesté vendredi dernier, réclamant des salaires plus élevés ainsi que de meilleures conditions de travail. Des centaines de mineurs et de sympathisants ont bloqué le trafic ferroviaire de la ville de Mezhdurechensk, où se trouve la mine, avant l’intervention musclée de la police. 28 participants à la manifestation ont été arrêtés après de violents affrontements avec les forces de l’ordre qui tentaient de les disperser. Durant l’intervention, six policiers ont été blessés par des jets de pierre et de bouteilles lancés par les mineures en réactions aux interpellations violentes des policiers armés de matraques.
Manifestation de mineurs en Russie
Dossier(s): Archives Asie et Océanie Tags: Manifestation, Russie
• Rapporter un article buggé.